Dans son dernier ouvrage, Le vrai savoir des druides, publié aux éditions Trédaniel, Bernard Rio explore avec rigueur et érudition la philosophie druidique. S’appuyant sur des sources antiques, médiévales et celtiques, l’auteur dévoile un enseignement millénaire souvent déformé ou ignoré, et pourtant d’une étonnante modernité. Il restitue les fondements spirituels et cosmogoniques d’une tradition européenne qui interpelle le monde contemporain. Breizh-info l’a rencontré pour une plongée captivante dans la sagesse oubliée des druides.
Breizh-info.com : Qu’est-ce qui vous a poussé à vous plonger dans l’étude philosophique du druidisme, un domaine que beaucoup jugent flou ou ésotérique ?
Bernard Rio : Les druides ont déjà fait l’objet d’études spécialisées en particulier par des historiens et des archéologues depuis le début du vingtième siècle. Nous connaissons aujourd’hui l’organisation de la classe sacerdotale des Celtes, et ses différentes fonctions réparties entre philosophes, législateurs, poètes, magiciens et médecins. Cependant si les archéologues traitent de l’archéologie, si les historiens étudient de l’histoire, si les mythologues décryptent les mythes, ils ne se sont pas aventurés à étudier la philosophie enseignée par les druides de l’antiquité. Or le corpus de textes, issus de la littérature classique, grecque et latine, de la littérature mythologique irlandaise et galloise, et de la littérature médiévale est suffisamment riche pour tenter une exégèse et proposer cet ouvrage sur la sagesse des druides de l’antiquité.
Breizh-info.com : Vous dites que ce savoir n’a pas été perdu, mais enfoui. Comment avez-vous procédé pour le faire émerger ?
Bernard Rio : Etudier la religion, la doctrine et la philosophie des druides commence par un inventaire et une lecture préalable des textes anciens, ceux transmis par les auteurs classiques, grecs et latins, ainsi que ceux de la littérature celtique, insulaire et continentale.
Depuis la publication par Henri d’Arbois de Jubainville des « Cours de littérature celtique », 1883-1902, les lecteurs francophones ont accès aux grands textes de la littérature insulaire. Puis, au fil des ans, les traductions ont été enrichies… Aux traductions de plus en plus fiables à partir des textes d’origine se sont ajoutées des éditions critiques. Cet essai sur la philosophie des druides doit ainsi beaucoup aux travaux de Nora Kershaw Chadwick, de John Myles Dillon, Françoise Le Roux et de Christian-J. Guyonvarc’h, de Philippe Jouët, de Venceslas Kruta, de Joseph Monard, de Claude Sterckx ainsi qu’aux études indo-européennes de Georges Dumézil et de Jean Haudry, sans oublier les recherches linguistiques de Pierre-Yves Lambert, de Xavier Delamarre, et de Jean-Paul Savignac, et les études mythologiques de Joël-H. Grisward, Jean-Loïc Le Quellec, Valéry Raydon, Bernard Sergent, Philippe Walter…
La complexité de la matière celtique exige de laisser la première place aux textes antiques et médiévaux, non pour réduire ou effacer le commentaire mais pour, après lecture, autoriser des renvois et comparer des références mythologiques, folkloriques, historiques et religieuses afin de proposer des pistes de réflexion.
Le choix d’étudier la philosophie des druides en croisant la littérature classique et la mythologie privilégie une approche transdisciplinaire mais aussi comparatiste avec les autres domaines indo-européens. En amont des textes copiés par les moines dans l’Irlande chrétienne, il y a un panthéon païen, il y a une épopée merveilleuse, il y a une cosmogonie. Notre propos est de contribuer à une meilleure connaissance de ces textes fondamentaux et par là de se faire son opinion sur l’enseignement des druides.
Breizh-info.com : Vous citez abondamment les textes antiques, irlandais, gallois, médiévaux. Quels sont selon vous les plus déterminants pour comprendre l’enseignement druidique ?
Bernard Rio : La littérature classique, grecque et latine, mentionne l’existence des druides chez les « barbares ». L’une des premières références aux druides date de la fin du troisième siècle avant J.-C. Il s’agit du traité de Sotion d’Alexandrie « Les successions des philosophes » ultérieurement cité entre autres par Diogène Laërce. Une source incontournable reste l’ouvrage de Jules César « La guerre des Gaules ». Ce récit des campagnes militaires du consul romain, entre 58 et 50 avant J.-C. contient des commentaires sur la religion et les croyances des Gaulois. Le passage le plus intéressant sur les druides se trouve dans le Livre VI. Parmi les autres documents de la littérature classique concernant les druides, citons le cinquième livre de la « Bibliothèque historique » de Diodore de Sicile. (– 90 avant J.-C.) ; le quatrième livre de la « Géographie » de Strabon (60 av. J.-C – 20 après J.-C.) ; le troisième livre de « Chorographie » écrit en 43 par Pomponius Mela ; le premier livre de « La Pharsale » de Lucain (39-65) ; le seizième livre et le trentième livre de l’« Histoire naturelle » de Pline l’Ancien (23-79) ; le quinzième livre du « Timagène » d’Ammien Marcellin (330-395)…
Dans le domaine insulaire, par exemple la mythologique irlandaise, celle-ci est connue grâce à différents textes épiques transcrits en gaëlique à partir du huitième siècle, et contenus dans plusieurs recueils : « Book of the Dun Cow » (XIe siècle), « Book of Leinster » (XIIe siècle), « Yellow Book of Lecan » (XIVe siècle), « Book of Ballymote » (XVe siècle), « Book of Fermoy » (XIV-XVIe siècles) … Chaque ouvrage recense des pièces qui, complétées par d’autres pièces issues d’autres ouvrages, composent différents cycles. Quant à la mythologie galloise, la source diffère de l’ancienne littérature irlandaise en raison d’une précoce romanisation puis christianisation de la Grande-Bretagne. Le principal corpus gallois est composé des quatre branches du « Mabinogi », qui ont fourni à l’Europe la matière arthurienne. Outre ce corpus, le domaine mythologique gallois est composé de contes et de poèmes, qui ont eux aussi contribué aux romans du Graal.
Sur le continent, il n’existe plus de textes épiques en ancien breton, seulement des textes en latin, notamment « Le livre des faits d’Arthur » cité dans la « Chronique de Saint Brieuc » (1019). On trouve cependant un genre prophétique en moyen breton, sous la forme d’un dialogue entre le roi Arthur et le prophète Guinglaff, remanié au XVIe siècle et conservé dans la mémoire populaire sous le titre « Diougan Gwenc’hlan », « La prophétie de Gwenc’hlan ». Le vicomte Hersart de La Villemarqué, en a donné une version en ouverture de la première édition du « Barzaz Breiz » en 1839. Une autre source armoricaine de littérature ancienne est composée des chroniques historiques et des hagiographies ou Vies des saints bretons, rédigées en latin, notamment celles de saint Samson, saint Malo, saint Gouesnou, saint Magloire, saint Ronan, saint Turiau, etc. Les auteurs de ces Vies s’inspiraient à la fois d’une doctrine chrétienne et d’une tradition celtique, par exemple Ratuili, l’auteur au neuvième siècle de « Gesta sanctorum Rothnensium ».
Breizh-info.com : Vous évoquez une méthode transdisciplinaire mêlant philologie, mythologie, histoire, philosophie… Est-ce cela qui rend votre livre à la fois savant et accessible ?
Bernard Rio : Le comparatisme est nécessaire et même indispensable dans le domaine de la religion celtique, car l’enseignement des druides s’adressait à des auditeurs férus d’astronomie, de cosmogonie, de physiologie, et de théologie. Pour interpréter les textes, il convient donc d’utiliser une méthodologie transdisciplinaire. La cosmogonie celtique induit par exemple une conception cyclique du monde, avec des jours, des saisons, des années, des lustres… Le jour succède à la nuit, l’été à l’hiver. Le cycle cosmique reproduit un cycle observé dans le ciel, avec le soleil et la lune, dans la nature et dans la vie humaine. Les druides assimilaient le monde à un organisme vivant, ce qui suppose plusieurs âges du monde, avec une apogée et une mort. Nous pourrions synthétiser et transposer cette cosmogonie dans une formule qui serait : L’Etre succède au Non-Etre. Mon propos est d’expliquer et non d’obscurcir les textes anciens, les lecteurs diront si j’y suis parvenu.
Breizh-info.com : Quelles sont les grandes idées qui structurent la pensée druidique ?
Bernard Rio : Les druides apportaient une première réponse à la question de la création du monde : un recommencement sans fin, un acte créateur qui s’inscrivait dans un cycle.
Leur savoir était l’expression de l’Indestructible, le principe qui se manifeste dans le rite perpétuel de sacrifice qu’est l’Univers.
Le dieu des druides participait à la fois de l’ombre et la lumière. Il s’agit d’un antagonisme de valeurs complémentaires et non exclusives. C’était un pontife qui liait, reliait, et déliait les âmes de leurs conditions humaines.
Le druide enseignait également l’immortalité de l’âme et sa survie après la mort physique. L’âme à l’origine céleste était destinée à retourner dans le monde sidéral après s’être incarnée dans le corps.
Nous pouvons aussi citer nombre d’exemples où la connaissance antique des druides a été validée par la science moderne. Les druides connaissaient notamment la grandeur et la forme ronde de la Terre appelée « Crundnion » signifiant le « globe ». Ils enseignaient la dilution et la contraction du temps et donc la théorie de la relativité du temps. Ils avaient donc une perception du temps relatif, avec une transmutation du temps et de l’espace.
Breizh-info.com : Vous évoquez la croyance en un monde infini, au temps cyclique, à l’immortalité de l’âme. En quoi ces conceptions rejoignent-elles ou diffèrent-elles de certaines philosophies antiques ou orientales ?
Bernard Rio : La croyance dans l’Autre-Monde repose sur une doctrine de l’être victorieux ou vaincu par les ténèbres après sa mort physique. Cette croyance induit plusieurs fins dernières selon le statut et le destin bienheureux ou malheureux du défunt. Séjour dans un pays merveilleux, relégation dans des enfers froids et humides, montée glorieuse au ciel…
L’histoire du monde se confond avec l’histoire des dieux, avec un Age d’Or sous l’égide d’un bon roi et un Age noir sous la tyrannie d’un mauvais souverain, coupable de fautes fonctionnelles qui entraînent sa ruine, son déclin, sa mort et son remplacement.
Puisque la conception du temps chez les Celtes place la nuit au commencement et avant le jour, et l’hiver au début de l’année, l’être émerge donc de l’obscurité nocturne. Il la traverse littéralement pour voir le jour. Cette quête de la lumière est ce qui meut la destinée et motive cet être qui naît de la nuit et qui achève son cycle en revenant au non-être ou en devenant immortel – pour les meilleurs d’entre les hommes – , c’est-à-dire en quittant le plan terrestre pour accéder au monde des dieux, au monde céleste.
L’eschatologie, du grec éskhatos, « dernier », et logos, « parole » ne fait pas exception dans le monde celtique au discours sur la fin du monde en Grèce, en Egypte, en Inde… Les textes mythologiques racontent les fins dernières, celles de l’homme, d’une famille, d’un peuple, d’un royaume, d’un monde. La chute est annoncée. Mais le chaos précède un renouveau, comme le jour succède à la nuit.
Breizh-info.com : L’œuf de serpent, tel que décrit par Pline l’Ancien, est central dans votre ouvrage. Que symbolise-t-il réellement ?
Bernard Rio : L’œuf de serpent figure en effet au sommaire de mon ouvrage, et est traité dans un des chapitres. Je cite pour cela un extrait de L’« Histoire naturelle » de Pline l’ancien, le seul texte de l’antiquité où il est fait explicitement mention de l’œuf de serpent des Gaulois.
L’« ovum anguinum » ou œuf de serpent avait valu à un Gaulois originaire du pays des Voconces d’être condamné à mort par l’empereur Claude, qui régna de 41 à 54 après J.-C. Le fait de porter sur soi un œuf de serpent, considéré comme un talisman, attestait de facto une affiliation à la religion gauloise ; et le chevalier voconce fut condamné en vertu de la loi de l’empereur Auguste interdisant de s’affilier au druidisme.
L’œuf de serpent mentionné par Pline était un oursin fossile, « micraster coranguinum », dont on a découvert de nombreux exemplaires dans des sépultures depuis le néolithique jusqu’à la période celtique, ce qui confirme son importance cultuelle dans les trois Gaules.
Pline est un auteur latin qui n’était pas dépourvu de préjugés à l’encontre des barbares. Les faits qu’il rapporte sont décrits sous les prismes du naturalisme et de l’histoire romaine, or ce serait avec une approche symbolique et religieuse qu’il conviendrait de les étudier. Le serpent mentionné par Pline n’est pas autre que le serpent cornu, criocéphale, des druides, équivalent de la kundalini des Hindous. Il s’agirait d’une autre allégorie de l’élan vital. L’ovum anguinum, symbole de naissance et de renaissance, de protection et de reproduction, représente l’œuf cosmique, le souffle divin, le verbe incarné. Il est l’Unité première avant la différenciation sexuelle, la distinction de l’âme et du corps, la séparation du ciel et de la terre, l’opposition des possibles et des contraires. L’interprétation du texte de Pline, relatif à cet œuf de serpent, est un exercice de base et une réflexion sur l’origine du monde. Pour donner la vie, l’œuf, principe féminin, doit être fécondé par le serpent, principe masculin. Ainsi le serpent masculin engendre et le serpent féminin pond l’œuf… Mais les serpents ne peuvent s’unir que s’ils ont eux-mêmes été engendrés. La chaîne des unions est une nécessité indéfinie. Ainsi est posée la question du commencement.
Breizh-info.com : Vous évoquez un « renversement des valeurs » prophétisé par les druides. Faut-il y voir un parallèle avec la crise de civilisation actuelle ?
Bernard Rio : Parmi la littérature eschatologique des Celtes, « le dialogue des deux sages » copié en Irlande dans le « Livre de Leinster », à la fin du douzième siècle, est un exemple de prophétie. Au druide Néde qui lui demande quelles sont les nouvelles, le druide Ferchertne répond : « Ce sera un mauvais temps qui durera longtemps… » Suit toute une série de prédictions funestes. Dans ce texte, le druide Ferchertne prévient son élève des conséquences d’une parole fausse et d’un comportement fautif. Lorsque prévalent la paresse, l’ignorance, et la folie sur la recherche, le savoir et la sagesse ! Le constat est sans appel : les maux s’abattent sur la souveraineté, l’humanité et la terre. C’est la fin du cycle
Cette vision sombre n’est cependant pas une fatalité, puisqu’un roi peut rassembler le peuple, transcender sa fonction et régénérer le mythe, telle sera l’histoire du roi Arthur qui rétablira le droit et la paix dans son royaume jusqu’à sa blessure à la bataille de Camlann et dont le retour d’Avalon a été prophétisé. Le schéma reste toujours le même quelle que soit l’époque et le royaume. Les mythes associent eschatologie et rénovation. Il n’y a donc pas de fin de l’histoire. Quant aux échos que les propos tenus par les druides de l’antiquité peuvent susciter chez nos contemporains, ils mettent en évidence une fin de cycle. Mais il ne faut pas être devin pour comprendre que la société occidentale est aujourd’hui complètement nécrosée, de haut en bas du corps social.
Breizh-info.com : En quoi ce savoir ancestral peut-il être utile à un lecteur breton ou européen du XXIe siècle ?
Bernard Rio : Georges Dumézil a écrit que « les latinistes, philologues et archéologues, tombent souvent dans la plus grave erreur qui se puisse commettre quand on étudie une religion. Ils procèdent en tout cas comme s’ils pensaient que la religion des Indo-Européens et la religion romaine primitive étaient formés d’éléments indépendants, séparables, simplement juxtaposés et mal soudés par les hasards d’une histoire que nous ne connaitrons jamais. Cela n’est pas exact. Cela n’est pas possible… Une religion, comme toute manifestation de la pensée, est un système… ». La réflexion de Georges Dumézil à propos de la religion romaine vaut aussi dans le domaine celtique et notamment des croyances professées par les druides en Gaule et dans le monde insulaire. En effet, les auteurs classiques de l’antiquité et les copistes médiévaux ont transmis un grand nombre de mythes et de légendes pour qu’on puisse aujourd’hui en proposer une exégèse. Dès lors qu’un lecteur a connaissance d’un corpus de mythes où il est question de mystères, de divinités, de prêtres, de devins et de magiciens, ils possèdent les éléments fondamentaux d’une religion et il peut en tirer un enseignement.
Par exemple, le « mabinogi » gallois de Pwyll Pendevic Dyved expose plusieurs mystères. A chacun de les étudier pour ouvrir les portes du sacré. Pwyll, dont le nom signifie « pensée, intelligence, attention », induit un bon sens : il incarne la Raison. Au lecteur de chercher et de trouver à son tour, par raisonnement, intuition et déduction, l’explication des mystères transmis dans le mythe. Le mythe peut être porteur d’une vérité scientifique alors que des historiens ne lui attribuent pas toujours une valeur historique. Tel est le cas de ce texte médiéval qui transcrit un récit mythologique où il est établi la relativité du temps.
Expliquer, c’est souvent se référer à un savoir cognitif. Or pour comprendre le mythe, il faudrait aussi privilégier une méthode intuitive. Il y a donc dans le corpus et dans la méthodologie des leçons à tirer pour nos contemporains. Les notions d’immanence et d’impermanence sont présentes dans la matière celtique. Libre à chacun d’aller les étudier en Inde ou au Tibet, mais il ne faut pas toujours chercher midi à quatorze heures. L’étude des textes anciens, ce n’est surtout pas s’enfermer dans une bibliothèque ou un musée, c’est prendre de la hauteur pour observer le monde tel qu’il est depuis des lustres et non tel que ses défenseurs prétendent qu’il est aujourd’hui.
Breizh-info.com : Vous remettez en question plusieurs lieux communs sur les druides, notamment l’idée qu’ils craignaient que le ciel leur tombe sur la tête. D’où vient cette légende et que signifie-t-elle réellement ?
Bernard Rio : C’est à un texte « Géographie » de Strabon que les commentateurs doivent cette idée :
« Ptolémée, fils de Lagos, raconte que pendant cette campagne (l’expédition d’Alexandre en Thrace) des Celtes établis sur les bords de l’Adriatique vinrent à la rencontre d’Alexandre pour obtenir de lui des bienfaits de relations d’amitié et d’hospitalité. Le roi les reçut chaleureusement et au cours du repas il leur demanda ce qu’ils craignaient le plus, persuadé qu’ils diraient que c’était lui. Mais ils répondirent qu’ils ne craignaient personne, qu’ils redoutaient seulement que le ciel ne tombe sur eux, mais qu’ils plaçaient l’amitié d’un homme tel que lui au-dessus de tout. »
Cette répartie peut s’expliquer par la nature du ciel, demeure des dieux éternels, et la croyance en une correspondance macrocosme-microcosme. En redoutant que le ciel ne leur tombât sur la tête, les Gaulois pensaient que l’inversion du monde équivalait à une fin du monde. Cette doctrine pythagoricienne de l’immortalité de l’âme a contribué à la comparaison par les auteurs classiques de l’enseignement du maîtres de Samos avec l’enseignement des druides.
La mort de l’homme de bien allait donc de pair avec le retour au ciel de son âme. Ce rapport entre le ciel et la terre, le haut et le bas, le macrocosme et le microcosme, peut expliquer la parenté avec la pensée druidique et donner du sens au texte de Strabon. Cette idée que la voûte céleste puisse s’effondrer induisait une fin des dieux, l’équivalent du « ragnarokkr » scandinave et du Kali Yuga védique.
Breizh-info.com : Comment distinguer, aujourd’hui, le vrai du faux entre la tradition druidique historique et les mouvements néo-druidiques contemporains ?
Bernard Rio : La conversion de l’Irlande au christianisme par saint Patrick à la fin du cinquième siècle augura la fin du druidisme. L’ultime mention « historique » des druides remonterait au règne du roi irlandais Diarmait, dont les deux druides Frachan et Tuathan, furent vaincus, en 561 à Culdreimne, en Irlande, par la magie de saint Colomba. Le druidisme avait donc disparu depuis plus d’un millier d’années lorsque ceux qu’on appelait alors des antiquaires s’intéressèrent à l’ancienne classe religieuse du monde celtique. Du XVIe siècle au XIXe siècle, en France et en Grande-Bretagne, les druides redevinrent au goût du jour. Aujourd’hui, des associations se réclament du néo-druidisme conçu au XVIIIe siècle par quelques érudits anglo-saxons, la plupart étant des pasteurs anglicans. Ces néo-druides célèbrent la nature dans des fêtes correspondant aux solstices d’été et d’hiver ainsi qu’aux dates de l’ancien festiaire celtique : 1er mai, 1er août, 1er novembre et 1er février. Leur filiation avec l’antiquité reste improbable. Il n’existe en effet pas d’initiation et de transmission avérée issue de l’ancienne classe sacerdotale des druides, ce qui n’exclut pas la survivance de traditions païennes dans les croyances et les pratiques religieuses populaires en Bretagne, en Irlande et en Grande-Bretagne. Le sujet de mon ouvrage s’attache exclusivement aux anciens druides par le biais des littératures, classique, mythologique et médiévale, et de l’archéologie. Concernant la mouvance néo-druidique, je pense qu’elle reflète l’état de la société civile mais aussi de la société religieuse européenne, que ce soit l’église catholique romaine ou ses hérésies protestantes. On y trouve des individus sincères, d’autres présomptueux, des ignorants sectaires et des chercheurs curieux d’apprendre. Comme dit le dicton, il faut juger l’arbre à ses fruits.
Breizh-info.com : Y a-t-il aujourd’hui, en Bretagne ou ailleurs, une continuité vivante de cet enseignement ?
Bernard Rio : La christianisation, événement majeur dans le monde celtique, n’a pas signifié de facto une latinisation de la société et n’a pas effacé toutes les traces de l’ancienne religion. Il en découle une survivance des cultes et des croyances dans les traditions populaires et les mentalités. A bien des égards, les saints irlandais, bretons et armoricains se comportèrent comme des druides, tant dans les pratiques sacrificielles que magiques. L’héritage le plus prégnant du druidisme est ainsi constitué de trois éléments formant une cohérence en Europe occidentale : le maillage des lieux saints, le festiaire et les rites qui créditent la théorie d’une géographie sacrée et d’un continuum. Quant à leur enseignement, comme je vous l’ai dit précédemment, il a été très peu étudié, malgré une somme de textes dispersés dans la littérature classique, grecque et latine, dans la littérature médiévale, insulaire et continentale, et dans le folklore.
Quant à la question d’une continuité religieuse et plus encore celle d’une filiation ecclésiastique ou liturgique entre druidisme et néo-druidisme, elles ne sont aucunement démontrées. Les plus anciens textes néo-druidiques, celui de Jean Le Fève en 1532 « Les Fleurs en Antiquitez des Gaules, où il est traité des anciens Philosophes Gaulois appelez Druides », ou celui de Jean Martin en 1729 la « Religion des Gaulois » ou druidisme et mégalithisme sont confondus relèvent de ce qu’on peut aujourd’hui appeler la celtomanie. Quant aux textes de John Aubrey, de John Toland, de William Stukeley et d’Edward Williams en Grande-Bretagne, ce sont davantage des témoignages sur le XVIIIe siècle que sur l’antiquité. Je pense , et ce n’est qu’un avis personnel, qu’il y a davantage de substrats druidiques dans les hagiographies chrétiennes et dans le folklore populaire que dans la prose néo-druidique du XIXe et du XXe siècle. Mais les études ne sont jamais figées et il y a encore beaucoup de travail d’exégèse à effectuer pour qui s’intéresse à ce sujet.
A noter des conférences de l’auteur à découvrir ci-dessous :
Jeudi 17 avril, 18h30, conférence « les portes du sacré », hôtel Aquilon à Saint-Nazaire, organisation Association Agora de l’Estuaire Saint-Nazaire
Vendredi 16 mai, 19 h 00, conférence « Le vrai savoir des druides » avec Bernard Rio, centre Ar Ruskenn à Plouhinec (56)
Dimanche 18 mai, 14h à 18 h, signatures à la fête de la Bretagne à Bains-sur-Oust (35), et rencontre 15 h 30 au Dojo.
Jeudi 5 juin, 20 h30, conférence « Le vrai savoir des druides » avec Bernard Rio, organisation librairie « Quand les livres s’ouvrent » à Lorient (56)
Vendredi 6 juin, 17 h à 18 h, Bernard Rio invité de l’émission « Page blanche » sur Bretagne 5 pour la présentation du « Vrai savoir des druides »
Vendredi 13 juin, 14 h à 18h, samedi 14 juin et dimanche 15 juin, 10h à 18h, salon du livre à Vannes (56).
Dimanche 13 juillet, 17h30, conférence sur « les saints bretons », Librairie Les salines, port de Dahouët, Pléneuf-val-André (22)
Jeudi 18 septembre, 19h30, à l’espace Paradis, La Forêt-Fouesnant (29). Rencontre et présentation du « Vrai savoir des druides ».
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

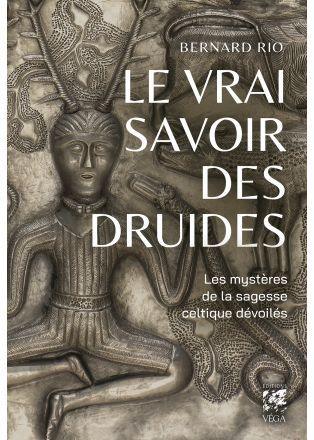




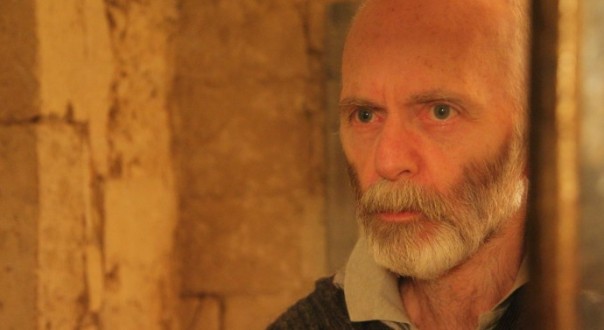
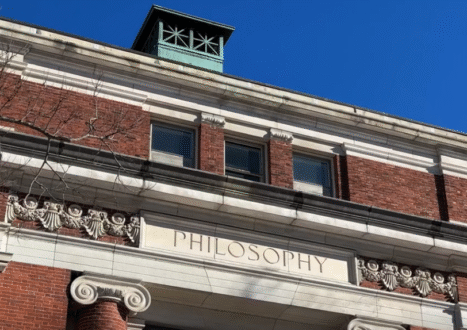

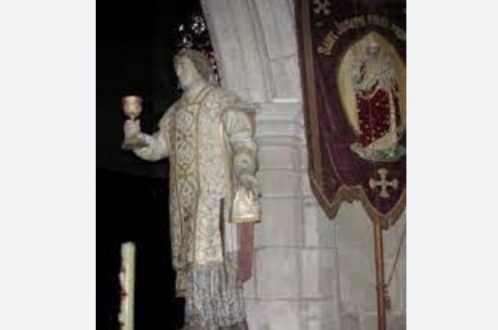



Une réponse à “Bernard Rio (Le vrai savoir des druides) : « Les druides apportaient une première réponse à la question de la création du monde » [Interview]”
Merveilleux, enfin une étude complète et intègre faisant fi des sarcasmes de imbéciles à l’esprit obtus et des guignols de kermesse en robes colorées.
Merci