Jean-Luc Godard, décédé cette semaine à l’âge de 91 ans, occupe dans l’histoire du cinéma la place de la statue du commandeur, plus vénérée qu’admirée, un monument devant lequel on se prosterne par devoir avant d’esquisser un bref bâillement et de passer son chemin. On peut prendre les paris : convoquez dix personnes de moins de 30 ans, et demandez-leur de citer un titre du cinéaste. La plus cultivée extirpera de sa mémoire À bout de souffle, un titre glané dans la nécro de Belmondo et jamais visionné.
Le choc d’À bout de souffle
Pourtant, pour toute une génération d’avant-guerre, ces jeunes adultes qui avaient le choix, après le bachot entre la fac et l’Algérie, ce dernier film a eu l’effet d’une déflagration, démaillotant le corset amidonné d’un cinéma français sur lequel Godard, avec ses copains des Cahiers du cinéma (Truffaut, Chabrol, Rohmer, Rivette) dont il était le dernier survivant, avait placé l’éteignoir. Adresses directes à la caméra, début et fin des scènes escamotés, dialogues provocants (« Si vous n’aimez pas la mer, si vous n’aimez pas la montagne, si vous n’aimez pas la campagne, allez vous faire foutre ! »), érotisme sans jouissance, À bout de souffle (1959) est un polar distancié, filmant avec une verve juvénile et jubilatoire sa propre déconstruction. Si ce film qui percute avec provocation les codes traditionnels de la narration a vieilli, il rend la moitié de la production du moment (Autant-Lara, Clouzot, Duvivier, Clair, Carné, dont Les Tricheurs, 1958, sont honnis) irregardable par la jeunesse du Quartier latin, qui fait les yeux doux au renouvellement des voies artistiques incarnées alors par Bergman, Antonioni, Fellini ou Resnais.
C’est sans doute cette volonté d’être synchrone avec les enjeux et tensions de son époque qui fait la force et la faiblesse du cinéma de Godard des années soixante. Tributaire, au tout début de la décennie, de l’esprit « Hussards » qui régnait aux Cahiers et qui le conduit à renvoyer dos à dos FLN et OAS dans Le Petit Soldat (1960), le metteur en scène va vite faire sienne l’idéologie progressiste ambiante (décolonialisme, féminisme, socialisme) pour transmuer progressivement ses films en précis de sociologie (dont Masculin féminin, dédié aux « enfants de Marx et de coca cola » est le plus saillant représentant). Entre temps, il cède aux sirènes de Carlo Ponti pour son chef-d’œuvre, Le Mépris (1963), qui témoigne de l’immensité de son talent. Jamais Bardot n’a été plus sensuelle et vulnérable, jamais la lumière amalfitaine n’avait été aussi magnifiée, jamais la musique de Georges Delerue n’avait atteint ce degré d’émotion. Il faudra se souvenir, quand on abordera les dernières lignes de l’article, du talent de Godard quand il accepte de se mettre au service de la machine commerciale.
« Le plus con des Suisses pro-chinois »
Mais le démon de la modernité le rattrape. « Mes films ont un début, un milieu et une fin, mais pas dans cet ordre », aime-t-il à galéger. Champion des tournages expéditifs (on raconte qu’Une femme mariée a été mis en boîte entre le début et la fin du festival de Cannes 1964), multipliant les œuvres (une moyenne de trois par an jusqu’à One + One, en 1968), émaillant ses films de références philosophiques (Brice Parain joue son propre rôle dans Vivre sa vie, 1962), métaphysiques, littéraires…, Godard glisse peu à peu vers une radicalité gauchiste sensible à partir de Pierrot le fou (1965), un adieu au cinéma conventionnel, où le dynamitage accidentel (?) de Ferdinand, que joue Belmondo, symbolise la fin du Godard première manière.
Conscient d’être celui que Truffaut qualifiait du « plus intelligent d’entre nous », Godard propose alors non pas des films mais des revues critiques de la société contemporaine, entamant une période Mao qui débute avec La Chinoise (1967), qui pousse assez loin les limites du ridicule et de la grandiloquence, passe par Week End (1968), où il sadise le couple formé à l’écran par Jean Yanne et Mireille Darc (pour leur faire payer leur statut de vedettes), se souvenant dans l’inoubliable scène du carambolage ouvrant le film qu’il est un grand metteur en scène puis l’oubliant avec la pochade finale du Front de libération de Seine-et-Oise. De toute façon, le cinéma ne l’intéresse plus – Michel Hazanavicius, dans Le Redoutable, 2017, retrace avec efficacité l’éveil aux luttes sociales de l’auteur entre deux rencontres avec François Mauriac, le grand-père d’Anne Wiazemski, sa compagne… Mai 68 est son chemin de Damas, et dès lors, avec le groupe Dziga-Vertov, qu’il fonde avec Jean-Pierre Gorin, son art va se dissoudre dans un militantisme qui le conduit à harceler les ouvriers en usine avec des ciné-tracts destinés à aiguillonner leur conscience de classe et à activer l’insurrection prolétaire. Ce mélange de tiers-mondisme, de maoïsme et de marxisme mal digérés cristallise dans l’indigeste (et grotesque) Tout va bien (1972), où Jane Fonda et Yves Montand passent 90 minutes à se demander ce qu’ils sont venus faire dans ce pensum tout aussi didactique que statique.
La désaffection du public
Les efforts pour convertir la classe populaire à la révolution demeurant vains, Godard quitte Paris pour Grenoble, où il dépense ses économies en bancs de montage et caméras vidéo (l’atelier Sonimage) pour façonner ce qu’il estime être le langage audio-visuel de demain. Parce qu’il faut bien vivre, il tente de vendre à la télévision française des projets faisandés (Le Tour de France par deux enfants devient France, tour, détour, deux enfants ; le remake d’À bout de souffle est sous-titré Numéro deux), autant de considérations fumeuses et de télescopages percussifs où abondent les contiguïtés douteuses (Israël assimilé à la Gestapo, les « musulmans » des camps de la mort présagent le sort réservé aux Palestiniens, etc.) qui laissent tout le monde de marbre, parce que « tout le monde » se désintéresse des ratiocinations du héraut auto-proclamé.
Conscient de l’impasse, il revient à un cinéma première manière avec Sauve qui peut (la vie), en 1979, renouant avec des stars comme Jacques Dutronc, Nathalie Baye et Isabelle Huppert, condescendant même à s’assurer la collaboration d’un scénariste patenté comme Jean-Claude Carrière. Suivront Passion (1982) et Prénom Carmen (1983), qui provoquent moins d’enthousiasme. Jusqu’au Livre d’image (2018), malgré la volonté de revisiter ses classiques avec Nouvelle Vague, qui met en scène Alain Delon, ses films, c’est-à-dire des essais et collages autour du conflit en ex-Yougloslavie (les années 90 et 2000) ou les convulsions du capitalisme (les années 2010) et la mondialisation déchaînée, seront reçus avec une glaciale indifférence, à l’exception de thuriféraires branchés, les mêmes qui s’extasient devant l’imposture d’Histoire(s) du cinéma, un film somme où les effets de manche et les citations de Benjamin ou de Novalis masquent mal la vacuité d’un propos sur la faillite du cinéma, incapable de rendre compte de la Shoah – sur fond d’anti-américanisme primaire.
Reste que Godard aura été, pour sa première période, le cinéaste les plus admiré au monde (on ne connaît pas un metteur en scène américain qui ne lui fasse sa révérence) – et sans doute l’un des plus fourvoyés. Convaincu du commandement de la matière (individuelle) sur l’esprit (des lois), il choisit de mettre fin à ses jours par le suicide assisté, en raison de son épuisement physique, – lui ancien motard et imbattable joueur de tennis – suite à de multiples pathologies.
Sévérac
[cc] Breizh-info.com, 2022, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine








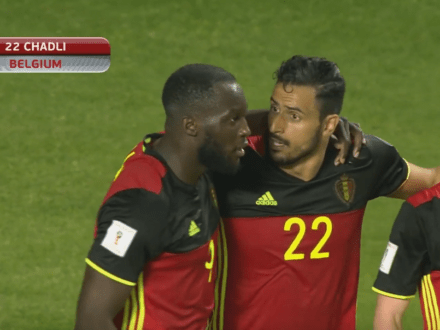



3 réponses à “Jean-Luc Godard. Nous autres modernes”
il y a peu de metteurs en scènes qui aient fait autant de films chiants et aussi prétentieux. Il avait du talent mais à force de l’encenser il a fait n’importe quoi puisque de toutes façons c’était « génial », ça rappelle Sartre, Chagall, Picasso etc
C’est vrai qu’il a inventé un cinéma particulier » nouvelle vague » comme on dit mais la politique dans les films c’est comme les épices dans un bon plat il ne faut pas en abuser !
Et au fur et à mesure ce qui était moderne est devenu démodé…..le temps ne fait pas de cadeau !
et qu’en est-il de ses démons antisémites ?