Il est des spectacles dont la crudité, loin d’éblouir, glace le sang. Ainsi en va-t-il de la mini-série documentaire De rockstar à tueur : le Cas Cantat, que j’ai regardée d’une traite à mon retour d’Argentine, qui, sous une forme parfois maladroite, exhume les ombres d’une tragédie française. Point n’est besoin d’être grand clerc pour saisir que cette œuvre, malgré ses oripeaux tapageurs, touche une corde sensible : celle d’une nation confrontée à ses propres contradictions, où la gloire d’un homme peut longtemps masquer ses turpitudes.
Car Bertrand Cantat, jadis héraut du rock hexagonal et porte-parole de toutes les obsessions de la gauche culturelle, n’est plus seulement ce chantre révolté dont les vers enfiévraient les âmes ; il est l’auteur d’un crime qui, en 2003, ôta la vie à Marie Trintignant, et dont les échos, plus de vingt ans après, continuent de hanter notre mémoire collective.
Le mérite premier de ce documentaire, grâce à un montage percutant, réside dans sa capacité à exhumer des archives dont la force brute désarçonne celui qui est habitué au secret des pièces des dossiers d’instruction français. On y découvre, entre autres, les audiences lituaniennes où Cantat, face à la justice, mime avec une froideur mécanique les gestes qui brisèrent l’existence de l’actrice. Ces images, inédites pour beaucoup, s’impriment dans l’esprit comme un fer rouge. D’autres séquences, plus familières, ravivent des débats d’antan : qui ne se souvient de la vaillante Lio, sur le plateau d’Ardisson, tenant tête à une romancière éprise de chimères, venue parer le crime de Cantat des atours fallacieux d’un « amour fatal » ? À ces voix s’ajoutent des témoignages oubliés, tel celui d’un plumitif des Inrocks, jadis prompt à travestir la victime en femme légère pour mieux absoudre son bourreau. Autant de fragments qui, réunis, composent le portrait d’une époque où les mots peinaient à nommer l’innommable.
Ce qui frappe, en revisitant cette affaire, c’est le gouffre qui sépare l’hier de l’aujourd’hui. En 2003, le terme « féminicide » n’avait heureusement pas encore pris racine dans notre lexique ; on parlait d’« accident », de « drame passionnel », comme si la violence pouvait se draper de poésie. La série, en déroulant vingt années de controverses, montre combien le regard a changé – ou du moins, combien il s’est affiné. Pourtant, une question demeure : ce progrès est-il également partagé ? Les médias, prompts à se parer de vertu, n’ont-ils pas leurs propres œillères ? Car il faut bien le dire : l’indulgence dont jouit Cantat, hier comme aujourd’hui, doit beaucoup à son aura d’artiste « engagé ». Sur les réseaux, notamment sur X, nombreux sont ceux qui rappellent que ses prises de position à gauche, son verbe contestataire, lui ont valu un brevet d’honorabilité, un sauf-conduit moral dont d’autres, moins alignés, n’auraient jamais bénéficié. À droite, point de quartier : un faux pas, et l’opprobre est immédiat. À gauche, il semble que l’on puisse choir bien bas avant que la vindicte ne s’éveille.
L’affaire Cantat, c’est aussi celle d’un mythe tenace, celui du génie maudit, dont les débordements seraient le prix de son talent. Ce fantasme, la série le dissèque avec une acuité rare, montrant comment il a perduré, même après la prison, même après la mort de Krisztina Rady, épouse du chanteur, retrouvée pendue en 2010 dans des circonstances troubles. Les messages laissés par cette dernière, empreints d’une détresse poignante, résonnent comme un cri que trop peu ont entendu. Et pourtant, en 2018, un festival normand osait encore célébrer Cantat comme un « poète sombre », comme si la scène pouvait tout absoudre. Ce deux poids, deux mesures, qui excuse l’un et fustige l’autre, n’est-il pas le reflet d’une France où l’idéologie, plus que les faits, dicte encore les jugements ?
En somme, le Cas Cantat n’est pas qu’un documentaire ; c’est un miroir tendu à notre société, où se reflètent nos failles et nos combats. Il rappelle que la vérité, si elle finit par éclore, le fait souvent au prix d’un long labeur. Et si l’esthétique de l’œuvre peut parfois rebuter, son souffle, porté par des témoignages d’une rare intensité, emporte l’adhésion. À nous, désormais, de ne point détourner les yeux.
Balbino Katz
Crédit photo : DR (réalisée par l’IA)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine





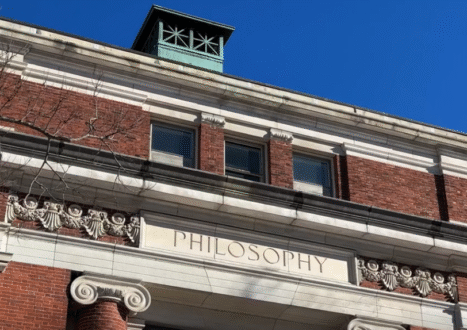

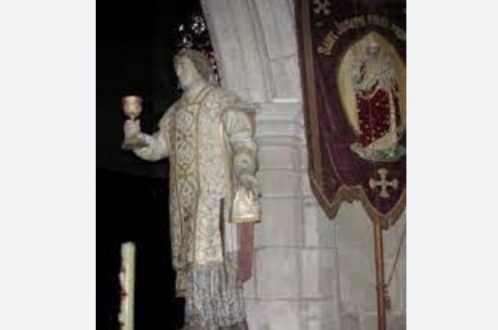

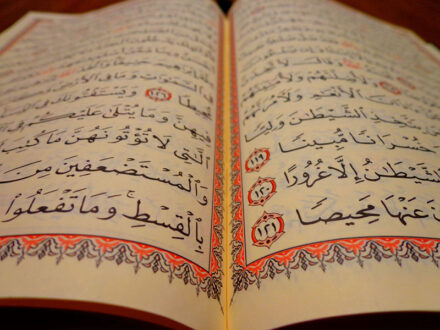


Une réponse à “De l’idole à l’assassin : le miroir trouble de l’affaire Cantat”
je regarde ce salopard et je trouve qu’il a une tete de tueur !