C’était un après-midi de décembre 1993, à Santiago du Chili, où je me trouvais en voyage de noces, mon regard s’attarda sur un livre à la couverture bigarrée posé dans une vitrine du quartier de Providencia. Son titre,Pantaleón y las visitadoras, m’intrigua. Le nom de l’auteur, Mario Vargas Llosa, m’était encore inconnu. Je ne savais pas encore qu’avec ce roman burlesque et dérangeant, satire cocasse d’un capitaine de l’armée chargé d’organiser un service de prostituées pour les soldats isolés dans la jungle amazonienne, j’ouvrais la porte d’une œuvre aussi foisonnante qu’essentielle. On en tirera deux adaptations filmées : l’une, péruvienne, en 1975 ; l’autre, hispano-péruvienne, en 2000, avec Angie Cepeda dans le rôle d’une des sulfureuses visitadoras. Ce fut le début d’une fidélité de lecteur qui ne se démentit jamais.
Mario Vargas Llosa est mort à Lima, la Ville des rois, entouré des siens, à l’âge de 89 ans. Il laisse derrière lui une œuvre monumentale et, plus encore, un certain style de parole, à la fois nette, rigoureuse et inspirée, qui en faisait, sinon un prophète, du moins une figure tutélaire pour tous ceux qui croient encore aux vertus civilisatrices du verbe. C’est à juste titre qu’il fut admis, en 2023, sous la coupole de l’Académie française, en dépit du fait — ou peut-être à cause du fait — qu’il n’écrivit jamais une ligne dans la langue de notre puissant voisin. Car c’est bien l’universalité de sa pensée et de son magistère qui furent reconnus ce jour-là, plus que l’usage du français.
Vargas Llosa n’était pas seulement un romancier exceptionnel. Il fut aussi un des derniers grands hommes de lettres à faire de la parole publique un acte de civilisation. Ceux qui, comme moi, l’entendirent discourir à Cordoue, en Argentine, en 2019, en présence du roi d’Espagne et du président Macri, ne peuvent avoir oublié l’élévation de ton, la clarté des idées, et cette façon singulière de faire de la culture ibérique non pas une identité mais un horizon.
Né en 1936 à Arequipa, au Pérou, le jeune Mario, formé dans une école militaire qu’il décrira plus tard dansLa ville et les chiens, appartint au célèbreBoom latino-américain, aux côtés de García Márquez, Fuentes et Cortázar. Il se distingua pourtant de ses pairs par une forme d’exigence intellectuelle, un refus du folklore magique qui charmait tant les lecteurs occidentaux. Là où ses confrères peignaient des mondes oniriques, Vargas Llosa disséquait l’autoritarisme, les hypocrisies sociales, les mirages révolutionnaires.Conversation à La Catedralreste à cet égard son chef-d’œuvre, portrait saisissant d’un pays en déliquescence morale, dominé par la dictature militaire d’Odría. Plus tard, dansLa guerre de la fin du monde, il s’attaquera à l’un des épisodes les plus tragiques de l’histoire brésilienne : la révolte de Canudos.
Mais il n’était pas homme à se cantonner à la fiction. Libéral convaincu, lecteur de Popper et d’Hayek, adversaire résolu de tout collectivisme, il se présenta en 1990 à la présidence du Pérou. Il fut défait par Fujimori, ce qui, à long terme, servit sa réputation plus que ne l’aurait fait une victoire. Ayant goûté aux servitudes du pouvoir, il se retira dans le royaume plus noble, et plus exigeant, des idées. Il y resta fidèle, usant de sa plume comme d’un glaive, et ne cessa d’intervenir dans le débat public par ses essais, ses chroniques, ses engagements.
En 2010, il reçut le prix Nobel de littérature. La formule consacrée de l’Académie suédoise — « pour sa cartographie des structures du pouvoir et ses images mordantes de la résistance de l’individu, de sa révolte et de sa défaite » — dit tout. Le pouvoir, chez lui, n’est jamais une abstraction : c’est une machine implacable, qui broie les hommes et abîme les âmes. Et pourtant, l’individu y résiste, par la beauté, par le désir, par la langue.
On eût pu croire qu’un tel homme se serait figé dans la solennité. Il n’en fut rien. Vargas Llosa fut aussi, dansLa tante Julia et le scribouillard, un amoureux drôle et léger, un chroniqueur plein de tendresse de ses propres folies de jeunesse. SonMéchante fille(2006) offre une autre image de lui : celle d’un homme blessé, tiraillé entre passion et lucidité, entre illusion et acceptation.
Qu’un tel auteur ait été reçu à l’Académie française, au terme d’une vie sans compromission, sans clientélisme, est une bonne nouvelle pour la République des lettres. Qu’il ait su, jusqu’au bout, conjuguer l’érudition, la clarté, la civilité du débat et l’élégance du style, c’est une leçon pour tous.
Dans une interview à la BBC en 2019, il déclara : « J’aimerais que la mort me surprenne en train d’écrire, comme un accident. » Il est mort, certes, mais son œuvre parle encore. Elle enseigne, elle interroge, elle console. Et dans un monde qui ne cesse de piétiner la parole, sa voix demeure, droite, libre et haute, comme un rappel à l’ordre de l’intelligence.
Sa mort laisse un vide, non pas seulement dans les lettres hispaniques, mais dans ce que la littérature a de plus noble : la capacité à dire l’homme dans sa grandeur et ses misères. À l’heure où tant de plumes se contentent de caresser les foules ou de flatter les puissants, Vargas Llosa rappelait qu’écrire, c’est défier le réel, le réinventer, le faire plier sous le poids d’une phrase juste. Il n’est plus, mais ses livres, eux, continueront de murmurer à l’oreille de ceux qui savent écouter. Et pour moi, qui garde en mémoire ce premier éclat de rire devant Pantaleón, il restera l’homme qui fit danser les mots comme on fait danser les étoiles.
Balbino Katz
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine






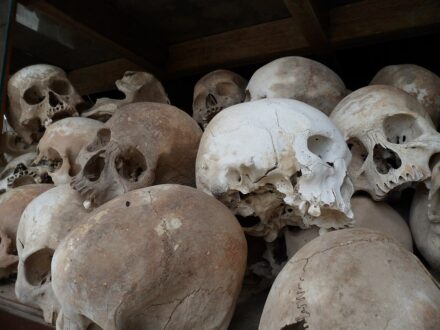





Une réponse à “Mario Vargas Llosa ou la noblesse des lettres”
Un grand « Merci » pour ce très bel article !
Isabelle