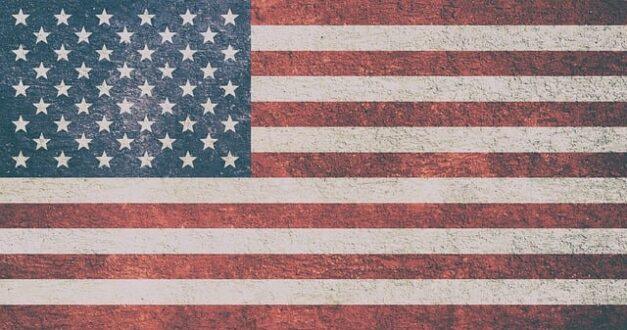Une nouvelle étude scientifique, publiée dans la revue Science, met en lumière un lien inquiétant entre la consommation excessive d’acides gras oméga-6 – présents notamment dans certaines huiles végétales courantes – et la croissance accélérée d’un sous-type particulièrement agressif de cancer du sein : le cancer triple négatif.
Un acide gras en question : l’acide linoléique
Les chercheurs se sont intéressés à l’acide linoléique, un acide gras oméga-6 présent en forte concentration dans des huiles largement utilisées en cuisine industrielle, comme l’huile de soja, de maïs ou de tournesol. En nourrissant des souris avec un régime riche en cet acide gras, ils ont observé une activation d’un mécanisme biologique favorisant la croissance des tumeurs.
Ce mécanisme implique une protéine appelée FABP5, dont le taux s’est révélé élevé chez les animaux nourris à l’acide linoléique. Cette protéine est connue pour être liée à la progression des cancers du sein triple négatif, une forme particulièrement résistante aux traitements classiques. Les chercheurs ont confirmé ces observations en retrouvant des taux élevés de FABP5 et d’acide linoléique dans les tumeurs et les échantillons sanguins de patientes récemment diagnostiquées.
Une tendance préoccupante
Si le taux global de cancers du sein tend à diminuer, les cas de cancers triple négatif, eux, progressent. Cette forme représente environ 10 à 15 % des cancers du sein et touche particulièrement les femmes jeunes et les femmes noires. Son agressivité et l’absence de traitement ciblé en font un sujet de recherche prioritaire.
Selon le professeur John Blenis, de la faculté de médecine Weill Cornell et coauteur principal de l’étude, ces résultats « apportent un éclairage nouveau sur l’impact des graisses alimentaires dans le développement du cancer », tout en suggérant des pistes pour des recommandations nutritionnelles plus personnalisées à l’avenir.
L’explosion des oméga-6 dans l’alimentation moderne
L’acide linoléique n’est pas en soi un poison. Il s’agit d’un acide gras essentiel, que le corps humain ne peut pas produire lui-même, et qui joue un rôle dans la croissance cellulaire. Toutefois, sa consommation a explosé depuis les années 1950 avec l’usage massif des huiles de graines bon marché dans l’industrie agroalimentaire.
Selon plusieurs nutritionnistes interrogés, les déséquilibres alimentaires actuels sont préoccupants : le régime occidental typique comporte jusqu’à 25 fois plus d’oméga-6 que d’oméga-3, des acides gras aux propriétés anti-inflammatoires. Ce déséquilibre pourrait contribuer à des phénomènes inflammatoires chroniques, terrain favorable au développement de nombreuses pathologies, dont certains cancers.
Recommandations alimentaires
Face à ces constats, les chercheurs et nutritionnistes appellent à une modération dans la consommation des huiles végétales industrielles. Voici quelques conseils pratiques :
- Réduire la consommation de produits transformés et ultra-transformés, principaux pourvoyeurs d’oméga-6.
- Privilégier des huiles comme l’huile d’olive ou l’huile d’avocat pour la cuisson.
- Augmenter l’apport en oméga-3, via la consommation de poissons gras (saumon, sardine, maquereau), d’œufs de plein air ou de viande issue d’animaux nourris à l’herbe.
- Envisager la supplémentation en oméga-3 (sous avis médical).
L’équipe du professeur Blenis prévoit de poursuivre ses travaux, notamment en étudiant le rôle du couple acide linoléique/FABP5 dans d’autres maladies, telles que le diabète ou l’obésité. Ils suggèrent aussi que FABP5 pourrait devenir un biomarqueur important pour orienter les choix thérapeutiques et nutritionnels, en particulier pour les patients atteints de cancer triple négatif.
Cette étude pionnière met en lumière un lien biologique précis entre alimentation moderne et pathologies graves. Elle pourrait marquer un tournant dans la manière dont la nutrition est intégrée aux stratégies de prévention et de traitement des cancers.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine