En 1823, le cinquième président des Etats-Unis James Monroe précise devant le Congrès américain les fondements de ce que doit être la politique étrangère américaine. Plus connue sous le nom de « doctrine de Monroe », cette déclaration peut se résumer ainsi :
– Le sol du continent Nord-américain appartient aux Américains et aux Américains seuls. Ceux-ci s’engagent à ne pas se mêler des affaires des pays européens.
– Les pays européens, en retour, ne doivent plus se mêler des affaires des Américains.
– Toute ingérence européenne dans les affaires américaines sera considérée comme un « casus belli ».
Une évolution continue vers l’impérialisme américain
Depuis 1823, la politique étrangère américaine a beaucoup évolué. En 1901, l’amendement Platt venait justifier la guerre Hispano-Américaine de 1898 pour le contrôle de Cuba. Puis ce fut l’envoi de troupes américaines en France en 1917 et enfin, avec la création du CFR (Council on Foreign Relations) une inflexion de la politique étrangère américaine de plus en plus « mondialiste ».
Pourtant, la majorité du peuple américain n’avait pas suivi cette évolution. Il en résultat l’échec de la SDN (Société Des Nations), ancêtre de l’ONU de 1946 et il fallu le choc de Pearl Harbour pour que les Etats-Unis puissent entrer dans la seconde guerre mondiale.
Toutefois, c’est à la fin de la guerre que cette inflexion impérialiste est clairement apparue. Première puissance économique et militaire, les accords de Bratton Woods ont consacré le dollar, monnaie domestique américaine, comme monnaie internationale. Tant que ce dernier était adossé à l’or, il n’y avait pas de problème, à condition que cette parité soit effective.
Déja sujette à interrogation dès les années soixante, cette convertibilité en or a disparu le 15 août 1971, faisant du dollar une monnaie purement fiduciaire. John Connolly a dit « le dollar est notre monnaie et votre problème » à ceux qui se plaignaient de cette situation.
Une hégémonie mondiale assumée
Les cinq décennies qui suivirent furent celles d’une « pax americana » qui consacra une domination sans partage sur le reste de la planète. La disparition de l’URSS en 1991 aurait dû logiquement entraîner la fin de l’OTAN mais la tutelle américaine qui, malgré de fragiles apparences destinées à faire croire que les prises de décisions étaient collégiales, en a décidé autrement. Le président HG Bush a même émis l’idée en 1991 que l’OTAN avait vocation à devenir « le gendarme du monde ».
C’est ainsi que l’OTAN intervint dans les Balkans en 1999.
Les années 2000 furent marquées par un interventionnisme qui entraîna de nombreuses guerres dans l’Ouest de l’Asie, écornant singulièrement l’image du « grand frère » américain.
Le tournant de la guerre en Ukraine
Un autre mode, déjà utilisé dans les années 1970 notamment en Amérique du Sud, refit son apparition dans l’Est de l’Europe au début des années 2000. Plutôt qu’intervenir militairement, la diplomatie de l’Etat profond américain renoua avec l’agitation des foules.
Appliquant quasi à la lettre les « recettes » développées par Zbignew Brzezinski dans son livre « le grand échiquier » ce furent la Géorgie puis l’Ukraine qui furent choisies comme terrain de jeu dans le but de les faire entrer dans l’OTAN et probablement ensuite dans l’Union Européenne.
Cette politique du « containment » allait, tôt ou tard, conduire la Russie à réagir. L’apparente paix de 2014 après le référendum de Crimée s’est peu à peu transformée en guerre de représailles menée par l’armée ukrainienne contre les populations russophones du Donetsk et de Lougansk.
La suite est connue et, depuis février 2022, c’est une véritable guerre de haute intensité qui oppose en apparence la Russie et l’Ukraine mais qui, dans sa réalité est une guerre par procuration entre la Russie et l’OTAN. Cette guerre a également été un véritable révélateur aux yeux du monde d’une autre organisation mondiale avec un monde « multipolaire ».
L’élection de Donald Trump ouvre une nouvelle ère
Elle se produit dans un contexte planétaire très particulier. Le monde des puissances maritimes qui a régné depuis la fin du XVème siècle est en train de s’estomper pour laisser la place aux puissances continentales. Le transport maritime gràce auquel les échanges commerciaux de toute nature avaient pu se réaliser, enrichissant ceux qui contrôlaient les voies de navigation, est aujourd’hui concurrencé par les transports terrestres qui se développent à l’intérieur des continents.
Le monde est en train de se réorganiser sous la pression de nouvelles puissances industrielles et économiques alors que les puissances commerciales et financières qui le dirigeaient n’entendent pas se voir déposséder de ce qui a fait leur richesse et en particulier celles qui, jusqu’à présent, ont utilisé la puissance américaine pour imposer leur loi.
Ce monde « globalisé » qui devait se doter d’un gouvernement mondial est contesté aujourd’hui par de nombreux pays qui sont en trai d’opter pour un monde « multipolaire ». Les pivots de ce nouveau monde seront les continents et les peuples qui ont formé les nations de ces continents tiennent à garder leur souveraineté.
A différentes reprises, Donald Trump a exprimé son intention de combattre les « mondialistes » et en particulier tous ceux qui, notamment à Washington, défendent ce projet d’un monde global.
Au début de son premier mandat, en s’exprimant devant l’Assemblée générale des Nations Unies le 19 septembre 2017, il déclarait :
« Pour surmonter les périls du présent et concrétiser la promesse de l’avenir, nous devons d’abord nous fonder sur la sagesse du passé. Notre succès dépend d’une coalition de nations solides et indépendantes qui s’appuient sur leur souveraineté pour promouvoir la sécurité, la prospérité et la paix, pour elles-mêmes et pour le monde.
Nous n’attendons pas que des pays divers partagent les mêmes cultures, les mêmes traditions, les mêmes systèmes de gouvernement. Mais nous attendons que toutes les nations respectent ces deux devoirs souverains : respecter les intérêts de leur propre peuple et les droits de toutes les autres nations souveraines. Voilà la très belle vision sur laquelle est fondée cette institution, et c’est la base de la coopération et du succès.
Les nations fortes et souveraines font que des pays divers, avec des valeurs différentes, des cultures différentes et des rêves différents, peuvent non seulement coexister mais aussi travailler côte à côte sur la base du respect mutuel.
Les nations fortes et souveraines permettent à leur peuple de prendre son avenir en main et d’être maître de son destin. Et les nations fortes et souveraines permettent à tout un chacun de s’épanouir et de connaître toute la richesse de la vie envisagée par Dieu »
Bien sûr, il a pu changer d’avis. Certains pensent même qu’il a pu « payer sa cotisation » à l’État profond pour être réélu. Tout est possible mais cela paraît peu probable.
Tout porte à croire aujourd’hui qu’il est sur la même ligne. Son désir d’augmenter la superficie des États-Unis en annexant le Canada et le Groenland au Nord et se réapproprier le canal de Panama au Sud ne correspond aucunement à une vision mondialiste d’un monde globalisé sans frontières.
Cette façon de procéder est typiquement dans l’esprit de la « doctrine de Monroe » évoquée plus haut. De même que le slogan « MAGA » (Make America Great Again) en est une référence évidente. Il veut superposer la nation américaine sur le continent Nord Américain.
Or, rappelons-nous que le principal obstacle à la vision mondialiste de l’État profond à toujours été l’isolationnisme américain qui était le corolaire de cette doctrine. Tout ceci suggère que la politique de Trump, au travers de sa lutte contre l’Etat profond américain, pourrait bien se révéler compatible avec ce projet de monde multipolaire qui regroupe de plus en plus de pays. Déjà, ce sont plus de 80% de la population mondiale qui est concernée, et Donald Trump ne peut l’ignorer.
Ce retour sur les « murs porteurs » de la politique américaine et l’évident désir de Donald Trump de faire de la nation américaine la première nation du monde montrent que les partisans d’un monde global et monopolaire vont avoir quelques difficultés pour parvenir à leurs fins.
Jean Goychman
Crédit photo : Gage Skidmore from Peoria, AZ, United States of America/Wikimedia (cc)
[cc] Breizh-info.com, 2025, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine







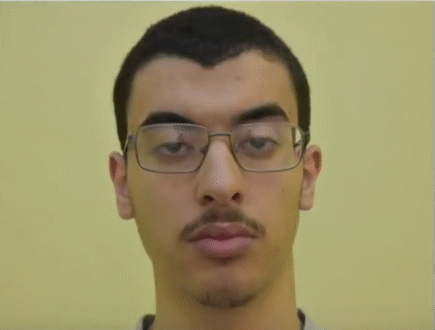

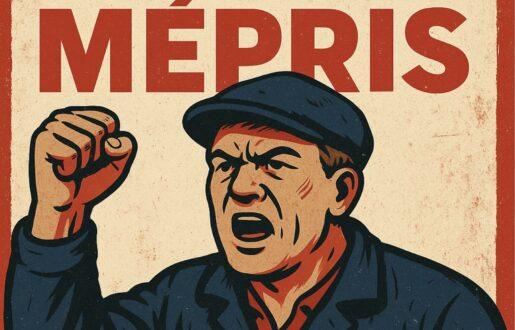


13 réponses à “Donald Trump revient sur les fondamentaux américains”
« Toute ingérence européenne dans les affaires européennes sera considérée comme un « casus belli » »
‘affaires américaines’, je suppose ?
Mais aujourd’hui, à la différence de 1850, toute l’Europe, toute l’Amérique du Nord, presque toute l’Amérique du Sud, l’Australie et la nz et une partie de l’Asie sont des colonies US. Et ne semble avoir aucune autre ambition.
Si le continent appartient aux américains… pas de souci: dehors, la wasp!
Oups!!!
Merci Luc Secret. Bien sûr, il faut lire « affaires américaines »
Toutes mes excuses
Dans le cadre d’un projet mondialiste, cet impérialisme américain était logique.
Trump clame haut et fort son attachement à la souveraineté des nations.
Les premiers jours de son mandat nous montreront ce qu’il en est.
« L’Imperialisme US » a toujours existé. Et tout autant les idées expansionistes Russes, que chinoises, qu’Arabes, ou encore Gauchistes, de nos jours.
Dans le cas present, l’idee de Trump est de sauvegarder les intérêts US, et raffermir les protections de la Nation Americaine.
Concernant Panama, il est certain que de nos jours son canal devient presque une propriété chinoise de par la presence d’une multitude de bateaux chinois (Aussi bien commerciaux que pecheurs). Or le canal a été construit avec l’aide financiere US, et la zone du Canal (Une bande 10 kilometres de chaque bord du Canal est encore et toujours sous les ordres de panaméens pro-US.
En revanche, le Groenland ne sera pas englouti dans les machoires US (Il est sous tutelle du Danemark) mais il est presque certain que vue l’expansionisme chinois dans le monde, l’Etat US fera tout son possible pour garder cette île primordiale pour la sauvegarde US, sous son aile, et en faire même un domaine « Chasse-gardé » contre les convoitises chinoises, Russes ou autres.
Enfin, pour ce qui est du Canada, il faut tenir compte que le pays est partagé de manière linguistique en deux parties, l’Anglaise (La majorité) et Francaise (Le Quebec). Si effectivement il existe un « vouloir canadien » envers le Voisin US, il s’agit de la partie anglaise du pays. En revanche le Quebec n’acceptera jamais l’ingérence US sur ses terres.
A cet egard et conconcernant le Canada, pays que je connais bien pour y habiter six mois de l’année, je peux dire que si les US tentent de s’accaparer le Canada, en dernier ressort le Quebec se tournera vers l’Europe et demandera son aide, car jamais, au Grand Jamais, les Quebecois n’accepteraont la suprematie US sur leur pays.
Comme vous le dites justement, « Depuis 1823, la politique étrangère américaine a beaucoup évolué ». Ni la doctrine Monroe édictée par un président en 1823 ni la théorie du « Grand échiquier » présentée par un universitaire en 1997 n’ont plus guère de portée aujourd’hui. A propos de la seconde, il est bon de rappeler qu’elle a été avancée par un intellectuel sans expérience pratique du pouvoir, hormis quelques années comme conseiller de Jimmy Carter à la fin des années 1970, et qu’au-delà de son grand succès de librairie initial, elle n’a jamais eu de postérité : ni les politiques, ni les théoriciens des relations internationales n’en ont fait une référence capitale. Les seuls à la ressasser jusqu’à plus soif sont les théoriciens cherchant à légitimer la guerre menée par Poutine en Ukraine ! Google Trends est instructif à cet égard : presque complètement oublié dans au début de ce siècle, « le Grand échiquier » a recommencé à faire l’objet de recherches en ligne depuis 2019 seulement…
Il ne faut rien exagérer : le transport maritime reste essentiel, ne serait ce que depuis les Amériques vers le reste du monde. Sans compter des cas plus modestes mais qui semblent devenir de plus en plus importants, comme l’Australie ! De plus, le moins que l’on puisse dire est que l’extension des transports terrestres entre la Chine et l’Europe? Russie comprise, restent pour le moment laborieux.
Réponse à Gaî de Roparz, un sondage effectué après la déclaration de Trump sur le Canada, a mesuré un peu plus de 10 %, l’intérêt des canadiens pour les usa. Il n’est donc pas sur, du tout, que les anglos accepterait l’abandon de leur souveraineté. Les canadiens sont fiers de leur pays. Je suis, par contre, d’accord pour ce qui concerne les Québécois, hormis un hypothétique rapprochement avec la France ou l’Europe. La langue est « commune » mais pas la culture. Le mode de vie est nord américain. Un Québec indépendant ne changerait en rien ce mode de vie hormis sur la gestion de l’immigration et l’utilisation du français. Je vis au Québec.
Cher Brun, le transport maritime est toujours le premier mode de transport en ce qui concerne le tonnage, mais les moyens et infrastructures terrestres vont progressivement diminuer son importance.
C’est tout l’enjeu des « belts and roads initiatives »qui s’étendre au bloc continental Eurasie-Afrique.
Il y a également un projet de tunnel entre la Sibérie et l’Alaska qui semble se préciser.
Visiblement, Trump veut faire exploser l’Union européenne mais en profiterons nous pour faire une Europe gaullienne de « l’Atlantique à l’Oural, voie Vladivostok?
@ Le guen : Je suis d’accord sur cette analyse personnelle, sinon que je vis en partie anglaise du Canada (Toronto) et pour les anglophones, entre une direction des affaires par un quebecois, ou un canadien de langue anglaise, en cas d’urgence (Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui) le choix est vite fait !…
Certes les anglos privilègeront toujours les anglos au détriment des québécois. C’est un peu comme en Belgique entre flamands et wallons, ou en Espagne entre basques, catalans et espagnols. C’est une cohabitation obligée. Néanmoins la condescendance des américains envers les canadiens, qu’ils considèrent comme des ploucs, est assez peu appréciée. Hormis une utilisation de la force, peu probable, je doute fort d’une adhésion des canadiens à une intégration aux usa.
En réponse à Gai de Ropraz et Leguen, je pense sérieusement que les Québécois sont beaucoup plus pro-américains que leurs compatriotes anglais, qui ont du repousser plusieurs tentatives de conquêtes par leurs voisins du sud. Les valeurs des canadiens anglais sont tellement différentes de celles américains qu’ils veulent justement s’en différencier, et que pour beaucoup ils ne voudraient être américains, pour rien au monde. Les Québécois, quand à eux se pensent protégés par leur langue, qui les différencie de leurs voisins du sud, mais ils sont beaucoup plus « woke » que leurs compatriotes anglais, et seraient plus favorables à une intégration aux USA. C’est ce que je remarque autour de moi. Je précise que je vis au Québec depuis 15 ans après avoir vécu à Toronto pendant aussi longtemps.