Pour Staline, l’antifascisme, le Front populaire de 1936 et la guerre d’Espagne furent de magnifiques opérations de propagande. Mise à plat des légendes lors d’un entretien entre Pauline Lecompte (La Nouvelle revue d’histoire) et Stéphane Courtois, auteur notamment du Livre noir du communisme. L’interview ci-dessous est extraite de la Nouvelle Revue d’Histoire n°42 (Juin 2009).
La Nouvelle Revue d’Histoire : Parmi les grandes questions de l’entre-deux-guerres, celle de la stratégie adoptée par Staline à l’égard du IIIe Reich, à partir de 1933, reste des plus troublantes. On songe bien sûr à la stratégie de l’antifascisme adoptée à partir de 1934, puis à l’incroyable retournement du pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Ma première question est donc : qu’est-ce qui coïncide, en 1934, Staline et le Komintern au choix d’une grande alliance antifasciste avec leurs anciens adversaires socialistes et « bourgeois » ?
Stéphane Courtois : La ligne «classe contre classe» d’opposition absolue aux autres partis de gauche— et en particulier aux socialistes qua-lifiés de «social-fascistes» — adoptée depuis 1928, fait place, en effet, en 1934, à une ligne tout à fait inverse. Celle d’une alliance avec les socia-listes. Dans le cas de la France, cette alliance s’étend même aux radicaux, le grand parti «bourgeois» de centre-gauche. S’agit-il d’un changement stratégique ou d’un changement tactique? Autrement dit, s’agit-il d’un choix à long terme qui modifie l’orientation générale du mouvement communiste? Ou bien s’agit-il d’une manoeuvre ponctuelle ne mettant pas en cause les grandes orientations, susceptible d’être abandonnée du jour au lendemain? Il est clair que l’alliance antifasciste, qui prendra dès 1935 le nom de «Front populaire», est d’ordre tactique, sur le modèle de ce que Lénine a fait en 1921 avec l’adoption de la NEP (nouvelle politique économique).
Il s’agissait d’un repli tactique pour éviter une catastrophe. Mais Lénine a été très clair: il ne s’agissait nullement de remettre en cause le pouvoir et le projet commu-nistes. Parallèlement à ce repli tactique, il a « resserré les boulons» au sein du parti bolchevique. C’est au cours de son Xème Congrès, en mars 1921, qu’après avoir annoncé la NEP, il a fait adopter l’interdiction des fractions et des oppositions à l’intérieur du parti. Sa crainte était que le repli tactique face à la société n’entraîne un repli idéologique chez les cadres communistes. La même chose va se produire à partir de 1934. Devant l’arrivée d’Hitler au pouvoir, le succès imprévu des nationaux-socialistes et l’élimination du Parti communiste allemand (1CPD), Staline s’est trouvé devant une situation nouvelle qu’il a jugée périlleuse. Face à la montée en puissance de la nouvelle Allemagne, il a décidé de se rapprocher diplomatiquement de la France.
NRH : Vous semblez dire que Staline avait mésestimé la capacité d’Hitler avant de s’imposer en Allemagne ?
SC : Parfaitement. Staline s’était tout d’abord félicité de l’arrivée d’Hitler au pouvoir. Il était convaincu que les nationaux-socialistes con-naîtraient un échec rapide permettant au KPD de s’emparer du pouvoir. Mais les choses ne se sont pas passées ainsi. Il faut se souvenir que, pour Staline comme jadis pour Lénine, l’Allemagne était un enjeu essentiel. Les dirigeants bolcheviques étaient convaincus que s’ils s’emparaient de l’Allemagne, toute l’Europe bascu-lerait dans la révolution. Mais maintenant que la carte du KPD était perdue et que s’affirmait une Allemagne violemment anticommuniste, Staline pouvait s’inquiéter. Il a donc décidé de se rapprocher de la France dans le cadre d’un système d’alliance des plus classiques.
NRH : Qu’en était-il à cette époque des relations entre l’URSS et la France ?
SC : Jusque-là, elles n’avaient pas été bonnes. Mais, comme la France s’inquiétait aussi de ce qui se passait en Allemagne, par un mouvement quasi automatique, elle va souhaiter également se rapprocher de l’URSS, réminiscence de l’alliance franco-russe d’avant 1914.En 1933, Édouard Herriot,principal leader du parti radical, effectue une visite officielle en URSS dont il revient enthousiaste. Et le 2 mai 1935, Pierre Laval, président du Con-seil, est à Moscou pour signer un traité franco-soviétique. À la faveur de cette situation nouvelle, Staline met au point une magnifique opération de propagande qui se concrétisera en 1936 avec le Front populaire, ouvrant la France à l’influence communiste.
La Nouvelle Revue d’Histoire : Parmi les grandes questions de l’entre-deux-guerres, celle de la stratégie adoptée par Staline à l’égard du IIIe Reich, au début de 1933, reste des plus troublantes. On songe bien sûr à la stratégie de l’antifascisme adoptée à partir de 1934, puis à l’incroyable retournement du pacte germano-soviétique du 23 août 1939. Ma première question est donc : qu’est-ce qui coïncide, en 1934, Staline et le Komintern au choix d’une grande alliance antifasciste avec leurs anciens adversaires socialistes et « bourgeois » ?
Stéphane Courtois : La ligne « classe contre classe », opposition absolue aux autres partis de gauche – en particulier aux socialistes, a été instaurée par le Komintern après le déclenchement de la crise sociale et fasciste, à partir de 1928 et ce jusqu’en 1934, avec les décrets de socialistes. Dans la classe contre classe, cette alliance est destinée à isoler les socialistes de leurs alliés « bourgeois » du centre-gauche. S’agit-il d’un changement de politique lié à une modification de l’analyse du fascisme par Staline et ses amis du Komintern ? Autrement dit, s’agit-il d’un choix à court terme pour créer une coalition antifasciste ? Staline l’annoncera de manière très claire : il s’agissait non pas de se remettre en cause en Europe, mais d’éviter que le pouvoir ne profite comme en Allemagne, à un parti communiste. En 1921, la NEP, la Nouvelle Politique Économique, introduite par Lénine après le désastre du « communisme de guerre », une politique qui maintenait une économie de marché limitée et introduisait certaines libertés économiques (par exemple, il s’agissait de lois sur le commerce intérieur et l’industrie). Staline et Lénine ont fait d’énormes concessions politiques, idéologiques, et économiques. C’est-à-dire, en vue de l’influence bourgeoise, ils ont arrêté la répression contre la révolution fasciste. Mais les masses laborieuses, c’est-à-dire les communistes, avaient du mal à comprendre la NEP. Il fallait des accords avec les socialistes et les anciens partisans de Lénine.
La Nouvelle Revue d’Histoire : À défaut de conquérir l’Allemagne, Staline a donc conquis la France ?
SC : De fait, la France a été le terrain d’expérience de la nouvelle politique de Front populaire amorcée dès le printemps 1934. La question d’une alliance éventuelle entre le PCF et la SFIO est posée après les émeutes gauche du 6 février 1934, que la interprète comme la preuve d’un danger fasciste.
Il existe à la base une demande d’unité d’action qui se concrétise lors des grandes manifestations du 12 février 1934. La difficulté, c’est l’absence de consignes de Moscou. C’est de là que naîtra la future exclusion de Jacques Doriot avec tout ce qui en découlera. C’est lui l’un des jeunes chefs du PCF et député-maire de Saint-Denis, qui a pris l’initiative de l’unité d’action avec les socialistes.
Par malheur pour lui, il était en avance sur les décisions de Moscou, ce qui sera très mal jugé par Staline. Sans compter une querelle de personnes qui l’opposait à Thorez, le secrétaire général du parti. Tous les deux ont été convoqués à Moscou. Mais Doriot, qui connaît les moeurs du sérail du Kremlin, se garde bien de faire le voyage. Thorez, en revanche, obtempère.
Le 11 mai 1934, le nouveau secrétaire général du Komintern, Georges Dimitrov, indique à Thorez la nouvelle orientation : rapprochement avec les socialistes. Le 23 juin 1934, la conférence nationale que le PCF tient à Ivry s’ouvre sur un rapport de Thorez. Rapport jugé trop frileux à Moscou. Un télégramme ordonne immédiatement à Thorez d’aller plus loin. La conférence est prolongée d’une journée et, le 26 juin, Thorez présente un nouveau rapport qui propose à la SFIO une alliance en bonne et due forme, assortie d’une ouverture vers les classes moyennes et d’un discours patriotique inédit. Le tout débouche sur le pacte d’unité d’action d 25 juillet, prélude au Front populaire de 1935
La Nouvelle Revue d’Histoire : Comment se traduit cette nouvelle politique d’unité d’action antifasciste ?
SC : À l’occasion des élections cantonales de l’automne 1934, Thorez propose aux socialistes, mais également aux radicaux, un accord de désistement au second tour. Cet accord vaudra un gros succès électoral aux communistes. Néanmoins, Moscou s’inquiète de l’ampleur de l’ouverture faite aux radicaux par Thorez, qui est donc de nouveau convoqué à Moscou.
La Nouvelle Revue d’Histoire : Que se passe-t-il alors?
SC : Lors de mes recherches à Moscou dans les archives du Komintern en 1992, j’ai retrouvé le sténogramme du rapport de Thorez, le 3 décembre 1934, devant le Comité exécutif du Komintern et le représentant de Staline, Dimitri Manouilski. Thorez, qui avait un sens politique incontestable et qui connaissait bien les règles du jeu stalinien, y présente un rapport fort intelligent que j’ai publié dans la revue Communisme (n° 67-68, 2001). Il est si convaincant que la politique qu’il préconise est bientôt adoptée avec l’approbation personnelle de Staline. Cette po-litique va trouver sa confirmation lors du VIIème Congrès du Komintern à Moscou en juillet 1935, où, porte-parole de Staline, Dimitrov explique que, désormais, face à la «contre-révolution fasciste», les « masses laborieuses », c’est-à-dire les communistes, doivent s’entendre avec «la démocratie bourgeoise». Le revirement est total.
La Nouvelle Revue d’Histoire : Dans la pratique, comment ce changement de ligne va-t-il se traduire en France ?
SC : Cela débouche sur la politique dite du Front populaire avec, notamment, des accords électoraux pour les élections législatives de 1936, qui se traduisent par un immense succès pour le PCF. Il passe de 10 à 72 députés. Cette énorme progression s’accompagne de très importants succès sur le plan syndical. Avant même les grandes grèves de mai-juin 1936, les communistes ont obtenu la réunification syndicale au sein d’une seule CGT et une partie des postes de direction. Lors des grèves, ils se montrent les plus dynamiques chez les gros bataillons des OS de la métallurgie, de la chimie et du bâti-ment. La grande question, qui se posait après le succès électoral de 1936, était de savoir si les communistes allaient participer ou non au gouvernement de Front populaire formé par Léon Blum. Les archives que j’ai découvertes à Moscou prouvent que toute la politique du PCF a été dirigée de bout en bout par Moscou. Lors d’une réunion du Komintern, et en l’ab-sence de responsables du PCF — à l’exception d’Eugen Fried, le représentant du Komintern en France —, il a été décidé que les communistes ne participeraient pas au gouvernement Blum. Par contre, ils devaient revendiquer «le ministère des masses», c’est-à-dire la liberté de faire pression sur le gouvernement par la rue et par la grève.
La Nouvelle Revue d’Histoire : De cette façon, les communistes ne se trouvaient pas compromis par le pouvoir tout en tirant le maximum de dividendes du Front populaire.
SC: Exactement. Ajoutons que la politique d’union antifasciste a connu une amplification considérable à partir de juillet 1936 avec le début de la guerre civile en Espagne. À la demande de l’Angleterre, le gouvernement français adopte officiellement une politique de non-interven-tion. Les communistes peuvent alors se déchaî-ner sur le thème du soutien à la République espagnole. Ce sera un vecteur de propagande extraordinaire. Dès l’automne 1936, le PCF est chargé par le Komintern d’organiser les Brigades internationales, armée communiste en Espagne. D’ailleurs, toutes les archives des Brigades internationales sont à Moscou, avec les dossiers personnels des 35 000 brigadistes.
La plupart des volontaires sont passés par la France et les Pyrénées. Cette guerre d’Espagne a été pour les communistes, et dans le monde entier, un formidable vecteur de mobilisation antifasciste, et en faveur de la «démocratie», opération couro-née la même année par la promulgation de la «Constitution stalinienne», «la plus démocratique du monde».
Pourtant, là encore, Staline a appliqué le principe léniniste: alors qu’à l’exté-rieur il favorise une politique de large alliance, à l’intérieur, il met en oeuvre un totalitarisme de haute intensité. C’est en effet d’août 1936 que l’on peut dater le début de la Grande Terreur qui battra son plein en 1937, l’année terrible, et se poursuivra en 1938. En dehors des trois «grands procès de Moscou» – soigneusement mis en scène -, rien ne filtrera vers l’extérieur. Dans le cadre de ce que Nicolas Werth nomme des «grandes opérations terroristes secrètes», 700 000 victimes sont fusillées en quatorze mois et plus encore expédiées au Goulag.
Cette opération permet à Staline d’éliminer tous les opposants en puissance et de cimenter son pouvoir.
La Nouvelle Revue d’Histoire : Comment va-t-on arriver maintenant au pacte germano-soviétique du 23 août 1939?
SC: Pour comprendre cet événement considérable, il faut penser aux préoccupations de Staline devant la montée en puissance de l’Allemagne hitlérienne. Jusqu’au lendemain des accords de Munich de septembre 1938, Staline a vu que la politique allemande recevait le soutien implicite de l’Angleterre, sans que la France elle-même ne s’y oppose vraiment.
Il a donc le sentiment d’être isolé face à une Alle-magne toujours plus dangereuse. Pourtant, un basculement décisif se produit lorsque, le 15 mars 1939, Hitler occupe et démembre la Tchécoslovaquie. Ce coup de force, qui annule les accords de Munich, provoque un retournement instantané de l’opinion britannique et oblige les dirigeants de Londres à garantir les frontières de la Pologne, qui semble être la pro-chaine cible d’Hitler. Simultanément, face à ce danger, de façon très classique, les Anglais et les Français vont rechercher l’alliance de l’URSS. Staline comprend aussitôt qu’il devient l’ar-bitre de la politique européenne.
Face aux deux camps en présence, il fait monter les enchères en échange de son alliance. Il réalise vite que les Anglais et les Français ne lui accorderont pas grand-chose, alors que les Allemands peuvent lui apporter beaucoup. C’est ainsi qu’après une série d’approches secrètes, le ministre des Affaires étrangères allemand, Ribbentrop, se rend à Moscou le 23 août 1939. Le lendemain le monde entier apprend la nouvelle extraordinaire du pacte germano-soviétique, dit de «non-agression», signé en présence de Staline. Mais on ignore qu’il est assorti de protocoles secrets par lesquels Hitler et Staline se partagent l’Europe centrale et orientale.
Fort de cet appui, Hitler attaque la Pologne dès le 1″ septembre; et le 17 septembre, c’est l’Armée rouge, qui prend à revers l’armée polonaise
Le 28 septembre, l’Allemagne et l’URSS signent un « traité d’amitié et de délimitation des frontières». On a retrouvé dans les archives de Moscou la carte sur laquelle Staline et Ribbentrop ont délimité au crayon rouge la ligne de partage entre les deux puissances totalitaires. Staline s’empare de la moitié orientale de la Pologne, puis bientôt des États baltes et de la Bessarabie roumaine.
La Nouvelle Revue d’Histoire : Quels seront les conséquences du pacte au sein du Parti communiste français ?
SC : L’annonce du pacte provoque un véritable séisme politique et psychologique. Non seulement au sein du PCF, mais dans l’ensemble des milieux intellectuels et politiques qu’unissait l’antifascisme. Le PCF se vide de ses adhérents. Ne subsiste que le noyau dur de l’appareil. À la suite de l’interdiction du parti par le gouvernement Daladier, après l’entrée en guerre de la France, l’appareil passera dans la clandestinité. C’est lui qui permettra au parti communiste de se reconstituer au-delà de l’été 1941, après l’entrée en guerre de l’Allemagne contre l’URSS.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2024, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine



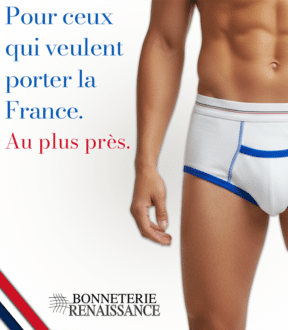











3 réponses à “Le jeu de Staline : de l’antifascisme au pacte Germano-Soviétique”
Voila un petit rappel historique qu’il est bon de publier à destination des « démocrates de gauche » , ceux qui nous parlent droits de l’Homme, Egalité et Fraternité …. Le « Drapeau Rouge » , organe du Parti Communiste Belge est le SEUL QUATIDIEN a avoir titré en première page : « Katyn, c’était bien le NKVD » tous les autres journaux ont fait l’impasse sur cette info de peu d’intérêt : 10 à 11.000 personnes assassinées individuellement , quelle importance . Vive la gauche !
La lute antifasciste n’a pas d’odeur , même pas celle d’une Vingtaine de millions de personnes, hommes ou femmes, assassinées pour motifs purement économiques cachés par des idéologies fumeuses… Staline était admiré par le front populaire, les Russes blancs assassinés en France l’étaient dans l’indifférence du pouvoir en place et des institutions … Vive le « Front populaire » et sa défense des droits de l’Homme !
chut, il ne faut pas dire la vérité historique qui peut choquer la bienpensance actuelle