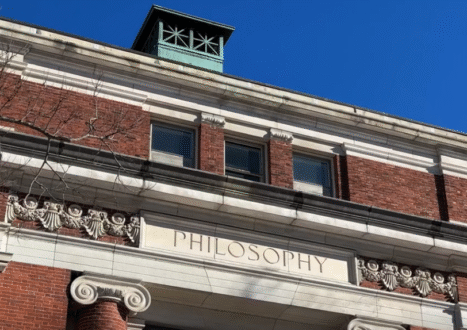En exil en Argentine de 1946 à 1969, le principal penseur du nationalisme breton du XXe siècle, Olier Mordrel, a vécu de près l’aventure du péronisme au pouvoir et sa chute brutale en 1955. De retour en Bretagne, il rédigera un texte fascinant sur l’Argentine et le péronisme, débutant avec la naissance du futur général Perón jusqu’à la chute de son second régime en 1976. Resté inédit à ce jour, son intérêt est d’autant plus grand que l’Argentine vient de connaître un spectaculaire bouleversement politique avec la fin du régime péroniste de gauche voici quelques semaines et l’arrivée au pouvoir de Javier Milail, un ultra capitaliste bien décidé à défaire tout ce que le péronisme a construit. Il est frappant de constater que la fin du régime péroniste originel du début des années cinquante et celle de celui instauré par la famille Kirchner entre 2003 et 2023 (avec un bref intermède libéral entre 2015 et 2019) se ressemblent comme deux gouttes d’eau.
Écrit en Europe, ce texte n’est pas celui d’un historien, mais plutôt celui d’un essayiste ne disposant que de ses souvenirs et de coupures de presse envoyées par sa fille Yola depuis Buenos Aires. Malgré quelques faiblesses historiographiques, ce texte demeure un puissant témoignage de première main sur le péronisme, écrit par un homme qui aurait logiquement dû le considérer avec bienveillance. Pourtant, la dure réalité de la vie d’un exilé à Buenos Aires lui a permis de vivre le péronisme non seulement de l’intérieur, mais aussi du plus bas de l’échelle sociale. Cette expérience lui a ouvert les yeux, lui faisant voir le régime dans toute sa triste réalité, et lui a fait percevoir l’influence délétère qu’il allait avoir sur le développement, ou plutôt le non-développement, de l’Argentine.
Nous l’avons découpé en plusieurs parties et vous proposerons, chaque jour jusqu’à sa fin, un épisode.
Le miracle de la fidélité
Dans le cœur des primitifs, le souvenir d’un grand chef ne meurt jamais. Pour les Argentins d’idiosyncrasie et de culture européenne, Péron était un démagogue extrêmement doué qui avait donné sa représentation et était sorti de la scène sous les quolibets et les tomates pourries.
Pour la chusma, cet immense peuple des campagnes et des faubourgs, à peine sorti de l’analphabétisme, ayant gardé quelque chose du psychisme tribal des Indiens, greffé d’une foi religieuse imbibée de superstitions païennes, Péron était Dieu sur terre et sa femme Evita, une incarnation de la Pacha Mama, la vierge Marie des Andes. Ils étaient entrés dans l’éternité et ni les dix-huit ans d’exil de l’un, ni la mort de l’autre n’y changeaient rien.
Parler de fascisme à ce sujet, condamner le «pouvoir personnel» au nom de la démocratie, c’est simplement se tromper de continent. Un homme, parmi des milliers d’autres, a incarné cette fidélité. A Rosario, on le nomme El Tula. Il avait 12 ans quand Péron disparut de la scène. Il n’a donc connu que sa légende et s’en est nourri.Il est passionné de football et il accompagne les fans de l’équipe locale dans tous ses déplacements, en tapant sur son bombo, la grosse caisse qui, en Argentine, donne le rythme des slogans scandés par la foule. Il faut avoir entendu, cent fois répété Si no somos el pueblo, el pueblo donde está ? « Si nous ne sommes pas le peuple, le peuple où est-il ?» clamé par mille et mille gorges, avec le «boum» d’une dizaine de bombos scandant chaque syllabe accentuée, pour avoir une idée de cet obsédant tam tam politique. Le Tula, si souvent en route avec sa caisse, est exemplairement pauvre. Il voyage sur le toit ou les marchepieds des wagons. Mais il n’a qu’un rêve, celui de faire entendre son bombo à au grand exilé. Dieu sait comment il parvient en Europe sans bourse délier, puis à Madrid où son rêve fou devient une réalité. Il est reçu par Péron lui-même, qui le serre dans ses bras défaillant d’émotion, écrasé par trop d’honneur, et lui offre une grosse caisse merveilleuse made in Germany. Après «le retour», le Tula sera de toutes les manifestations péronistes, au titre de bombo mayor, qu’il est inutile de traduire.
Jaloux de son apparence, Péron saura préparer sa rentrée en scène. Il subit par deux fois une intervention de chirurgie esthétique pour faire disparaître ses rides, avec le résultat, hélas inévitable, de crisper ses jeux de physionomie d’une manière désagréable. Il prend l’habitude de se teindre les cheveux en noir de jais. Il va faire un séjour en Roumanie, chez la célèbre doctoresse Aslan qui prétend posséder le secret du rajeunissement. Il essaie de compléter l’illusion en épousant sa maîtresse, une jeune femme ayant trente cinq ans de moins que lui, dans une tentative risquée de reconstituer le couple magique aux yeux de «son» peuple.
Il n’a aucun doute sur la fidélité des descamisados – version argentine de sansculotte – Il en a eu des preuves sans compter. Au même moment où étaient exposés publiquement à Buenos Aires les trésors accumulés par Evita et par lui, les ouvriers sucriers de Tucuman quêtaient de porte en porte pour envoyer à Péron de quoi «ne pas mourir de faim». Pour eux, les révélations faites sur sa fortune mal acquise était une invention diabolique de ses ennemis sans scrupules et la preuve de leur duplicité.
L’opération retour
Lanusse ne veut rien entendre d’un retour triomphal de Péron. Il est escamoté à son débarquement, tandis qu’un service d’ordre imperméable maintient la foule à distance. Chambré le vieil exilé que la loi n’autorise pas encore à poser sa candidature doit repartir. Il ne le fait pas sans avoir monté de main de maître une bonne machine qui assure une confortable victoire à son homme de paille, un fidèle éprouvé, Hector Campora. Le soir de son élection, on dansait dans les rues. Seuls les extrémistes n’ont pas avalé la couleuvre. Au cours des trois mois qui précèdent la remise des pouvoirs, ils multiplient leurs démonstrations de force, culminant avec l’asassinat de l’amiral qu’ils estiment responsable de la tuerie de Trelew.
Le 25 mai 1973, Lanusse s’efforçant de faire bonne contenance transmet à Campora l’écharpe présidentielle qu’il se destinait à lui-même, ayant à ses côtés les présidents du Chili et de Cuba, Allende et Dorticos, tout un symbole qui gèle la tribune officielle et suscite l’enthousiasme vociférant des 35 000 militants, parfaitement organisés des Jeunesses péronistes.
Les quinze jours qui suivent sont euphoriques, tout le monde est ami, il ne s’agit plus que de faire revenir Péron. Un crédit de 15 millions de dollars de la Banque interaméricaine de développement sert à commander un Boeing transcontinental, inspiré par celui du président des Etats-Unis, pour l’offrir à celui de l’Argentine. Hâtive flagornerie qui sèmera la consternation dans les milieux qui s’emploient à faire renaître la confiance internationale. La somme aurait suffi à reconstruire deux mille des trois mille écoles de campagne que traverse la pluie et le vent.
Le grand jour arrive. Péron revient, non pas en chef de parti, mais en chef d’un mouvement presqu’unanime et paradoxalement par les uns, comme le leader de la révolution prolétarienne, et par les autres, comme le bouclier providentiel contre ses violences.
Les précautions prises encore une fois contre une manifestation populaire aux conséquences imprévisibles n’empêchent pas une marée de deux à trois millions de personnes de se déverser sur l’aérodrome. Une fusillade d’origine confuse éclate, laissant sur le carreau treize morts et plus de trois cents blessés. L’avion est détourné. Le vieux chef, consterné, désavoue la manifestation et se range du côté de l’ordre.
La jeunesse péroniste ne comprend pas. N’est-ce pas lui qui depuis des années a nourri la guérilla de ses encouragements et de ses subsides ? S’il se prononce aujourd’hui contre le peuple en marche, n’est-ce pas qu’il est chambré par des fourbes qui lui cachent la vérité? Le 21 Juillet, quatre-vingt mille manifestants, en majorité des jeunes, se portent sur sa résidence «pour rompre l’encerclement». Péron ne peut pas ne pas recevoir une délégation. Mais il a pris la décision d’écarter du pouvoir une jeunesse qui «manque de maturité» et il renvoie au parti ses huit représentants au congrès. La violence a cessé de servir ses plans.
Comme prévu, Campora cédera son poste au patron, qui entre en fonctions après que de nouvelles élections présidentielles l’aient élu, avec une écrasante majorité. Dans l’espoir, bien ténu, de faire revivre le mythe d’Evita, il a fait passer sa troisième femme à la vice-présidence en lançant la marque Isabelita.

Olier Mordrel à Buenos Aires en 1947 devant la gare de Retiro et en arrière plan la Torre monumental, anciennement Torre de los ingleses.
Le second règne
Assagi, il semble que Péron ne se paie plus de mots. Il proclame son but: l’Argentine Puissance et fait adopter un plan triennal avec un mot d’ordre destiné à enfiévrer les imaginations: 250 millions de vaches, 200 millions de tonnes de blé, soit quatre fois ce qui existe. Pour bloquer l’inflation, il proclame le «pacte social» qui stabilise prix et salaires. Il a l’autorité pour l’ imposer. Malheureusement, pour servir ses plans subversifs, il s’est trop entouré d’éléments douteux depuis trop longtemps. Ils s’emparent de toutes les places et dilapident les dernières chances de relèvement du pays.
Dans cet ordre d’idées, le scandale du gouverneur de Corrientes fera date. A peine en place, il nommé sa femme ministre des Œuvres sociales, son frère président de la banque provinciale, il pousse son fils à devenir sénateur national et fait élire son gendre président de la chambre de députés provinciale. Bientôt il s’accorde à lui-même et aux entreprises qu’il contrôle le crédit astronomique de sept milliards de pesos; son frère dans sa propre banque s’en attribue un de quatre-cent vingt millions et la liste n’est pas close. La caisse étant vidée, la province doit solliciter un prêt du Trésor fédéral pour pouvoir payer ses employés. La dessus, le gouverneur menace les mécontents de poursuites pour diffamation s’ils continuent à protester.
Bafoué par ceux qui étaient chargés de le faire exécuter, le plan triennal reste au paradis des bonnes intentions et la situation ne cesse d’empirer. Pour mâter les syndicats, qui commencent à grogner, Péron inaugure de faire nommer à leur tête des hommes à lui. On voit un ministre, tomber la veste dans une réunion et proclamer aux délégués syndicaux que, content d’offrir sa vie pour Péron, il restera à ses côtés, «même si ce n’était que pour nettoyer ses cabinets.»
De nouveau, on essaie d’échapper aux réalités en se noyant dans un flot de paroles gratuites. Le président lui-même lâche les pédales, mais il a pour excuse d’avoir 78 ans. «L’heure des localismes cède le pas à la nécessité de nous continentaliser et de marcher vers l’unité planétaire !»
L’euphorie des premiers mois de foi dans une renaissance qui était alors possible, est passée quand Juan Domingo Péron meurt le ler Juillet 1974. Adulé ou méprisé, il a marqué son époque, comme Franco a marqué l’Espagne et de Gaulle la France. Un de ses thuriféraires a pu dire sans être ridicule: « Notre être s’identifie avec le justicialisme, sans lui nous perdons notre identité nationale.» Durant trente ans, Péron fut le point de référence politique. Tout s’est situé par rapport à lui. Après sa disparition tout le monde doit se redéfinir et se situer par rapport à des points de repères qui ne sont pas encore fixés. C’est le désarroi et aucune main ferme pour tenir la barre face à la tempête qui s’annonce. En Argentine, comme partout, la défaillance du pouvoir sonne l’heure de la sédition.
Madame Péron, de son vrai nom Maria Estela Martinez, âgée de 43 ans, succède constitutionnellement à son mari. Quoiqu’ayant été longtemps sa secrétaire à Madrid, rien ne la désignait particulièrement pour diriger les affaires d’un grand pays bouleversé par une guerre civile larvée.
Elle hérite d’une situation qui l’écrase.
A suivre…
Crédit photo : Wikipedia (cc) et Fond TM pour les photos d’Olier Mordrel (Tous droits réservés, reproduction interdite)
[cc] Breizh-info.com, 2024, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine