En exil en Argentine de 1946 à 1969, le principal penseur du nationalisme breton du XXe siècle, Olier Mordrel, a vécu de près l’aventure du péronisme au pouvoir et sa chute brutale en 1955. De retour en Bretagne, il rédigera un texte fascinant sur l’Argentine et le péronisme, débutant avec la naissance du futur général Perón jusqu’à la chute de son second régime en 1976. Resté inédit à ce jour, son intérêt est d’autant plus grand que l’Argentine vient de connaître un spectaculaire bouleversement politique avec la fin du régime péroniste de gauche voici quelques semaines et l’arrivée au pouvoir de Javier Milail, un ultra capitaliste bien décidé à défaire tout ce que le péronisme a construit. Il est frappant de constater que la fin du régime péroniste originel du début des années cinquante et celle de celui instauré par la famille Kirchner entre 2003 et 2023 (avec un bref intermède libéral entre 2015 et 2019) se ressemblent comme deux gouttes d’eau.
Écrit en Europe, ce texte n’est pas celui d’un historien, mais plutôt celui d’un essayiste ne disposant que de ses souvenirs et de coupures de presse envoyées par sa fille Yola depuis Buenos Aires. Malgré quelques faiblesses historiographiques, ce texte demeure un puissant témoignage de première main sur le péronisme, écrit par un homme qui aurait logiquement dû le considérer avec bienveillance. Pourtant, la dure réalité de la vie d’un exilé à Buenos Aires lui a permis de vivre le péronisme non seulement de l’intérieur, mais aussi du plus bas de l’échelle sociale. Cette expérience lui a ouvert les yeux, lui faisant voir le régime dans toute sa triste réalité, et lui a fait percevoir l’influence délétère qu’il allait avoir sur le développement, ou plutôt le non-développement, de l’Argentine.
Nous l’avons découpé en plusieurs parties et vous proposerons, chaque jour jusqu’à sa fin, un épisode.
Le péronisme, par Olier Mordrel
La bise d’hiver souffle sur la steppe, où deux cent mille moutons, serrés en larges taches grises, lui font tête. Le thermomètre est tombé à moins six et il descend encore. Le soleil est éclatant. Un gamin dégingandé, botté comme un homme, serré à la taille par une haute ceinture de cuir qui emprisonne un poncho de laine bariolée, sort d’un abri en tirant par son unique bride, un cheval réticent. À l’approche par le côté droit comme un Indien, et s’enlevant d’un bond à la force des poignets, se met en selle. Puis il lance sa bête dans le souffle glacé, en poussant un hululement sauvage et prolongé. Les péons, à la large face brune et aux moustaches rares qui leur tombent sur le coin de la bouche, sont sortis à leur tour et accompagnent d’un sourire l’envolée du patroncito. Ils lâchent, complices de sa joie, la meute légère des lévriers, qui rejoint le cavalier en faisant fuir de tous côtés les lièvres de la prairie…
Juan Domingo Péron, âgé de huit ans, fils de Mario Tomas Péron, seigneur et maître de l’estancia Chankaïké, en Patagonie, est sorti pour une dernière chevauchée matinale, avant de monter tout à l’heure dans la guimbarde qui, au bout de deux semaines de cahots et de grincements d’essieu, le déposera à Buenos-Aires, la fabuleuse ville, là-bas dans le nord à deux mille kilomètres, où les enfants n’ont pas de chevaux. Un lit étroit l’y attend entre les quatre murs suintants d’un dortoir.
A Paris, sur l’autre côté de la boule ronde, quatre fuseaux horaires plus au levant, c’est l’été. Le président Emile Loubet revient de Longchamps dans une calèche à six chevaux, dont le trot soulève rythmiquement le fessier tendu de peau du postillon, derrière un double rang de cuirassiers. Il distribue des coups de huit reflets à droite et à gauche à des dames aux chapeaux empanachés et à des messieurs aux faux-cols qui leur montent jusqu’au menton. Il réfrène son envie d’essuyer la sueur qui perle sur son front.
La France garde ses vieux figurants. L’Argentine assiste, sans le savoir, au début d’une carrière qui changera sa figure et son destin.
La pampa mère d’un homme et d’une vocation
L’école à laquelle avait été élevé Juan Domingo jusqu’à son entrée au collège était simple et rude. Un vieux maître venait lui donner des leçons sous le toit paternel, plus de sagesse que de science. «Il vaut mieux apprendre de bonnes choses, lui enseignait-il, que d’en apprendre des monceaux».
Mais son vrai maître fut la pampa patagonique et ses hommes, dont l’infinie humilité, dit-il plus tard, cachait une grandeur qu’il lui fut difficile de retrouver chez les habitants des villes. Sortir avec eux pour chasser le guanaco, à l’épaisse toison, ou l’autruche américains, le ñandu, était une fête. C’était un sport violent, prodigue en chutes de cheval. L’enfant se relevait parfois en boitillant, mais il lui fallait rattraper sa monture et à force de galop rejoindre la chasse, où sa mère chevauchant à califourchon aux côtés de son père, n’avait même pas tourné la tête. Mais aussi, à midi, quelle joie pure que de voir s’élever dans l’air sec et cristallin, la flamme crépitante du feu de bois, tandis que les peones écorchait un agneau et le tendaient, écartelé, sur une croix de bois pour l’exposer à contre-vent aux braises pétillantes. Ensuite, chacun sortait son couteau et se taillait une lanière de viande brûlante qu’il prenait dans ses dents et, d’un geste précis, coupait au ras des lèvres.
Comme tous ceux qui ont été élevés à la campagne, Juan Domingo ignorait le mépris du menu peuple, si fréquent chez les bourgeois des cités. Les péons de son père, qui n’étaient guère mieux que des serfs, travaillant de sol à sol (« de soleil à soleil »), c’est-à-dire du lever au coucher du jour, et dont la loi ne se souvenait que pour le service militaire, étaient ses amis. Chef de l’État pour la seconde fois, au seuil de la vieillesse, il aimait encore raconter une anecdote, où plongeaient les racines de son respect des humbles et de son affection pour eux.
Un jour, un pauvre indien, un des derniers qui vivaient encore dispersés et abandonnés, se présenta à l’estancia et demanda à parler au patron. Celui-ci le reçut non pas comme le nécessiteux qu’il était mais comme un grand seigneur et lui parla sa propre langue, le tehuelche, après l’avoir salué de l’usuel Mari mari. L’Indien s’appelait le Condor volant. Il ne possédait que son cheval pie et les hardes qu’il avait sur lui. Le père de Juan Domingo pria son fils de rester, sans doute pour lui apprendre comment il devait se comporter dans un cas de détresse humaine. L’indien fut embauché. On lui assigna un terrain où il construisit sa demeure, moitié cabane, moitié tente, à la manière de sa race, et on lui fit cadeau de quelques chèvres Comme l’enfant demandait à son père pourquoi il avait manifesté au malheureux tant de considération, celui-ci lui répondit: « N’as-tu pas vu la dignité de cet homme ? C’est l’unique héritage qu’il a reçu de ses ancêtres. Nous autres, aujourd’hui, nous les appelons “indiens voleurs”. Mais nous oublions que nous sommes ceux qui leur avons volé tout ce qu’ils possédaient !»
La leçon demeura gravée pour toujours dans la sensibilité de celui qui devait devenir le lider. Quand, jeune sous-lieutenant, il reçut le commandement d’une section de quatre vingts hommes, sur le corps et le visage desquels se lisaient les misères physiques et sociales, il comprit que dans un pays qui compte cinquante millions de vaches resplendissantes de santé, si le conseil de révision doit éliminer un tiers des conscrits pour débilité ou maladie grave, il y a quelque chose qui ne va pas.
«Un jour, si j’en ai la possibilité, pensa-t-il, je serai le premier à remédier à cela.» Il commença alors à concevoir le patriotisme non comme l’amour de la terre de ses pères, ni de ses richesses, ni de ses beautés, mais comme l’amour de «nos frères argentins».
L’avidité avait construit un pays
Les Espagnols, quand ils prirent congé du continent américain au début du XIXe siècle, n’avaient occupé qu’une bande de terre sur la rive méridionale du Rio de la Plata. Tout le reste de la pampa, du centre et des montagnes du centre sud était resté la propriété des Indiens. Ce sont les Argentins eux-mêmes qui ont conquis la plus grande partie de leur pays sur le «désert», euphémisme signifiant le territoire des Indiens libres. Le processus était devenu une simple routine.
Après un combat, qui dans le sud atteignit parfois les dimensions de batailles rangées mettant en action des milliers de combattants de chaque côté, on pourchassait les escadrons indiens défaits en massacrant tous les fuyards qu’on pouvait atteindre; les survivants étaient envoyés en esclavage, les vieillards liquidés, les enfants distribués dans les propriétés pour servir plus tard de domestiques, et les femmes jeunes abandonnées aux soldats.
La race de métis qui se forma ainsi sur les frontières fut la souche des gauchos. Ils étaient baptisés et portaient des noms castillans, mais dont l’accoutrement, les mœurs et parfois leur langage différaient peu de ceux des indiens qu’ils avaient remplacés en territoire conquis. Population semi-nomade, aussi amants de la liberté que leurs congénères les Cosaques en Europe, ils ne comptaient pour rien, lors de de l’attribution définitive des terres par le gouvernement de Buenos-Aires.
En 1810, il n’y avait encore que 50 000 propriétaires fonciers en face de 400 000 gauchos, qui eux, fort naïvement, se croyaient chez eux partout où leurs chevaux posaient le sabot. Pour mettre fin à leur illusion, qui était la source de frictions souvent graves, parut en 1815 et renforcé en 1822, le décret dit du vagabondage, qui réglait pour toujours la question. Tout gaucho qui ne pouvait pas présenter de titre de propriété était dans l’obligation de reconnaître un patron. Son patron lui délivrait un certificat qui était légalisé par le juge de paix. Corollaire, tout gaucho que les rafles de la police trouvait sans certificat était enrôlé de force dans la milice qui garnissait la chaîne de forts dont était ponctuée la frontière du «désert». Déserteur, il était fusillé, à moins qu’il n’ait cherché refuge chez les indiens, auxquels il devait servir d’informateur en vue de leurs razzias de bétail et pillages d’estancias.
Cette dépossession légale de tout un peuple et sa prolétarisation forcée fut la base sociale sur laquelle s’édifia l’Argentine. En 1840 on avait déjà distribué une moyenne de vingt mille hectares à 293 privilégiés. De 1876 à 1893, la distribution affecta 42 millions d’hectares. Il en résulte, à l’ aube du XXe siècle une société où 1% des propriétaires possédait 70% de la terre exploitable, et 2,4% d’entre eux 50% du bétail.
L’Argentine, tombée sous la loi des latifundia, ne pouvait dès lors ambitionner un développement harmonieux au bénéfice de l’ensemble de sa population. Elle était condamnée à l’agriculture de type capitaliste, à la production exclusive de céréales, de laine, de peaux et de viande, destinés au marché extérieur, seul capable de les absorber à un taux rémunérateur.
On construisit des laveries de laine, des frigorifiques et des silos gigantesques. On pose des voies ferrées, des réseaux télégraphiques, puis téléphoniques qui étendaient sur «l’Argentine utile» une toile d’araignée dont tous les fils aboutissent à Buenos-Aires, où étaient les banques, la bourse et les quais d’embarquement. Mais on importait tout ce qui est nécessaire à la vie.
Et partout, aussi bien dans la riche pampa que dans les régions réputées pauvres qui n’intéressent pas, le péon, descendant dompté du libre gaucho d’antan, continue à vivre dans un misérable rancho, dans une pauvreté biblique.
Un schéma parallèle se développa dans les villes naissantes, où l’ouvrier en face de l’industriel, l’employé en face du directeur remplissaient le même rôle que le péon vis-à-vis de l’estanciero.
L’avidité a été la loi de la formation de l’Argentine et elle en continua longtemps à inspirer toute l’activité sociale.
A suivre…
Crédit photo : Wikipedia (cc) et Fond TM pour les photos d’Olier Mordrel (Tous droits réservés, reproduction interdite)
[cc] Breizh-info.com, 2024, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine





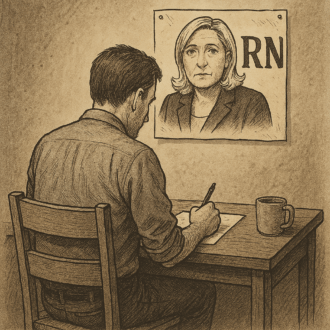






2 réponses à “Argentine. Le regard d’Olier Mordrel, nationaliste breton, sur le Péronisme [Partie 1 – Exclusif]”
Très intéressant , témoignage d’un oeil curieux et averti .
Souvent , hormis nos pays d’Europe , on ignore le processus ayant présidé à la création de ces pays lointains .
Je constate le même procédé d’éradication et de spoliation propres à toute cette zone , que je retrouve dans les ouvrages de Jean Raspail , notre ex ambassadeur du pays Patagon .
Les élites économiques argentines n’ont jamais rien investi dans leur pays, préférant placer leur fric en Amérique du Nord ou en Europe occidentale, zones qu’elles jugeaient plus sûres que leur pays. Si les élites économiques françaises avaient fait de même, la France serait actuellement au même niveau que l’Argentine.