Les Celtes de l’antiquité se détournaient des cités pour chercher le reflet de la divinité sous les frondaisons des chênes.
Renouant avec cette attitude, Bernard Rio ) dans son nouvel ouvrage La forêt sacrée des Celtes (Yoran Embanner) s’est interrogé sur les mythes et les légendes qui fondent la culture occidentale, il perçoit la forêt comme un lieu d’ensauvagement et d’enseignement. La forêt au milieu du monde et l’arbre au milieu de la forêt comme symbole de l’axis mundi, telle est l’idée maîtresse de cette immersion dans les traditions populaires, les romans médiévaux ou les chantiers archéologiques.
C’est à la forêt, premier et dernier temple de la divinité, que les peuples d’Europe doivent leur héritage et leur devenir. Aller dans la forêt et se percher dans l’arbre de vie, pour y apprendre l’histoire et bâtir le monde de demain, telle est la leçon conjuguée de Merlin, de Bernard de Clairvaux et de François-René de Chateaubriand !
Bernard Rio est journaliste et écrivain. Auteur d’une soixantaine d’ouvrages, il a notamment collaboré au « Dictionnaire critique de l’ésotérisme » (PUF) et publié « Voyage dans l’au-delà, les Bretons et la Mort », « Le cul bénit, amour sacré et passions profanes », « Le livre des saints bretons » et « 1200 lieux de légende en Bretagne ».
Nous l’avons interrogé ci-dessous :
Breizh-info.com : Dans « La forêt sacrée des Celtes », vous faites référence à François-René de Chateaubriand, qui écrivait dans “Le génie du christianisme” : « les forêts ont été les premiers temples de la Divinité, et les hommes ont pris dans les forêts la première idée de l’architecture », et vous ajoutez que « c’est à la forêt qu’il faudrait revenir pour étudier la divinité et l’architecture primitive occidentale ».
Bernard Rio : R. Chateaubriand était sensible à la forêt, aux arbres, auxquels il a fait référence dans ses mémoires, ses essais et son oeuvre romanesque, notamment dans « Les martyrs » où apparaît la prêtresse Velleda. Son œuvre littéraire est une ode à la forêt et il a fort justement choisi de s’établir à « La Vallée aux loups » à Châtenay-Mallabry où il a conçu son parc comme un locus amoenus. Ce recours à la forêt de l’écrivain fait écho au discours de saint Bernard qui déclarait : « Crois en mon expérience : tu trouveras quelque chose de plus dans les forêts que dans les livres. Les arbres et les pierres t’enseigneront ce que tu ne peux apprendre des maîtres ».
Le rapport particulier des Celtes à la forêt est perceptible dans les premiers commentaires des voyageurs grecs et latins sur l’Europe du nord-ouest, qu’on retrouve notamment dans la Gallia comata, la Gaulle chevelue, décrite par Jules César. La civilisation celtique et en l’occurrence la religion soustendent une cosmogonie. Pour tenter son appréhension, il ne faudrait pas réduire son champ de vision, tant dans le paysage que dans la mémoire, car il y aurait un indubitable danger à cataloguer prématurément et abusivement des divinités et des cultes. Notre méthode a été de ne rien rejeter, de tout comparer et de confronter aussi ce qui ne pouvait pas être chronologiquement comparable, par exemple le commentaire grec ou latin avec le récit épique médiéval, l’archéologique avec le légendaire afin de brosser un tableau de « la forêt sacrée des Celtes ». Par exemple, l’invention de Brocéliande en Bretagne armoricaine doit être replacée dans un cadre autant historique que culturel. Toute étude littéraire des romans bretons qui ignorerait la mainmise des Plantagenêt sur le duché de Bretagne au douzième siècle ne saurait appréhender la réalité des œuvres commanditées par le pouvoir temporel. Le roi archétypal Arthur a été une pièce maîtresse de la politique des Plantagenêt pour asseoir leur légitimité en Grande et en Petite Bretagne. Sur un même mode, le folklore a servi de support et de conservateur aux mythes. La mémoire a transféré aux personnages des contes et aux superstitions populaires des traits archétypaux et des structures qui maintiendraient une réalité protohistorique. Les légendes peuvent être comparées et se compléter afin de reconstruire un symbolisme. Leur interprétation peut servir de point de départ à une approche mythique du monde. Les Celtes n’ont pas eu besoin des Romains et des Grecs pour transmettre un savoir. Ils n’ont pas eu besoin non plus des moines chrétiens pour conserver un héritage dont la mise par écrit est souvent synonyme d’affaiblissement. Les versions écrites des mythes celtiques constituent des matériaux. Elles illustrent, mais ne fondent pas une tradition qui privilégie l’oralité à l’écriture.
Breizh-info.com : Concrètement, quelles sont les principales caractéristiques du rapport sacré des Celtes à la forêt ?
Bernard Rio : Le lieu devient sacré dès lors qu’il est consacré à la divinité. Il pourrait être aussi sacré par nature. L’un n’exclut pas l’autre. Il serait réducteur et révélateur d’un esprit « moderne » de ne retenir qu’un lieu inanimé que consacre le culte de la divinité par l’homme. Le culte n’est pas un principe. Il ne fonde pas la divinité… Ce n’est qu’une expression rituelle non la manifestation de la divinité. Celle-ci se manifeste dans le lieu et par le lieu sacré. La distinction entre la forêt et la divinité qui s’y manifeste met en évidence un esprit étranger à la notion même de sacré, une intelligence qui cherche à définir avant de comprendre, une raison qui sépare l’ « anima » du « mundi », la « res cogitans » et la « res extensa », la « res publica » et la « res silva »… Dans son « discours de la méthode » (1637), René Descartes illustre cette raison verticale. L’attitude des positivistes modernes s’avère bien plus éloignée de la pensée celtique que pouvait l’être celle des saints de l’Europe de l’Ouest et de leurs hagiographes médiévaux.
Les hommes et les lieux conservent une pratique cultuelle souvent révélatrice d’une antique conception du temps. Arnold van Gennep et Henri Dontenville, pour ne citer que deux des plus illustres des mythologues francophones, ont constaté que les matériaux composant le « folklore » étaient nombreux et parfois même « intacts » après deux mille ans de christianisme et deux cents ans de laïcisme. Certes les documents folkloriques sont souvent hétérogènes et le premier travail consiste à les classer. Néanmoins ces « pierres brutes » sont là. Il suffit de se baisser et de les ramasser pour les polir et leur redonner leur éclat flamboyant originel. La Réforme et la Contre-Réforme, la Révolution et la République ne sont pas venues à bout de toutes les fontaines de dévotion et tous les arbres sacrés car le monde rural conservait pieusement ses mœurs, ses coutumes et ses traditions. Le fonds culturel qui nous intéresse est celui des païens, ces « pagani » « gens de l’endroit » par opposition aux chrétiens, ces « alieni » « gens d’ailleurs », selon la définition qu’en a donnée Pierre Chuvin. Tant que son mode de pensée n’a pas été éradiqué, la campagne a maintenu en toute intelligence ce que les urbains dénommeraient une routine mais qui s’apparente à une expérience sensible du sacré. Les temps ont changé lorsqu’au dix-neuvième siècle la société de rurale est devenue urbaine, et de paysanne est devenue ouvrière. Le peuple s’est mis à l’aune des classes instruites. Il s’est détourné de son savoir millénaire. Ce génocide culturel a touché toute l’Europe des premiers jusqu’aux derniers pays industrialisés… Les « antiquaires » des XVIIIe et XIXe siècles avaient compris l’urgence de la situation en s’efforçant d’inventorier l’héritage. Aujourd’hui comme durant l’Antiquité, la ville demeure le lieu du changement, mais l’avenir appartient toujours aux hommes de la terre. Lorsque l’empire romain a dû abandonner ses lointaines provinces puis céder la parole aux peuples qu’il avait soumis, la mémoire est revenue aux tribus barbares. Elles ont abandonné Julius et Augustus et recouvré leurs anciens patronymes : Pictons à Poitiers, Lémoviques à Limoges, Bituriges à Bourges, Cadurques à Cahors, Carnutes à Chartres, Rèmes à Reims, Santons à Saintes, Trévires à Trèves, Vénètes à Vannes… Chaque peuple a rejeté le nom de l’occupant et repris droit de cité, Lutetia est redevenue ad Parisios (Paris), Agedicum ad Senones (Sens), Caesaromagus ad Bellovacos (Beauvais)…Cette mémoire des hommes peut se conjuguer avec l’esprit des lieux qui l’entretient et l’éveille. Le paysage possède une indéniable capacité à maintenir une originalité intemporelle, au-delà des colonisations et des invasions. Livre élémentaire, l’espace naturel conserve la mémoire diffuse du passé. Ne dit-on pas que les bonnes fées se seraient métamorphosées en sureau ou en aubépine pour échapper aux prêtres de la nouvelle religion ! De là probablement l’interdit de couper ces essences dans une campagne respectueuse des anciennes règles. La nature demeure dépositaire d’une culture que l’homme déraciné aurait tendance à oublier ! Après cette longue mais nécessaire digression, ma réponse à votre question serait celle-ci : À Jules Michelet qui prétend qu’« avec le monde a commencé une guerre qui doit finir avec le monde, pas avant : celle de l’homme contre la Nature », le Celte répond que l’homme s’insère dans son environnement et doit s’en accommoder sans essayer de le dénaturer et de se dénaturer… Cette conception globale de l’homme et de la nature dépasse les dichotomies de la société consumériste. Elle rassemble sans opposer les notions de nature et de culture, d’animalité et de spiritualité, l’intellect et les sens, l’individu et la société… Si l’homme moderne se complaît à fonctionner sur une base duelle, opposant ainsi l’animal au végétal, le végétal au minéral, distinguant dans l’une les notions de vivant, de croissance et de mobilité, et dans l’autre une immobilité et une intangibilité… Le Celte de l’antiquité privilégiait quant à lui un milieu qui ne s’opposait et ne se fractionnait pas. Sa préférence allait à un espace animé, illimité, plein, pluriel, cyclique et polyconcentrique. Son « désert » bruissait de vie. Il n’était ni vide ni inerte ni plat ni linéaire ni horizontal. Si la Rome impériale puis chrétienne a tenté d’extraire l’homme de son milieu en l’enfermant dans une urbanité et une dualité, la société celtique se tournait vers la nature pour y enseigner la liberté et le foisonnement, la réalité et l’imaginaire, l’actualité et l’éternité.
Breizh-info.com : Doit-on nécessairement opposer spiritualité des Celtes et des forêts avec le Christianisme ?
Bernard Rio : La sylve possède dans l’imaginaire contemporain les mêmes aspects que l’autre monde pendant l’antiquité… Apparentée à la nuit, la forêt occidentale tiendrait aujourd’hui davantage de l’art roman que de l’art gothique. Ce serait un espace à l’intérieur du monde qui refléterait une lumière semblable au reflet d’un miroir, ce serait un espace intérieur, un lieu de mémoire et de réflexion. « Le désert est monothéiste » écrivait Ernest Renan dans « Histoire du peuple d’Israël ». La forêt est polythéiste pourrions-nous ajouter si le manichéisme était notre lot. Mais la forêt ne se définit pas par opposition et moins encore par contradiction. Si, à l’instar des Fiana irlandais, les ermites ont été tentés par les bois n’est-ce pas que la retraite forestière est un perpétuel retour au sacré ? Saint Colomban au septième siècle, les Cisterciens au douzième siècle, les Fransiscains au quinzième siècle s’installèrent dans les forêts. Certains ordres ne s’éloignèrent guère des lieux de pouvoir tels les Jansénistes quittant Paris pour Port-Royal dans la vallée de la Chevreuse… Leur retour à la forêt s’apparenterait à un détour mais il n’en conserve pas moins un symbolisme primitif. Lorsque Merlin abandonne la cour du roi Arthur, il fuit aussi la ville close et l’obscurité qui s’étend sur le royaume… L’homme de pouvoir redevient le sauvage, le philosophe qui se perche dans l’arbre et s’accorde avec les puissances de la terre et du ciel. Le sylvain devient cueilleur de pommes. Ainsi que l’énonçait saint Bernard, la vérité est dans le chant de l’oiseau, au milieu des bois plus que dans les livres.
Opposer Celtes et Chrétiens est réducteur, car le christianisme change, s’adapte et adopte de nouveaux usages au fil des siècles. Grégoire Le Grand n’agit pas sur le modèle de saint Martin.
Ainsi il explique le 16 juillet 601 au père abbé Mellinus la formule de la conversion : Bâtir les nouveaux sanctuaires dans les bois sacrés des païens en Grande-Bretagne, laquelle vaut pour la Gaule : « Nous n’avons cessé d’être soucieux après le départ de la congrégation qui t’accompagne, parce que nous ne savons rien de l’heureuse issue de ton voyage. Lorsque le Dieu Tout-Puissant t’aura fait parvenir auprès du très révérend évêque Augustin, notre frère, dit lui que j’ai longuement réfléchi au sujet des Angles ; je veux dire qu’il ne faut pas détruire les temples qui abritent les idoles, mais les idoles qui s’y trouvent ; on aspergera les temples avec de l’eau bénite, puis on érigera des autels où seront disposées les reliques. Car si ces temples ont été convenablement bâtis, il est indispensable qu’ils passent du culte des démons au service du vrai Dieu. Ainsi, voyant que leurs temples ne sont pas détruits, les habitants pourront renoncer du fond de leur cœur à leurs erreurs et, connaissant désormais le vrai Dieu, se sentir d’autant plus prêts à revenir l’honorer dans des lieux qu’ils fréquentaient naguère. Comme on les avait habitués à égorger un grand nombre de bêtes pour les offrir en sacrifice aux démons, il faudra également à la place de ces sacrifices, instituer des fêtes solennelles : le jour de la dédicace ou de la naissance des saints martyrs dont on expose les reliques, on pourrait leur faire aménager des huttes de branchages autour de ces temples convertis en églises, et célébrer la solennité au cours d’un festin à tonalité religieuse ». Cette attitude pourrait s’expliquer à la fois par le lieu d’apprentissage de Grégoire, l’ancien sanctuaire païen du mont Cassin, et par ses interlocuteurs insulaires, eux aussi formés à une école inspirée par le modèle du monachisme irlandais. Le fanatisme des premières missions chrétiennes a cédé la place à un pragmatisme. Saint Colomban prisait les forêts pour se promener et méditer. Son biographe, Jonas de Bobbio signala que, mandé par le roi burgonde Gontran, le saint irlandais établit son monastère dans un ancien castrum au milieu d’une forêt vosgienne. Et ce fut encore une forêt qu’il choisit en 613 pour fonder un nouveau monastère en Italie du nord.
Geoffroy de Monmouth confirma dans « Histoire des Rois de Bretagne » que le procédé fut généralisé par nombre de moines peu enclins à faire table rase du passé : « Après avoir mis fin au paganisme sur presque toute l’île de Bretagne, ces vénérables sages Fagan et Duvian consacrèrent au Dieu unique et à ces saints les temples qui avaient été fondés en l’honneur des très nombreux dieux païens et ils y installèrent différents collèges de prêtres. »
Les moines occidentaux qui succédèrent aux premiers missionnaires d’origine orientale, remirent à l’honneur les anciens lieux sacrés. On attribue à saint Patrick la plantation des ifs de Newry et les ifs de l’abbaye de Glendalough, et saint Ronan établit son ermitage dans la forêt sacrée de Nevet.
Breizh-info.com : Sans même le savoir, ou être particulièrement érudits, de nombreux européens poursuivent, perpétuent aujourd’hui des rites, des traditions, de la spiritualité en forêt. Avez-vous quelques exemples ?
Bernard Rio : L’importance des cultes mariaux liés à l’arbre ou à la forêt illustrerait un substrat pré-chrétien dans les croyances et dévotions populaires : Notre-Dame de l’Epine, Notre Dame du Roncier, Notre-Dame de la Tronchaye, Notre-Dame du Chêne… L’inventaire que je dresse dans la quatrième partie du livre consacrée aux survivances est significatif. A de multiples reprises et en de nombreux lieux, l’église chrétienne a su adopter les arbres sacrés et s’adapter aux usages cultuels locaux. Croix et statues fleurirent alors entre les fourches des arbres. Quoique les conciles aient avec constance frappé l’arbre d’interdit, les croyances populaires ont conservé les traces d’une irréductible dévotion. L’homme l’érigea en confesseur et en intercesseur, en un véritable jumeau végétal. Il le priait, l’implorait, l’honorait et le menaçait s’il n’était pas entendu. Les superstitions recensées par les antiquaires, les folkloristes et aujourd’hui par les ethnologues donnent un aperçu des rites saisonniers de fertilité. Elles induisent aussi une dimension métaphysique. Déposer des offrandes au pied d’un arbre, n’est-ce pas lui reconnaître et lui conférer un pouvoir ? Il ne s’agissait pas seulement d’obtenir une copieuse récolte de fruits ou la guérison d’une personne malade. L’hommage rendu aux arbres dépassait le vulgaire négoce pour relever du domaine culturel. Pour ne citer qu’un exemple, à Bonnoeuvre, en Loire-Atlantique, le « chêne aux clous » attire des pèlerins qui viennent tourner sept fois, dans le sens solaire, autour de l’arbre avant d’y planter un clou afin d’être soulagés de leurs maux. Les clous de Bonnoeuvre appartiennent au même attirail symbolique que les « reginnagli » et « verladarngali », les clous de la divinité et de l’univers que les Germains plantaient dans l’arbre sacré. C’est aussi du même acabit que les clous fichés dans les colonnes du Capitole pour célébrer le culte d’Horace à Rome. Ce chêne aux clous est un pilier de la forêt universelle. Chaque pointe martelée dans l’écorce renforcerait la colonne du temple sylvestre et résonnerait dans le monde d’en haut. Le transfert, de la maladie, de l’homme à l’arbre relève à la fois de la croyance, de l’usage et du contrat.
De nombreux usages admis dans l’hagiographie chrétienne pourraient être hérités du paganisme notamment l’incubation du dormeur dans un lieu sacré. Le conseil divin lors d’un songe et l’apparition d’une divinité à une personne endormie au pied d’un arbre étaient monnaie courante dans la religion des campagnes. Ces pratiques divinatoires s’apparentent à un fonds protohistorique tout comme les signes tracés sur les maisons, les oboles offertes aux sources, les bénédictions de troupeaux, les circumambulations saisonnières…
Breizh-info.com : Vous préconisez de nous inspirer de la forêt. Pour quelles raisons ?
Bernard Rio : Au moyen âge, le mot « foresta » s’oppose à « sylva », la forêt royale à l’antique forêt, l’une propriété privée excluant l’homme, l’autre domaine n’appartenant à personne et libre d’usages. Ces distinctions sont déjà les prémices à une appropriation du monde sauvage, à une progressive exploitation de ces territoires du dehors. L’homme va étendre sa domesticité à son environnement en réussissant dans la seconde moitié du XVIIIe siècle à conférer à sa conquête territoriale une utopie civilisatrice. La Révolution française, fille de cette philosophie des Lumières, devait parfaire sur le terrain la déforestation et l’éradication des sauvages. En supprimant en 1790 les Maîtrises des Eaux et Forêts, les tribunaux et les codes forestiers, la Révolution achevait de « profaner » l’espace forestier en le soumettant au droit commun. La plus importante vague de défrichement s’en suivit dans la « Gallia comata ».
Avec la philosophie des lumières, à la ville lieu d’éducation renvoie la campagne un lieu de production et de récréation. C’est à ce concept que l’éducation à l’environnement doit, depuis le XXe siècle, son appréhension culturelle d’un espace dit naturel. La forêt est désormais promue monument naturel (loi du 1er juillet 1957), parc national (loi du 22 juillet 1960) ou conservatoire (loi du 10 juillet 1975)… avec une vocation similaire pour l’humanité que celle du jardin botanique pour le citadin !
Cette perception réglementaire de la nature prolonge le discours cartésien en offrant au citadin stressé un lieu de contemplation ou d’agitation… Elle suppose une consommation de la nature. L’idée même de protection de l’environnement induit une appropriation. La rupture culturelle avec l’antiquité est patente. Cette vision contemporaine du monde retranscrit un manichéisme anthropocentré. La nature héritée du christianisme étant une création de Dieu, elle ne serait pas naturellement sacrée. Sa divinité serait récusée puisqu’émanant d’un créateur. Cette nature créée relèverait de l’homme qui la dominerait, le dieu créateur ayant conféré à l’homme sa raison d’être. Ce pouvoir de décider pour autrui fait de l’homme un mi-dieu, mi-diable lâché dans la nature pour la protéger ou la détruire. Induisant cet esprit de domination, le protectionnisme accrédite une nature inerte et régentée par un homme omniscient !
Dans l’antique forêt, l’homme se conformait au sacré. Cette ritualité ne pourrait se réduire à une dendolâtrie dont les aspects superstitieux véhiculent une vision idolâtre sans rapport avec l’essence même du sacré : une connaissance et une imprégnation au monde. Tandis que la dendolâtrie suppose un culte des bois, l’antiquité privilégiait un culte par les arbres qui mêlait philosophie et religion. Adorer dieu dans la nature ou la nature comme dieu ne suffirait pas à expliquer la nécessité du divin dans cette conceptualisation de la nature sacrée du monde. Il y avait dans la relation que le Celte entretenait avec le monde un entendement et une conscience qui se traduirait davantage par une émotion sceptique que par une extase naïve. La combinaison de la forêt lieu de nature et de culture serait hasardeuse et élective. La forêt antique demeurait en effet un lieu de savoir dont tous les aspects visibles et invisibles pouvaient être intelligibles. L’espace était couvert et ouvert à tout être qui n’entendait pas soumettre la nature à une idée verticale. Cette dimension latérale de la pensée forestière conjuguait l’animal et le sacerdotal, le corps érotique à l’âme hérétique et à l’esprit erratique… Dans la forêt, la bête pouvait consacrer l’homme tel Saint Hubert, le hors-la-loi pouvait défendre la justice tel Robin Hood, le vertueux chevalier pouvait s’ensauvager tel Yvain, le moine pouvait se défroquer tel Eon de l’Étoile, la ligne droite s’incurvait et fermait un cercle…
La forêt primitive s’appréhenderait comme une tentation tandis que sur son piédestal cartésien, l’homme moderne n’a ni l’idée ni l’envie de grimper dans l’arbre. Il n’en aurait peut-être même plus la force ? Drapé dans sa raison du plus pensant, il pose. En concevant l’espace comme inerte, il ne se réfère plus qu’à un temps mobile qu’il cherche à vaincre. Il sépare l’horizontal et le vertical. Il domine l’un et lutte contre l’autre pour tenir lieu et fonction de pilier du monde, « axis mundi ». Le bipède statufié a toutes les raisons de craindre une confrontation avec la forêt, espace des destructions et des transformations, réunion des mécréants et refuge du solitaire. En traversant la forêt, l’homme peut follement suivre une chasse sauvage dont nul ne sait qui conduit la traque, le roi veneur ou le blanc cerf ? Nul ne sait qui va troquer l’habit et s’attribuer les cornes à l’issue de la quête. La métamorphose du héros reste incertaine au fond des bois car l’action est le prélude à une fondation dont on perçoit mal ou confusément le sens. Traverser la forêt vaut un voyage périlleux au bout du monde et courir sous les bois mène souvent à un combat dont la fin n’est que le début d’une initiation… La forêt semble fonder consubstantiellement l’homme en devenir. Elle est la rupture et le passage. La confrontation de l’homme à la forêt pourrait correspondre à la fonction du miroir dans le conte de Blanche neige ou à celle du labyrinthe de Dédale. Le miroir et le labyrinthe ne renvoient qu’une apparence sans issue.
La forêt répondrait à une fonction destructrice ou qualificatrice. Tout dépend de la capacité de l’homme à se perdre, à s’ensauvager pour réussir à affronter le dragon gardien de la grotte, l’ogre dans la caverne, le géant vert dans la clairière, le chevalier noir à la fontaine… Cet ensauvagement subtil correspondrait à une mise à niveau. La première épreuve réussie ouvre la porte du château de verre… Fort d’une victoire préliminaire, le héros accède au milieu du monde. Ce serait le temps de l’interrogation. Il voit mais il ne sait pas encore. L’accès au centre de la forêt, dans la clairière, dans le château merveilleux ne peut être que prolongé que par une montée à l’arbre qui mène au ciel. À défaut, ce sera le retour en arrière, dans les ténèbres du monde. La forêt ne tient pas, dans ce registre symbolique, une fonction de repli. C’est un élan, un milieu pour s’accomplir. L’animal et l’arbre jouent les rôles de conducteur et d’initiateur. Ils consacrent des archétypes. Ils fondent des héros destinés à bouleverser leur temps, à remettre en cause les apparences et à rétablir l’ordre du monde. La forêt augure une renaissance, un éternel retour où meurent et où renaissent les hommes. La quête du rameau d’or symbolise ce détachement profane et ce retour au sacré.
Bernard Rio, « La forêt sacrée des Celtes », Yoran Embanner, 448 pages, 22 euros (à commander ici)
[cc] Breizh-info.com, 2023, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine

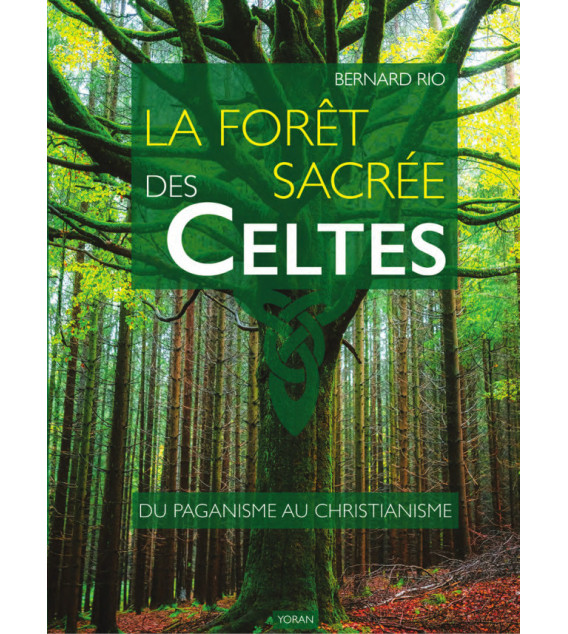











4 réponses à “Bernard Rio raconte la forêt sacrée des Celtes [Interview]”
« Les Celtes de l’antiquité se détournaient des cités pour chercher le reflet de la divinité sous les frondaisons des chênes » ? Joliment dit, mais les « cités » de l’antiquité gauloise étaient rares, même à l’époque gallo-romaine, en dehors de la Narbonnaise.
La remarque ci-dessus sur les cités est bien sûr marginale : l’entretien est fort intéressant !
Les « cités » gauloises étaient nombreuses, on les dénommait « oppidum, dunum (Verdun) » et César le relate qui dut faire le siège de nombres d’entre-elles . Et de nos jours, la mode chez les archéologues officiels est justement d’en « découvrir » à qui mieux-mieux ainsi que les fermes « indigènes » passée la mode des « villas » gallo-romaines. En pratique, l’espace gaulois était « plein », habité, cultivé, qui a permis au conquérant de nourrir sans difficultés ses 10-12 légions, environ 100 000 hommes (et aussi la somme de valets de la logistique) pendant huit années de guerres incessantes. A part cela, ce livre est un monument d’érudition celtique…
Cordialement, a galon genoh!
J’aime bien Bernard Rio, c’est un ami. Mais la réécriture du monde celtique, voire druidique, a ses limites.