Si n’importe qui peut devenir historien en apprenant des mains d’un bon maître les arts de l’office, les historiens vulgarisateurs sont rares. Alexandre Jubelin fait partie de ce petit nombre d’intercesseurs entre la connaissance universitaire, ou experte, et le public des gens curieux, j’en veux pour preuve son excellent Par le fer et par le feu, combattre dans l’Atlantique XVIe-XVIIe siècles qui vient de paraître aux édition Passés composés.
Actif sur les réseaux sociaux, Alexandre Jubelin anime également le Collimateur, le podcast de l’IRSEM (Institut de recherche stratégique de l’École militaire). À titre d’exemple, en route vers Paris, j’ai remplacé avantageusement France Inter ou France Info par « Refaire l’histoire du débarquement en Normandie «, un long entretien avec Jean Luc Leleu, qui vient de publier chez Perrin : « Combattre en dictature. 1944, la Wehrmacht face au débarquement ». Alexandre Jubelin a mené intelligemment les débats avec Luc Leleu en insistant, par exemple, sur la question des sources. Beaucoup d’auteurs, faute d’entendre la langue de Goethe, n’exploitent pas la documentation disponible à Coblence et se contentent pour connaître le point de vue de l’Armée allemande dans ses différentes composantes, de puiser dans les souvenirs de militaires vaincus écrits post factum puis traduits en anglais et produits immédiatement après la guerre par le Service historique de l’US Army. Pourquoi se fatiguer à lire un message original de von Rundstedt quand on dispose de l’interprétation des événements par le maréchal lui-même en anglais et servie sur un plateau ? Justement parce que ces souvenirs arrangés ne correspondent pas à la réalité des archives et dorent la pilule à la Wehrmacht en passant la patate chaude de la défaite à Hitler. J’insiste un peu sur ce podcast d’Alexandre Jubelin pour donner envie à mes lecteurs de s’y plonger.
Un historien, ce sont d’abord des sources
Sans archives, nous n’avons pas d’histoire, mais un roman. Il peut être très bon comme les Mémoires d’Hadrien où l’imagination de Marguerite Yourcenar a comblé avec tant de talent les lacunes d’une historiographie parcimonieuse que l’image de l’empereur qui s’est imposée dans la culture européenne est celle que nous a léguée l’ermite de l’île des Monts-Déserts dans la mesure où historiens et épigraphistes n’ont pas été en mesure de la mettre en défaut (les amateurs éclairés écouteront avec plaisir à ce sujet le cours de Denis Knoepfler au Collège de France).
Oui, les sources sont le nerf de la guerre de l’histoire et la matrice féconde de l’historien qui se donne de la peine. Or, plus nous remontons dans le temps, plus elles se font rares. Non seulement en raison des destructions, mais aussi par l’absence de structures administratives pour les produire, les recueillir, les classer et les conserver. Un de mes maîtres disait, à titre d’illustration, sans prétention à l’exactitude, « Nous avons pour Louis XIII, cent mètres linéaires d’archives. Pour Louis XIV, on dépasse les mille mètres et pour Napoléon III, les archivistes comptent encore. » D’autre part, les archives conservent plus facilement des rôles d’équipage que les souvenirs de ces marins, davantage d’écritures comptables que des récits d’abordage.
Un défi archivistique
On mesure donc le défi relevé par Alexandre Jubelin de s’intéresser à la guerre navale aux XVIe et XVIIe siècles, quand les sources sont lacunaires et les documents préservés ne font qu’effleurer le sujet. C’est probablement avec une bonne dose d’insouciance et de témérité que notre homme s’est lancé dans la rédaction d’une thèse de doctorat « Par le fer et par le feu ». Pratiques de l’abordage et du combat rapproché dans l’Atlantique du début de l’époque moderne (début du XVIe siècle – 1653), qu’il a soutenue en 2019.
L’ouvrage qu’il vient de publier est une adaptation de sa thèse. Pour les amateurs éclairés, il a mis son texte universitaire en libre accès. https://alexandrejubelin.fr/these/
Je ne peux que le féliciter d’avoir ouvert à tous son travail initial car il comporte des parties forcément omises de l’œuvre destinée au grand public, notamment quarante-six pages passionnantes, une véritable enquête policière qui décrit sa collecte de sources exploitables pour son sujet. Je n’ai repéré, à première vue, qu’une lacune, les archives de l’Amirauté à Bruxelles qui regroupent la masse documentaire de l’Armada des Flandres basée à Dunkerque avant son annexion par la France.
Dans sa quête de sources, Alexandre Jubelin a bénéficié de son statut de Français, au carrefour des grandes puissances de l’époque, l’Espagne au sud et l’Angleterre au nord-ouest. Contrairement à nombre d’historiens insulaires, il maîtrise l’espagnol et à l’inverse à beaucoup d’historiens péninsulaires contemporains, il ne se limite pas à la lecture de l’anglais. Bref, c’est le moderne Pangloss en mesure de parcourir, examiner et croiser des originaux dans les principales langues de la période qui nous concerne, même si c’est l’espagnol puis l’anglais qui dominent largement.
On ne doit pas sous-estimer la magnitude de la tâche entreprise par Alexandre Jubelin. Faute de récits de première main comme on les trouve abondamment par la suite, il est compliqué de se faire une idée précise des affrontements et de l’emploi des différentes armes embarquées comme du passage de l’échange de tirs d’artillerie à l’abordage et du déroulement des combats sur le pont.
Pour récolter des renseignements, il faut glaner dans les bibliothèques les souvenirs et les récits de voyage tout en se plongeant dans la lecture des manuels de navigation et de guerre maritime de l’époque car les auteurs se sont inspirés des retours d’expérience des marins. L’archéologie joue aussi son rôle. Le relevage de la Mary Rose, naufragée en 1545, nous apprend beaucoup sur l’armement et l’organisation du bord.
Une guerre sur mer en pleine métamorphose
Il est important de rappeler qu’Alexandre Jubelin s’intéresse aux combats, à la grammaire des affrontements. Pas à l’histoire navale avec un grand « H ». Il fait le contraire d’un R. A. Stradling dont le classique The Armada of Flanders: Spanish Maritime Policy and European War, 1568–1668, passe complètement sous silence le choc des vaisseaux et des hommes. C’est comme écrire l’histoire de l’automobile sans jamais se poser la question de ce qu’il y a sous le capot.
Des navires qui s’adaptent à l’artillerie
Pour en arriver à son sujet, l’auteur commence par brosser à grands traits les navires du temps, héritiers des navigateurs du Moyen Âge, qui apprennent à dompter l’océan pour atteindre les terres lointaines qu’elles soient américaines ou asiatiques. Pour ce faire il faut disposer d’un bâtiment sûr, rapide, manoeuvrier doté d’une forte puissance de feu et une grande capacité d’emport : c’est ainsi que naît le galion qui a changé à la fois le commerce au long cours et la rivalité des puissances sur la mer.
Les Etats doivent imaginer de nouveaux mécanismes pour budgéter ces coûteux instruments modernes de la puissance que sont les navires armés pour la guerre articulés en flottes de combat. Parfois c’est l’Etat, parfois des entrepreneurs, qui payent l’addition. A titre d’exemple, la contre armada anglaise qui partit en 1589 profiter d’un affaiblissement supposé de l’Espagne, fut financée par une entreprise capitalistique où la couronne comme des sujets privés apportèrent leur contribution aux dépenses de l’expédition.
Des canons onéreux et perfectibles
L’auteur consacre de nombreuses pages à l’étude de l’artillerie. Il rappelle qu’il faudra trois siècles pour que cette arme nouvelle s’impose définitivement sur mer.
Longtemps plus proche de l’artisanat que de l’industrie, la production peine à satisfaire les besoins de flottes en construction ou en projet. En fer forgé, ou en bronze, les pièces coûtent très cher et le premier canon en fer ne sera coulé qu’en 1543.
Leur rareté, leur rythme de tir très lent, l’hétérogénéité des parcs, le manque d’instruction des canonniers, rendent leur usage décevant pour les chefs de guerre. D’autant qu’il est compliqué d’imaginer à cette époque des mécanismes financiers capables de poursuivre l’effort en faveur de cette arme aussi en temps de paix. A titre d’exemple, l’incapacité de la Casa de contratación de Séville de payer avec régularité le responsable de son artillerie et de l’instruction des servants, pourtant indispensables au bon fonctionnement des convois vers le Nouveau Monde.
Une construction navale artisanale
Au départ de la période couverte par ce livre, les bâtiments sont rarement conçus comme des machines de guerre. Le plus souvent on adapte les bateaux disponibles en les classant selon des types approximatifs : frégates, galions, caraques, etc. Très vite, les États comprennent que cette improvisation se paye cher sur le champ de bataille. On ne peut plus se contenter de mobiliser des navires marchands et embarquer les bouches à feu disponibles sur le parc d’artillerie. Le poids des tubes et la puissance de leur recul au moment du tir ont un impact considérable sur la structure des bâtiments.
Pour répondre à ce défi, les monarchies européennes commencent à se doter de navires de guerre spécialement conçus à cette fin. Mais voilà, les constructeurs ne disposent pas encore des outils théoriques en mesure d’anticiper l’impact des facteurs de charge, notamment le poids des canons et l’emplacement de la première rangée de sabords. Les conséquences peuvent être très graves tant sur la navigabilité que sur la durée de vie des coques. La perte du Mary Rose en 1545 ou du Vasa en 1628 illustrent l’importance d’une maîtrise réelle des mathématiques de sorte que les dimensions du navire soient calculées à l’avance pour garantir à la fois la stabilité et l’emport nécessaire pour assurer sa mission de combat.
Des équipages et des soldats
Les hommes qui peuplent les vaisseaux sont aussi peu standardisés que les armes embarquées. Ils sont organisés dans une certaine anarchie sous la houlette du maître du navire qui a appris son métier sur le tas. Il doit trouver le moyen de faire cohabiter les marins, qui connaissent les gréements et peuvent monter aux mâts pour la manoeuvre, les artilleurs, qui commencent à prendre une place cruciale à bord, et également les soldats dont on a besoin pour mettre en oeuvre les armements individuels puis pour passer à l’abordage.
La présence des militaires à bord ne se fait pas sans mal. Ils sont souvent peu entraînés et encombrent le bâtiment où la place disponible est rationnée, à peine plus d’un mètre carré par personne. Nous sommes loin à cette époque des navires de ligne de la seconde moitié du XVIIIe siècle. On se bat pour l’espace vital. Car il faut faire de la place, non seulement aux hommes mais aussi aux marchandises et, dans les cas des voyages lointains, aux animaux vivants qui seront sacrifiés en route.
Comment faire pour transformer ce caravansérail naval en vaisseau de guerre ? C’est une grosse affaire qui mobilise tout le monde à bord. Il faut dégager les canons des ballots qui les encombrent, démonter les cabines dressées pour les passagers de qualité, et dans la pire des situations, jeter par-dessus bord tout ce qui entrave le combat et qui ne peut être rangé.
Se préparer à l’assaut
En cette époque où l’artillerie est lente, peu précise et incapable de décider à elle seule du sort de la bataille, il faut en venir à l’abordage. Le maître d’équipage s’assure que marins et fantassins sont prêts pour cet affrontement où ils vont, non seulement faire face à des semblables, mais aussi aux éléments, à la mer où ils ont toutes les chances de se noyer s’ils tombent à l’eau, sans oublier le navire dont il faut grimper les hautes murailles et dont la mâture en chutant peut faire bien des dégâts.
Comment les commandants préparaient-ils leurs hommes à l’abordage ? On sait qu’ils s’adressaient à eux, mais on n’a pas conservé leurs paroles tout comme les chants à virer dont la plupart se sont perdus faute d’avoir été notés.
A une époque où la foi était un facteur crucial de la vie à bord comme à terre, ce sont les chapelains qui jouaient un rôle clef en confessant les soldats et souvent en les encourageant notamment quand l’adversaire était hérétique.
Les bâtiments parés pour le combat, il s’agit de maintenir la formation et faire voile vers l’ennemi en ambitionnant de garder ou de gagner l’avantage du vent. Les transmissions des ordres sont difficiles, des consignes codées grâce à des pavillons répétés de navire en navire sont vite brouillés par la fumée des canons.
Le commandant qui décide d’aborder cherche à profiter d’un cône de dévent qui lui permet d’avancer vers sa proie tout en la privant du vent nécessaire pour s’échapper ou pour manoeuvrer.
Les canons ne suffisent pas à emporter la décision
La première étape de l’affrontement se pratique de loin. Mais on ignore les distances réelles de combat faute de sources. Les artilleurs jonglent entre des canons différents aux performances inégales et avec une poudre qu’il faut goûter pour en vérifier les qualités. puis vient la mise à feu par enflammage de l’amorce par le boutefeu mais il peut se passer jusqu’à six secondes pour que la charge propulsive explose et projette le boulet. Comment dans ces conditions viser l’ennemi sur un bateau qui roule sans cesse ? La seule solution est de tirer au plus près, en plein bois, quand les mouvements naturels du navire ne peuvent trop nuire à la trajectoire de la munition. Dans ces conditions, l’usage de l’artille relève davantage de l’art de que de la science.
Voilà pourquoi les commandants retardent le moment du premier feu pour ne pas gaspiller leurs moyens, surtout quand recharger une pièce est lent et difficile. La bonne règle de l’époque est de ne tirer qu’à portée de pistolet.
Dans les écrits, l’on considère qu’un équipage qui ne sait pas retenir son feu, qui tire trop tôt, révèle sa peur, comme le dit à ses hommes le capitaine espagnol Martín Vazquez de Montiel lors d’un combat en 1621.
Intrigué par cette citation, inattendue dans le désert d’archives que nous avons décrit, je suis remonté jusqu’à la source grâce à l’appareil de notes minutieux de l’auteur et retrouvé en ligne les clichés de la brochure publiée à Madrid et à Séville en 1621 où l’on lit mot pour mot cette phrase !
A l’abordage !
Lorsque les canons ont craché leur feu, il reste à transformer l’essai et à aborder l’ennemi. Par où le faire ? Si l’assaillant est plus haut, l’équipe d’abordage tombe et risque de se faire piéger par la jareta (voir infra). Dans le cas inverse, les combattants doivent grimper la muraille de l’adversaire. Dans d’autres cas, un commandant adroit oriente sa proue de sorte que le mât de beaupré serve de passerelle d’assaut et les plus agiles peuvent comme des rats profiter des écubiers pour pénétrer à bord.
L’avantage de travailler à partir d’archives et non pas de sources secondaires, c’est que l’on peut retrouver des éléments oubliés comme la « jareta », terme décrivant un équipement des navires dont j’ignorais l’existence. Il s’agit d’une sorte de pont circulant en caillebotis établi entre les deux châteaux pour permettre à l’équipage de se déplacer sans gêner les soldats et les canonniers. En outre, en cas d’abordage, l’adversaire se trouve piégé par ce caillebotis au-dessus du pont et peut facilement être touché par les piques, lances et armes des combattants au-dessous d’eux.
Alexandre Jubelin cite un extrait du Don Quichotte (dans une édition de 1836!) où Miguel de Cervantes décrit les circonstances d’un l’abordage, notamment le péril de tomber à la mer et de se noyer, entraîné par le fond par le poids de son armure et le plus souvent, par son ignorance de la natation.
Une réalité bien différente de la fiction hollywoodienne
Nous avons tous vu d’innombrables films de pirates où l’abordage est pratiquement présenté comme une promenade de santé où quelques loqueteux sourire aux lèvres mettent en déroute des Espagnols reconnaissables à leur caractéristique morion.
Hollywood est bien loin de la réalité. Il faut être un risque-la-mort pour oser se porter en tête de l’assaut et cela méritait alors beaucoup d’honneurs et figurait en bonne place dans les états de service.
En quelques mots, Alexandre Jubelin résume l’abordage d’un navire : « il est difficile d’y entrer, presque impossible d’y prendre pied, interminable enfin de le prendre en entier. »
Sur le pont, règnent désordre et confusion. Sans uniformes, il est compliqué de distinguer l’ami de l’ennemi dans la fumée et d’entendre les ordres tant le bruit est assourdissant. trompettes, cris, hurlements, râles des blessés… C’est encore le temps où soldats et matelots se battent à portée de bras car les armes à feu tirées, il est impossible de les recharger au milieu des ferraillements. Une fois le coup parti, il faut en revenir aux anciennes méthodes qui n’avaient pas beaucoup changé depuis les Romains. Chaque homme combat le visage non reconnu qu’il a en face de lui, se protégeant autant des coups qu’on lui porte que des éléments de mâture qui peuvent lui tomber dessus.
Dans beaucoup de cas, les forces de chaque camp étant assez égales, les affrontements traînent en longueur et la fatigue se fait sentir. C’est la nuit qui met les combats en pause et à bord de chaque navire on s’efforce de réparer les dégâts, de soigner les blessés et de nourrir les survivants.
Une guerre cruelle
C’est sans doute cette proximité du corps de l’autre, le besoin d’une forte motivation pour surmonter la peur bien naturelle du duel homme à homme qui explique la grande cruauté de ces conflits : les mauvais traitements faits prisonniers, les blessés de l’autre camp achevés tout comme les hommes tombés à la mer tués à coups de rame ou de gaffe par des chaloupes dédiées à cette tâche.
D’une certaine manière, la bataille de Gabard en 1653 marque le terminus d’une époque car elle se déroule principalement par une joute d’artillerie où les Anglais profitent de leur supériorité technique pour battre une flotte hollandaise. C’est le début de la fin pour les affrontements navire contre navire où les hommes s’élancent à l’abordage de l’ennemi pour achever un travail que les canons ont à peine commencé.
Il faudra attendre Trafalgar et les vaines tentatives du commandant Lucas du Redoutable pour aborder le Victory pour que l’abordage soit pour la dernière fois envisagé dans le cadre d’une bataille navale.
La déshumanisation de la guerre est un progrès
Le perfectionnement des armes a permis aux hommes de s’occire à distance avec efficacité mais sans avoir besoin d’aviver les sentiments et les passions pour se donner le courage de le faire. C’est malgré tout un progrès car il a rendu possible l’adoption d’usages pour mieux traiter les vaincus, les blessés et même les morts.
Complétons la réflexion d’Alexandre Jubelin en rappelant que l’abandon de l’abordage du fait de l’amélioration des performances de l’artillerie connaît son pendant sur terre. Les batailles en arrivent de moins en moins au corps à corps. Quand on analyse les statistiques des chirurgiens militaires, notamment à l’époque napoléonienne, on constate que les blessures par arme blanche sont marginales. Une troupe qui réussit à franchir le barrage des boulets et des balles brise la ligne ennemie sans avoir besoin d’embrocher le défenseur à la baïonnette.
Un brillant metteur en scène de la mort
Avec cette belle œuvre, Alexandre Jubelin réussit un exercice compliqué : travailler à partir d’archives lacunaires, dispersées et rares. Le résultat qu’il nous livre tire le meilleur parti du matériau qu’il a eu tant de mal à rassembler. Son écriture alerte et précise, nous conduit sans détours excessifs au cœur de son sujet : l’affrontement d’homme à homme dans toute sa cruauté. Excellent metteur en scène de la mort, sous sa plume se rejoue la même tragédie virile que l’humanité répète depuis l’aube des temps : tuer son prochain de ses mains, à terre comme sur le pont de ces navires.
La technique a mis fin à cette chorégraphie mortifère. Avec le progrès, les hommes se tuent à distance sans avoir même besoin de se voir dans le blanc des yeux. Cette déshumanisation de la mort me semble un progrès paradoxal. Mais ce sera peut être le sujet d’un autre livre.
Trystan Mordrel











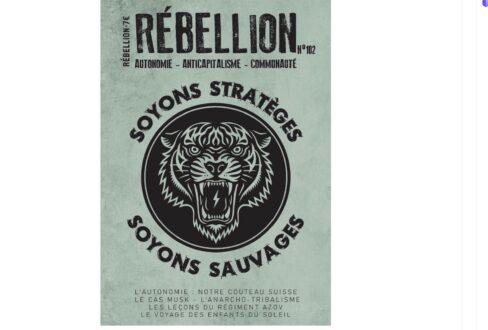





Une réponse à “Par le fer et par le feu, quand l’océan se teignait de sang”
Voilà un beau texte qui va ouvrir les yeux des « débutants » qui connaissent si peu le combat naval.