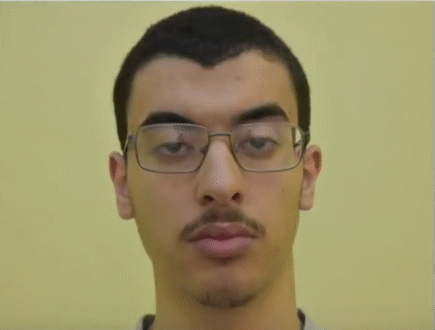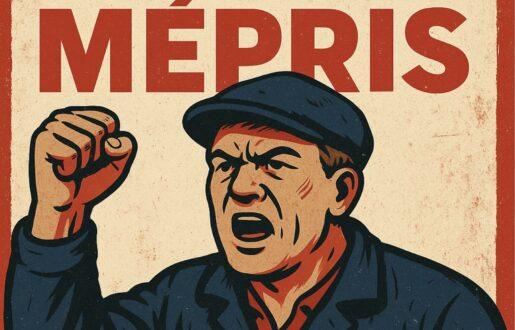Commençons par une anecdote : l’auteur de ces lignes, animateur d’un ciné-club en province, avait co-organisé un festival Bertrand Tavernier en 2008. S’excusant pour la modestie de l’hébergement hôtelier, il s’était entendu répondre par le cinéaste qu’il aurait pu tout aussi bien se contenter d’un matelas par terre… En revanche, lorsque l’une des bobines de L’Aurore de Murnau se cassa en cours de projection, il entra dans une fureur inquiète, comme si l’un de ses proches venait d’être mutilé. Tout Tavernier figure dans ce récit : une passion viscérale pour le septième art, une culture encyclopédique généreuse et volubile et un enthousiasme inaltéré pour les rencontres et le partage.
Un cinéaste lyonnais
Fils d’un grand résistant gaulliste, René Tavernier, fondateur de la revue Confluence, Bertrand Tavernier, né à Lyon en 1941, vit dans l’ombre du grand homme et n’aura de cesse de s’émanciper de cette tutelle intellectuelle. À cette fin, il opte pour un domaine que son littéraire de père n’a pas investi, à savoir le cinéma. Monté à Paris, il écume très tôt les salles de répertoire et fonde, au tout début des années 60, le Nickel-Odéon, un ciné-club qui met à l’affiche les petits maîtres du cinéma américain, avant de travailler comme assistant pour Melville (qu’il vilipende) ou attaché de presse pour Kubrick (qu’il fustige). Cette fascination pour le cinéma américain le conduira pourtant à ne faire le grand saut transatlantique que pour une seule réalisation : Dans la brume électrique (2009), un polar moite et spiritiste. Français jusqu’aux bout des ongles, Tavernier s’épanouit dans la langue et la culture du pays, comme en témoigne son premier (et peut-être meilleur) film, L’Horloger de Saint-Paul (1974), première collaboration d’une longue série avec Philippe Noiret. Bouchons lyonnais, traboules, déambulations le long de la Saône : rarement décor aura été à ce point accordé au paysage intérieur d’un protagoniste, dont la sécurité affective se fissure brutalement. Il y reviendra pour le très juste et émouvant Une semaine de vacances (1980), autre film de crise.
Engagé mais pas militant
Clairement situé du côté de la gauche humaniste, Tavernier a toujours filmé des êtres, jamais des idées. Qu’il ancre ses intrigues dans le passé (Que la fête commence, 1976, truculent et irrévérencieux, Le Juge et l’assassin, 1979, où Galabru bouleverse dans un rôle tragique, Coup de torchon, 1981, farce anticoloniale acide et jubilatoire, La Passion Béatrice, 1987, La Vie et rien d’autre, 1990, sur la quête fiévreuse du Soldat inconnu, Capitaine Conan, 1994, La Princesse de Montpensier, 2010, et surtout son chef-d’œuvre : Un dimanche à la campagne, 1984, méditation douce-amère sur les promesses et déceptions d’une vie, au seuil de la mort) ou dans l’aridité sociale du monde contemporain (Des Enfants gâtés, 1977, L 627, 1992, Ça commence aujourd’hui, 1999, Holy Lola, 2004), Tavernier montre avant tout des hommes et des femmes confrontés à leurs contradictions, à celles du cadre où ils évoluent, mais ne juge jamais. Sa sympathie va bien sûr aux faibles et aux victimes, mais chez lui même les salauds ont leurs raisons et semblent plus misérables que détestables.
Tavernier est revenu présenter chacun de ses nouveaux films dans mon ciné-club, jusqu’à Quai d’Orsay (2013), une incursion très réussie dans le domaine de la comédie. Semblable aux paysans pudiques qui ne saluent pas d’un : « Comment vas-tu ? » mais commentent la couleur du ciel et la forme des nuages, Tavernier débutait chaque rencontre par : « Quels films avez-vous vu récemment ? » : la civilité d’un grand artiste.
Sévérac
Crédit photo : Andy Miah/Wikimedia (cc)