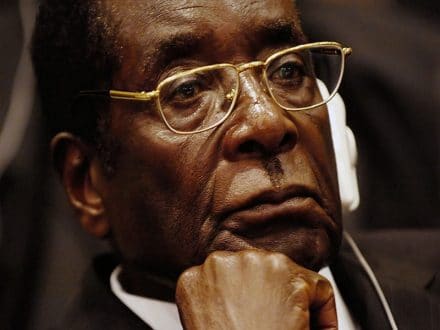En avril 2009, Hajnalka Vincze publiait un article qui n’a pas pris une ride en 10 ans sous le titre: « Le général face à l’OTAN: Une analyse toujours actuelle ». Elle expliquait dans une analyse de 6 pages, argumentée et émaillée de citations du général de Gaulle, pourquoi celui-ci avait pris la décision de se retirer de l’organisation militaire intégrée de l’OTAN, pourquoi son argumentaire était toujours valable et quelles avaient été les conséquences de la décision de 1966 sur la position de la France, sur la politique intra-européenne et sur les relations avec les États-Unis.
Parce qu’on évoque beaucoup aujourd’hui la prochaine « révision du concept stratégique de l’OTAN », cet article garde toute son importance. L’argumentaire développé par Charles de Gaulle de apparaît en effet plus que jamais valide en septembre 2019.
Général (2s) Dominique Delawarde
Une des formules récurrentes dans les discussions sur le plein retour de la France à l’OTAN, quoique admise de tous côtés comme une évidence, mérite néanmoins que l’on s’y arrête un instant. Il s’agit du contexte géostratégique qui aurait subi, paraît-il, d’énormes changements. De prime abord, c’est un truisme: l’URSS a disparu, la guerre froide est terminée, si bien que le Général de Gaulle et ses chamailleries avec l’OTAN semblent résolument appartenir au passé. En réalité, aucune des mutations, certes indiscutables, de ces quarante dernières années n’est de nature à remettre en question le bien-fondé de la décision de 1966. A y regarder de plus près, on dirait plutôt qu’elles le confirment.
Une décision bien mesurée
Premièrement, il est certain qu’avec la décision du retrait des structures militaires intégrées de l’Alliance (de même qu’avec celle du développement de la force de dissuasion nucléaire indépendante, les deux initiatives ayant été liées chronologiquement et conceptuellement), De Gaulle ne se plaçait pas dans un horizon de 10 ans. Il entendait organiser le cadre de la politique étrangère et de défense de la France sur la base de postulats stratégiques qui résistent au temps.
Comme il disait au sujet de la force de frappe «tous azimuts»: «On ne sait jamais d’où peut venir la menace, ni d’où peut venir la pression ou le chantage. Un jour ou l’autre, il peut se produire des événements fabuleux, des retournements incroyables. Personne ne peut dire d’avance où se situera le danger. Et comme il faut vingt ans pour se mettre en mesure d’y parer, alors prenons tout de suite nos dispositions».
Deuxièmement, si le contexte géostratégique a certes été chamboulé, les caractéristiques fondamentales des relations transatlantiques, elles, sont restées intactes. Pour Charles Kupchan, ex-directeur des affaires européennes sous le Président Clinton: «En dépit de tout ce qui a changé depuis 1949, et en particulier depuis 1989, l’Europe reste dépendante des États-Unis pour gérer sa sécurité». Or, précise-t-il par la suite, «le contrôle en matière de sécurité est le facteur décisif pour déterminer qui est aux commandes».
Ce n’est pas un hasard si le Livre blanc sur la Défense rédigé en 1994, lequel énumérait déjà la plupart des nouvelles pistes et tendances de l’Alliance, conclut que «Ces différentes évolutions ne sont pas de nature à modifier notre situation militaire particulière au sein de l’OTAN. Les principes posés en 1966 (non-participation à l’organisation militaire intégrée, libre disposition de nos forces et de notre territoire, indépendance de notre force nucléaire, liberté d’appréciation des conditions de notre sécurité en période de crise, liberté de choix de nos moyens en cas d’action) continueront de guider nos relations avec l’organisation militaire intégrée».
Troisièmement, si changement il y a, c’est non pas dans le sens de l’effacement, mais dans celui du verrouillage et de la mise à nu des pesanteurs identifiées jadis par le Général. Verrouillage, parce qu’un demi-siècle de soumission de la part des gouvernements européens n’est pas sans laisser des traces profondes, à la fois matérielles (dépendance industrielle et technologique) et psychologiques (esprit de servilité et d’autocensure des élites) dans la plupart des pays du vieux continent. Mais aussi mise à nu, parce qu’avec la disparition du spectre de la menace soviétique, les tentatives de justification de la servitude volontaire et institutionnalisée deviennent soudain beaucoup plus fragiles.
Finalement, lorsque le 7 mars 1966 le général De Gaulle adressa au Président Johnson la lettre manuscrite où il écrit que «la France se propose de recouvrer sur son territoire l’entier exercice de sa souveraineté, actuellement entamée par la présence permanente d’éléments militaires alliés, et de ne plus mettre de forces à la disposition de l’Organisation atlantique», le cadre conceptuel de l’initiative française est déjà tout prêt et il est sans faille.
Si l’Élysée avait demandé au Quai d’Orsay de préparer des dossiers sur «l’occupation américaine en France», la formulation officielle élaborée par les diplomates est infiniment plus subtile et reste aujourd’hui tout aussi valable. La position française se singularisera dorénavant par une double approche, basée sur la distinction entre l’Alliance, dont Paris se considère toujours membre à part entière, et l’organisation militaire intégrée, sous direction et contrôle américains, dont la France décide alors de se retirer.
Historiquement, cette distinction a tout lieu d’être – en témoigne, par ailleurs, un des ouvrages recommandés aujourd’hui sur le site Internet de l’OTAN, qui porte le beau titre L’Alliance atlantique et l’OTAN, 1949-1999 : un demi-siècle de succès.
Pour De Gaulle, il ne doit pas y avoir de confusion entre «la déclaration sous forme du traité de l’Alliance Atlantique signé à Washington le 4 avril 1949» qui reste «toujours valable», et l’organisation militaire bâtie au sein de cette Alliance en vertu de «mesures d’application prises par la suite» qui «ne répondent plus à ce que la France juge satisfaisant, pour ce qui la concerne, dans les conditions nouvelles». Car aux yeux du Général, «les raisons qui, pour l’Europe, faisaient de l’alliance une subordination s’effacent jour après jour».
Un argumentaire toujours pertinent
En effet, le Président De Gaulle insista volontiers sur « les conditions nouvelles ». Mais au lieu de tomber dans le circonstanciel, il avait construit autour d’elles un raisonnement qui n’a pas pris une ride. Bien au contraire. Les divers éléments évoqués par le Général soit se manifestent de manière encore plus marqué aujourd’hui, soit ils n’ont cessé de se confirmer depuis.
Dès le début des années 1960, il était clair que les Européens s’étaient relevés des ruines où ils se retrouvèrent au lendemain de la Seconde guerre mondiale, ce qui n’était pas sans modifier la donne transatlantique. D’après De Gaulle: «les pays de l’Europe continentale, en particulier la France, ont repris leur équilibre et leur essor, et par conséquent, à mesure que cela se fait, ils reprennent conscience d’eux-mêmes en particulier pour ce qui concerne leur défense». Or, aussi enthousiaste que soit l’Amérique pour la (re)construction européenne, son souci principal est d’en garder le contrôle.
En 2004, Zbigniew Brzezinski, chef de file des milieux démocrates en matière de diplomatie et de sécurité eut l’obligeance de nous expliquer le comportement US à ce sujet: «Avec le potentiel économique de l’UE qui équivaut déjà celui de l’Amérique et avec les deux entités déjà se heurtant dans les domaines financier et commercial, une Europe militairement émergente pourrait devenir une formidable concurrente pour l’Amérique. Elle constituerait inévitablement un défi à l’hégémonie US. Une Europe politiquement forte, capable de rivaliser en matière économique, et qui ne serait plus militairement dépendante des États-Unis remettrait inévitablement en cause la suprématie américaine et confinerait la sphère de la prédominance des USA grosso modo à la région du Pacifique.»
Un autre argument choc du Général eut trait à la reconfiguration de l’échiquier nucléaire à l’époque. Pour lui, les nouvelles conditions (par rapport à celles de la mise en place de l’organisation militaire intégrée sous l’égide de l’Alliance atlantique) signifiaient avant tout que «se réduisait aussi la garantie de sécurité, autant vaut dire absolue, que donnaient à l’ancien continent la possession par la seule Amérique de l’armement atomique et la certitude qu’elle l’emploierait sans restriction dans le cas d’une agression. Car, la Russie soviétique s’est, depuis lors, dotée d’une puissance nucléaire capable de frapper directement les États-Unis, ce qui a rendu, pour le moins, indéterminées les décisions des Américains quant à l’emploi éventuel de leurs bombes et a, du coup, privé de justification — je parle pour la France — non certes l’alliance, mais bien l’intégration».
En effet, avec son projet de bouclier antimissile Washington vise à retrouver cette perception d’invulnérabilité de l’ère où il avait encore le monopole du nucléaire, dans l’espoir que ceci lui donnera la crédibilité nécessaire pour le maintien sous tutelle de ses amis et alliés.
Mais c’est sans compter avec le discrédit inhérent qui entoure, depuis toujours, les soi-disant garanties américaines. De Gaulle eut la courtoise de s’en tenir aux interrogations sur la stratégie nucléaire, et de ne pas achever, une fois pour toutes, le mythe de l’engagement US.
Depuis lors, l’ouverture des archives, ainsi que les événements récents, ont bien mis en lumière le caractère foncièrement factice de ce que l’on appelait à l’époque le «pledge» (ou promesse). L’historien Lawrence L. Kaplan décrit d’une façon admirablement détaillée, dans son ouvrage NATO divided, NATO united: the Evolution of an Alliance, les négociations extrêmement difficiles lors de la rédaction du Traité de Washington, au sujet du fameux Article 5.
Les Européens auraient voulu un engagement automatique de la part des États-Unis, à l’instar de celui signé dans le traité de Bruxelles de 1948 entre la France, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique. L’Amérique, elle, n’avait nullement l’intention de se souscrire à une telle obligation.
Ses négociateurs ont absolument tout fait pour l’éviter, jusqu’à ce qu’ils soient parvenus à faire accepter cette formule définitive contenue dans l’Article 5 (clef-de voûte de la prétendue défense collective): en cas d’attaque, les parties «conviennent que chacune d’elles assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire». Des mots repris 50 ans plus tard, quand à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001 les alliés européens se sont empressés d’activer, pour la toute première fois, le fameux article, mais en prenant le soin de préciser qu’il n’en découlerait aucune action militaire automatique.
Les circonstances n’étaient certainement pas celles que les négociateurs du traité avaient eues en tête, mais elles illustrent bien la pertinence du constat que De Gaulle fit déjà il y a un demi-siècle: «Il est bien clair, en effet, que le monde occidental n’est plus aujourd’hui menacé comme il l’était à l’époque où le protectorat américain fut organisé en Europe sous le couvert de l’OTAN».
La supposée menace des chars soviétiques continuant de servir, néanmoins, d’alibi commode pour la tutelle US sur le continent, on imagine bien l’embarras des braves diplomates américano-otaniens au moment de l’effondrement de l’URSS. Mais ils se sont repris sans trop de délai: «L’Alliance n’a pas besoin d’ennemi pour exister», déclare le secrétaire général (1988-1994) Manfred Wörner. Pour Washington, la disparition de l’Union soviétique n’enlève rien à la «mission politique» de l’OTAN: «Celle-ci a toujours été bien plus qu’une réponse transitoire à une menace transitoire. Sa mission perdure même si la guerre froide appartient au passé», estime au printemps 1995 le secrétaire d’État américain Warren Christopher.
Un autre développement, identifié lui aussi par De Gaulle, fut la multiplication des conflits marginaux ou mineurs (on parlerait aujourd’hui de guerres de choix, par opposition aux guerres de nécessité ou de survie). Avec toutes les difficultés que ceci comporte pour une alliance où «les valeurs partagées et les intérêts communs» ne sont souvent qu’une belle fleur de rhétorique. Et surtout pour ceux de ses États membres qui, du fait de leur subordination structurelle à la puissance tutélaire, risqueraient de se trouver entraînés, malgré eux, dans des situations conflictuelles sur l’évolution desquelles ils n’auraient aucune prise.
D’après le Général: «D’abord, on a vu que les possibilités de conflit, et par conséquent d’opérations militaires, s’étendaient bien au-delà de l’Europe, et qu’à leur sujet il y avait entre les principaux participants de l’Alliance atlantique des divergences politiques qui pourraient, le cas échéant, tourner en divergences stratégiques». De surcroît, «des conflits où l’Amérique s’engage dans d’autres parties du monde, risquent de prendre, en vertu de la fameuse escalade, une extension telle qu’il pourrait en sortir une conflagration générale. Dans ce cas, l’Europe, dont la stratégie est, dans l’OTAN, celle de l’Amérique, serait automatiquement impliquée dans la lutte lors même qu’elle ne l’aurait pas voulu.». Des propos prémonitoires, a fortiori à la lumière de la récente aventure irakienne.
En effet, au cœur de l’argumentaire gaullien se trouve l’impératif de l’indépendance et du libre arbitre. «Au total, ils ‘agit de rétablir une situation normale de souveraineté, dans laquelle ce qui est français, en fait de sol, de ciel, de mer et de forces, et tout élément étranger qui se trouverait en France, ne relèveront plus que des seules autorités françaises.» Une exigence à comparer avec la situation des Britanniques qui, en plus de se positionner comme les meilleurs valets d’armes de l’Amérique dans ses expéditions militaires à l’extérieur, ont également renoncé à rester les maîtres chez eux. Au point de se voir obligés de s’enquérir auprès de Washington s’ils veulent avoir une idée de ce qui se passe sur leur propre sol.
Pour preuve, l’affaire des vols de la CIA. Un mémo ébruité du Foreign Office (ministère britannique des Affaires étrangères) précise que «le gouvernement ne savait pas combien de fois les États-Unis avaient utilisé des aéroports britanniques pour leurs activités de reddition, qui furent illégales dans la plupart des cas». Ceci devient moins surprenant si l’on sait que, par exemple, le site officiel consacré par l’ US Air Force à la base aérienne Royal Air Force Lakenheath, située à 70 lieues de Londres, la définit comme «la plus grande base gérée par les forces aériennes des États-Unis en Angleterre».
Les fervents atlantistes en Europe feraient mieux de s’intéresser à de tels détails, ainsi qu’à la question, plus globale, de l’esprit de défense, un des leitmotives des réflexions du Général. Celui-ci insiste sur «le droit et le devoir des puissances européennes continentales d’avoir une Défense nationale qui leur soit propre. Il est intolérable à un «grand État» que son destin soit laissé aux décisions et à l’action d’un autre État, quelque amical qu’il puisse être. En outre, il se produit que, dans l’intégration — car c’est l’intégration que j’évoque — le pays intégré est amené à se désintéresser de sa Défense nationale puisqu’il n’en est pas responsable. Alors tout l’ensemble de l’Alliance y perd de son ressort et de sa force».
Or les alliés européens illustrent ce dernier cas de figure à merveille. Ce n’est pas un hasard si l’Amérique les désigne, à répétition, comme des «passagers clandestins» (ou free-riders).
Ils apportent la réponse vivante à la question rhétorique du Général: «Comment, en effet, un gouvernement, un Parlement, un peuple, à la longue, pourraient-ils apporter, de toute leur âme, leur soutien – en temps de paix par leurs dépenses et leurs services, en temps de guerre par leurs sacrifices – à un système ou leur propre défense ne résulterait pas de leurs propres responsabilités ?».
Des répercussions édifiantes
Pour ce qui est des conséquences de la décision de 1966 sur la position de la France, sur la politique intra-européenne et sur les relations avec l’Amérique, on ne citera que quelques observateurs et acteurs anglo-saxons (US ou britanniques). En commençant par les réactions les plus récentes, avant de remonter dans le temps.
Dans un papier paru mi-mars 2009 dans le International Herald Tribune, l’excellent historien et commentateur américain William Pfaff dresse un bilan plutôt flatteur de la stratégie gaullienne: «Depuis De Gaulle, la France maintient une relation coopérative avec l’OTAN, ce qui lui a permis de fonctionner en alliance avec l’OTAN quand c’était désirable, et de fonctionner suivant ses propres intérêts lorsque c’était son choix. C’est le seul État européen à avoir une force de dissuasion nucléaire indépendante, et des forces terrestres, aériennes et navales qui opèrent de manière autonome, sous commandement national – ce qui ne peut pas être dit d’aucune autre puissance de l’Europe occidentale. Ceci lui a valu une influence internationale plus importante que celle de n’importe quel autre pays européen.»
Mais le Général n’a pas fait «que» conforter le statut et la position de la France sur la scène internationale pour les décennies à venir, il a également été visionnaire pour l’ensemble de l’Europe. Dans le livre intitulé Defending Europe: The EU, NATO and the Quest for European Autonomy, paru en 2003 sous sa direction, l’un des meilleurs connaisseurs des questions de sécurité européenne, l’expert britannique Jolyon Howorth note que «à beaucoup d’égards, les positions que la France avait défendues tout au long de l’histoire de l’OTAN sont celles sur lesquelles tous les pays de l’UE sont en train de s’aligner (avec plus ou moins d’enthousiasme) en ce moment». Du moins pour ce qui est de la nécessaire mise en place d’une politique de défense européenne en dehors des cadres de l’Alliance.
De façon illustrative, mais avec une franchise inhabituelle dans les milieux bruxellois, Robert Cooper, l’éminence grise de Javier Solana et directeur général des Affaires externes et politico-militaires du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne, n’a pas hésité à écrire dans son livre (The Breaking of Nations, 2004) que: «c’est extrêmement insatisfaisant que 450 millions d’Européens dépendent tellement de 250 millions d’Américains pour leur défense. Il n’y a pas de défense gratuite. A un point ou un autre, les Européens vont devoir payer pour ces arrangements. Rien ne garantit que les intérêts américains et européens vont toujours se coïncider». On croirait lire un émule du Général…
Certes, les réactions US immédiates à la nouvelle du retrait français de l’OTAN furent beaucoup moins enthousiastes. Mais non moins éclairantes, à tous égards. En règle générale, la réponse de Washington aux velléités d’indépendance de ses alliés/vassaux oscille entre la dramatisation et le dénigrement.
Pour l’exemple, les initiatives visant à l’émancipation de l’Europe de la Défense entraînent aujourd’hui soit des moqueries du type «sommet des fabricants de chocolat» (c’est ainsi que la réunion des dirigeants français, belge, allemand et luxembourgeois en vue de la création d’un quartier général autonome fut qualifié par un porte-parole du Département d’État), soit des sorties hystériques comme la mise en garde, par le Secrétaire d’État à la Défense du Président Clinton, que l’OTAN deviendrait «une relique du passé» si les Européens entendaient sortir de la tutelle des États-Unis.
Cette même ambivalence fut manifeste à l’époque du Général. Dès l’annonce du retrait français, une circulaire du Département d’État, adressée à tous les ambassadeurs américains dans les pays de l’OTAN, ridiculise les «idées personnelles du président français, largement fondées sur sa croyance messianique en la gloire de la France». En ajoutant, si besoin était, que l’on doit y «accorder peu d’importance». Ceci n’a pas empêché un porte-parole de la Maison-Blanche de parler d’«un coup de poignard au cœur de l’Alliance», ni le Secrétaire d’État Dean Rusk de demander au Général si l’ordre donné aux forces US de quitter le sol français «concernait aussi les soldats américains gisant dans les cimetières militaires».
Nonobstant le côté théâtral, l’analyse que l’on faisait à Washington de la politique gaullienne fut beaucoup plus réaliste et pertinente que l’on ne pourrait croire. D’une part, l’Amérique était consciente du risque de contagion que représentait la posture d’indépendance de la France à l’intérieur de son protectorat. Henry Kissinger, conseiller de sécurité nationale, puis Secrétaire d’État des Présidents Nixon et Ford, l’admet dans ses Mémoires: «Au cours des années 60, notre politique européenne consista en grande partie à s’efforcer en vain d’isoler la France et de lui faire payer sa conduite».
Dans le même temps, les dirigeants américains ne s’y trompaient pas. La politique de souveraineté menée par le Général de Gaulle n’était mue ni par une soi-disant nostalgie cocorico ni par un quelconque anti-américanisme, mais par des principes stratégiques aussi légitimes qu’immuables. D’après le Président Nixon, la vie du Général de Gaulle fut «une épopée de leadership rarement égalée dans l’Histoire, leadership qui a maintenant redonné à cette grande nation, la France, la juste place qui lui revient». Pour lui, l’Amérique «considérait le général de Gaulle comme un allié fidèle du temps de guerre et un véritable ami du temps de paix».
Double leçon à retenir, pour les responsables européens d’aujourd’hui.
Primo, si Washington tourne en dérision nos efforts d’émancipation, cela signifie qu’ils sont assez sérieux pour que les États-Unis commencent à craindre pour leur contrôle sans partage: on est donc sur la bonne voie.
Secundo, une telle démarche d’autonomie n’irrite l’Amérique que dans la mesure où il lui est plus commode d’avoir pour alliés des interlocuteurs sans réel pouvoir de négociation/contestation. Or parmi ceux qui se résignent à la dépendance et à la subordination, le maître n’a ni partenaires ni amis – il n’a que des serviteurs et des vassaux.
Hajnalka Vincze
Senior Fellow au «Foreign Policy Research Institute» de Philadelphie, spécialisée dans les politiques européennes et transatlantiques, Hajnalka Vincze est une spécialiste reconnue de toute les questions relatives à l’OTAN. Co-fondatrice de l’Institut (français) de Veille et d’Étude des Relations Internationales et Stratégiques (IVERIS) elle travaillait précédemment, entre 1997 et 2004, comme chercheur en charge des questions de sécurité transatlantique et de la défense européenne à l’Institut des Études Stratégiques du Ministère hongrois de la défense. Elle publie dans des livres, journaux ou revues spécialisées de plusieurs pays de l’alliance Atlantique, intervient à des séminaires et colloques, donne des cours dans des universités, et participe à des émissions radiophoniques et télévisées. Elle est collaboratrice du site de défense THEATRUM BELLI et contribue régulièrement à la revue (française) Défense & Stratégie en matière d’armement/politique de défense, ainsi qu’à The Federalist sur les enjeux stratégiques de la construction européenne.
Source : La lettre sentinel
crédit photo : DR