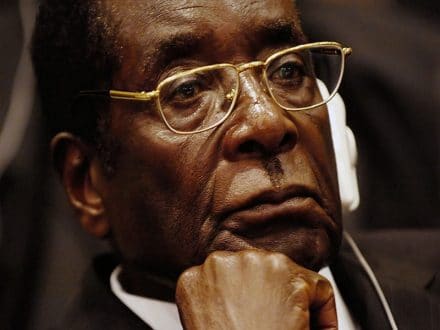Avec son dernier livre, Philippe de Villiers a remis en lumière la vie et l’action de Jean Monnet. Plus américain que les Américains, ce dernier avait toujours un coup d’avance… Oeuvrant dans les coulisses, il savait manipuler les politiques.
Un travail d’enquête approfondi
Grosse polémique en ce moment à propos du dernier ouvrage de Philippe de Villiers J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu (Fayard). Un premier tir de barrage avec une page dans Le Monde (jeudi 28 mars 2019) dans laquelle une troupe d’historiens dénonce le travail du vendéen. Que des interprétations excessives, des rapprochements hâtifs ou une absence de prise en compte du contexte historique parsèment parfois le livre, c’est certain. Mais là ne repose pas l’essentiel. En effet, son intérêt porte d’abord sur les 111 pages de pièces et de documents déclassifiés qu’il contient. De l’indiscutable que les esprits critiques oublient de noter. « Une œuvre d’historien ? J’éclate de rire », s’exclame Eric Roussel, à qui l’on doit une biographie de Jean Monnet (Fayard, 2017). Possible, mais on ne peut pas retirer à de Villiers un travail d’enquête approfondi : les documents qu’il publie étaient inconnus à ce jour. Mieux vaut un journaliste fouineur qu’un historien insuffisant !
L’homme des Américains
Donc les gens du Système font feu sur de Villiers qui commet le « crime », à leurs yeux, de mettre les pieds dans le plat à propos du « père de l’Europe », Jean Monnet. Sujet tabou. Il est interdit de rappeler, par exemple, que le président du « Comité pour les États-Unis d’Europe » a été toute sa vie l’homme des Américains. « Jean Monnet n’avait rien d’un féal », insiste Éric Roussel dans une plaidoirie en faveur de l’enfant de Cognac. Le titre donne la tonalité du texte : « Monnet n’était pas le vassal des États-Unis » (Le Figaro, mardi 26 mars 2019). Exact. Il n’avait pas besoin d’être le « vassal » des États-Unis puisqu’il était leur domestique. À leur service exclusif. Pour s’en convaincre, il suffit de lire ses Mémoires (Fayard, 1976). Toute sa vie, toute son action politique se déroulent dans les bagages du patron américain. Pour lui, Washington est ne nombril du monde. Dès 1936, on le trouve dans la capitale américaine. Présidents des Etats-Unis (Roosevelt, Kennedy), ministres, dirigeants de partis et de syndicats, banquiers, avocats de haut niveau, journalistes, patrons des grandes entreprises, sont ses amis ; il connaît tous les gens importants des « States » : ceux qui dirigent, ceux qui font l’opinion et ceux qui financent.
Antigaulliste farouche, il sera le conseiller – envoyé par Roosevelt – du brave général Giraud à Alger en 1943. Son plus grand « exploit » : avoit torplillé le « traité d’amitié et de coopération » que Konrad Adenauer et Charles de Gaulle signèrent à l’Élysée (22 janvier 1963). « Deux fois par an, prévoit le texte, doit avoir lieu entre les deux pays une rencontre au plus haut niveau ; tous les trois mois, les responsables des Affaires étrangères, de l’Agriculture et de la Défense ont l’obligation de se consulter ; enfin est prévue la création d’une commission destinée à promouvoir les échanges de jeunes. » (Jean Monnet, Éric Roussel).
Le sabotage du traité franco-allemand (1963)
Cet embryon d’Europe politique – une Europe européenne distincte de l’Europe atlantiste – ne convient pas à Jean Monnet : « Je voyais que le traité ne disait pas que la concertation de la stratégie franco-allemande se ferait au sein de l’OTAN. J’entendais de Gaulle parler dans une nouvelle conférence de presse des « aréopages internationaux » auxquels la France ne pouvait sans abdiquer transmettre sa souveraineté. Entre-temps, nous avions établi un texte interprétatif que les stratèges parlementaires traduisirent en forme de préambule qui fut voté à l’unanimité par le Bundestag le 25 avril. On y évoquait « le maintien et le renforcement de la cohésion des peuples libres, et en particulier une étroite coopération entre les Etats-Unis et l’Europe, la défense commune dans le cadre de l’OTAN, l’union de l’Europe y compris la Grande-Bretagne ». Ce préambule et cette unanimité remettaient les choses en l’état, et le traité ainsi compris perdait son caractère d’alliance exclusive pour devenir une expression administrative de la réconciliation franco-allemande décidée douze ans plus tôt, avec le plan Schuman » (Jean Monnet, Mémoires). L’Europe politique était ainsi enterrée puisque le traité était vidé de sa substance grâce au préambule.
Pour Monnet, de Gaulle était l’homme à abattre
Pour Monnet, de Gaulle était l’homme à abattre, rappelle Jean-Pierre Chevènement. Dans une note adressée à Harry Hopkins, conseiller de Franklin Roosevelt, au printemps 1943, il écrit des phrases terribles : de Gaulle « est un ennemi du peuple français et de ses libertés (…) Il est un ennemi de la reconstruction européenne dans l’ordre et la paix (…), en conséquence il doit être détruit, dans l’intérêt des Français, des Alliés et de la paix » (Valeurs actuelles, 28 mars 2019).
Le rôle de René Pleven
Difficile de parler de Jean Monnet sans évoquer le rôle joué par René Pleven à ses côtés. En 1927, ce dernier devient l’adjoint de M. Monnet, devenu le patron de la « Blair and Monnet Inc. », banque associée à la Chase Manhattan Bank. Quand en 1939, Jean Monnet se retrouve président du « Comité de coordination franco-britannique » installé à Londres, son bras droit s’appelle évidemment René Pleven ; cet organisme a pour mission d’établir un programme des besoins et un inventaire des ressources des deux pays ; il s’agit de coordonner l’effort de guerre de la Grande-Bretagne et de la France, tout particulièrement dans le domaine des achats d’armements et de matières premières. Mais, avec Jean Monnet, la politique n’est jamais très loin. René Pleven et lui montèrent la fameuse opération « Union franco-britannique » qui prévoyait que la France et la Grande-Bretagne « ne seront plus, à l’avenir, deux nations, mais une seule Union franco-britannique (16 juin 1940). L’affaire échoua, Monnet partit à Washington et Pleven fut l’un des premiers ralliés à de Gaulle.
Monnet, un homme d’affaires qui pensait le marché
Un « détail » conté par Éric Roussel montre bien à qui on a affaire avec Jean Monnet. « Il avait l’habitude d’employer comme langue de travail l’anglais, même avec ses collaborateurs français, René Pleven notamment ». Il l’utilise en famille et rédige son testament en anglais… Lorsqu’il revient en France en 1944, sa fille doit apprendre le français. (Jean Monnet, Éric Roussel, Fayard). Toute sa vie attiré par les États-Unis, mondialiste dans l’âme, Jean Monnet avait une devise qui résumait bien son positionnement idéologique : « Nous ne coalisons pas les États, nous unissons des hommes ». Jean-Pierre Chevènement résume la chose ainsi : de Gaulle « croyait en la France et Jean Monnet, qui était un homme d’affaires, pensait le marché » (Valeurs actuelles, 28 mars 2019).
Bernard Morvan
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2019, dépêches libres de copie et de diffusion sous réserve de mention et de lien vers la source d’origine