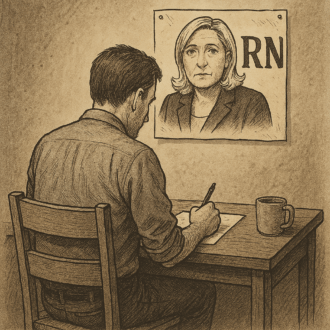11/03/2016 – 07h30 Ploërmel (Breizh-info.com via Centre d’Histoire de la Bretagne) – En 1864, Giacomo Meyerbeer meurt quand Ludovic-Désiré-Joseph-Marie Jan voit le jour à Ploërmel, le 17 mai. Cinq ans auparavant, le musicien venait de donner, avec un grand succès, la première de son opéra-comique Dinorah ou le Pardon de Ploërmel, qui eut un tel succès que pour les publics de Paris, de Gotha, de Bruxelles, de Londres…, le modeste bourg morbihannais n’était plus inconnu.
1864, c’est aussi l’année où les Frères de Ploërmel arrivent en Haïti…
Un enfant né sous ces auspices ne pouvait manquer de s’intéresser aux Beaux-Arts ni de rêver à ces terres mystérieuses d’Outremer.
Des témoins l’ont décrit comme un enfant timide et craintif. Il faut dire que son père meurt alors qu’il n’a que douze ans. Sa famille appartient à la toute petite bourgeoisie locale.
Ludovic passe cinq ans à l’école communale et dix ans au petit séminaire de Ploërmel, le seul établissement de proximité où l’on puisse alors faire ses humanités. Cette période du collège semble avoir été difficile : il ne s’y plaît pas, ses résultats sont médiocres, son père décède. Il se sent désormais un peu délaissé et il est malmené par ses maîtres qui se méfient d’un enfant apparemment renfermé. Quand il rentre chez lui, sa consolation est de s’enfermer dans le cabinet paternel et de lire les quelques ouvrages de poésie qui s’y trouvent par chance. Il y découvre le réconfort nécessaire et le moyen d’échapper pour quelques heures à Ploërmel, au collège, à ces prêtres autoritaires qu’il n’aime pas et qui ne l’aiment pas.
En troisième, il se découvre un goût pour l’écriture, qui ne va faire que croître. Ses maîtres sont étonnés de ce talent soudain chez un élève qu’ils ont condamné à n’être qu’un médiocre et d’autant plus médiocre qu’il ne semble pas accorder à ses devoirs de chrétien tous les soins qu’il devrait. Ils voient dans ce talent soudain quelque chose de sournois, voire de diabolique et ce ne sont pas les quatrains satiriques écrits contre les surveillants qui les feront changer d’avis.
À dix-huit ans, il commence ses études de philosophie et utilise son nouveau savoir pour manifester encore davantage son indépendance de caractère. Un de ses maîtres de l’époque confiera plus tard avec quelque acrimonie :
« C’était un jeune homme d’humeur un peu farouche et même bizarre aux yeux du vulgaire. Il détestait le monde et se renfermait dans son rêve. Il s’ennuyait de tout et probablement se moquait même de sa muse. Le bourgeois terre à terre et sans idéal lui était surtout en horreur. » Et le bon père terminera son portrait en le qualifiant de « mauvais esprit ». Détester le bourgeois n’a alors rien de bien original chez les jeunes gens sensibles, mais pour Ludovic Jan englué dans le quotidien de sa petite ville, il n’y a qu’une échappatoire : la poésie.
Ludovic Jan choisit d’entrer aussi vite qu’il le peut dans la vie professionnelle pour assurer son indépendance. Il trouve un emploi de stagiaire chez un pharmacien de Ploërmel, puis change d’officine pour incompatibilité d’humeur : le nouveau pharmacien est comme lui féru de littérature et moins à cheval sur les horaires de travail. Il sait que ce jeune homme écrit et il lui laisse, disons, la bride sur le cou. Ce seront quatre années de lecture et d’écriture grâce à cet étonnant mécène, quatre bonnes années au cours desquelles il participe à des concours de poésie, est lauréat, correspond avec des écrivains et des poètes, retient l’attention de Louis Tiercelin pour la qualité de ses textes et commence à publier.
Il va alors habiter à Rennes avec l’intention de suivre les cours de pharmacie, mais, ayant fait la connaissance d’un greffier du IIIe arrondissement de Paris, fou de poésie, il abandonne ses projets et décide de se faire commis-greffier, une occupation susceptible de lui permettre de vivre de façon indépendante et d’avoir assez de loisirs pour continuer à courtiser les muses. À Rennes, il fréquente les membres du Parnasse Breton puis l’équipe de l’Hermine, les cafés du côté des Portes Morlésiennes…
Au bout de deux années de greffe et de poésie, de bohème rennaise, il rentre à Ploërmel fin 1890 et suit les objurgations de sa mère qui lui propose de placer sa modeste part d’héritage paternel dans l’achat de la charge de greffier de la justice de paix à Caulnes, près de Dinan. Il se mariera d’ailleurs peu après. Ce brusque changement dans sa vie est sans doute dû à cette perspective de mariage, qui, elle-même, surprend : Ludovic deviendrait-il un de ces bourgeois détestés ?
Le 15 décembre, il devient titulaire du greffe de justice de paix de Caulnes.
Il n’est pas « du pays » et y est assez mal reçu. Il ne se plaît pas dans cette petite commune après sa vie rennaise mouvementée, ses amitiés et ses habitudes. Une certaine fantaisie dans son comportement, probablement un élan très modéré pour sa profession font que ses rapports avec le juge en titre sont vite tendus. Ce dernier lui adresse des remontrances. Il n’a que faire d’un greffier poète et le poète ne supporte pas un M. Homais juge ! La situation est très tendue et Lud Jan (comme l’appellent affectueusement ses amis) en souffre.
Dès octobre 1892, au cours d’une audience, le jeune greffier éclate, il perd tout contrôle de lui-même devant l’entêtement du juge à propos de l’affaire dont on traite et lance à l’auditoire : « Il m’est décidément impossible de vivre avec cet épicier de première classe ». Le 14 novembre, il quitte sa charge.
Son premier ouvrage, Dans la bruyère, est paru en 1891. Il l’a envoyé à plusieurs écrivains, dont Leconte de Lisle qui lui répond le 3 octobre 1891 en le qualifiant sans ironie de « cher confrère » et en disant particulièrement son admiration pour le poème La Mort du taureau « plein de vers mâles et solides ». Il recevra aussi des lettres encourageantes de François Coppée, et de J.-M. de Hérédia auxquels il s’est adressé. La presse bretonne est unanime. Dans Le Semeur, M. Fuster écrit le 27 octobre 1891 : « Je tiens ce Rêveur pour un des quatre ou cinq remarquables poètes de ce temps. » Le journaliste B. Robidou, le rédacteur en chef de l’Avenir de Rennes, écrivain confirmé, écrira à propos de cette publication :
« Lorsque je le reçus, frais et pimpant sous sa couverture blanche, je l’emportai à l’Hôtel de ville, où j’étais alors chef du bureau du Domaine de l’État, curieux de voir comment les titres alléchants que j’avais aperçus en coupant les pages tenaient leurs promesses. La pièce intitulée « Les landes et les grèves » dépassa tout de suite mon attente ; écrite en vers de grande allure, elle révèle un poète à l’âme vibrante et fière, aimant la nature, le sol natal, ses traditions, et les chantant d’un ton grave, presque solennel ; je fus à la fois surpris et charmé. La magistrale beauté de la seconde pièce, « Le Taureau », accentua cette double impression […] Tous ces tableaux d’une mélancolie pénétrante, d’une exécution parfaite me ravirent. »
Il ira jusqu’à voir en lui « le plus fort de nos jeunes poètes bretons », jugement auquel on ne peut que souscrire, si toutefois l’adjectif final n’est pas compris dans un sens « réducteur ». Il est en effet d’une étonnante sûreté, d’un métier parfaitement maîtrisé. Ses vers n’ont pas cet à-peu-près qui entache souvent les premiers recueils. Bien entendu, Ludovic Jan a beaucoup lu et ces lectures-inutrition ont laissé des marques : Lamartine, Baudelaire, Rimbaud, Verlaine, Leconte de Lisle, Hérédia, les Parnasse, les Symbolistes…, mais il n’imite jamais et sait être original. Son impossible départ peut, par exemple, être lu sans dommage à la suite de Bateau ivre ! Sa poésie est ingénieuse et troublante, sa versification parfaite et émouvante, ses idées paraissent peut-être traditionnelles, elles sont pourtant neuves car elles sont dites autrement ! Il aime la nature et les paysages de Haute-Bretagne, mais ses « crayons » n’ont rien de convenu : son regard ouvre des perspectives. La limpidité de son expression, la précision et l’économie de ses descriptions, ses méditations « près du menhir antique » le distinguent. Parfois mélancolique ou sombre, il n’oublie pas d’être gai et s’il s’intéresse à la Bretagne, il évoque bien d’autres thèmes : la Révolution, Bonaparte, la guerre de 1870 (« La fin d’un monde » qui est d’un visionnaire). Il voue un véritable culte à l’auteur de l’Imitation, est touché par l’Angélus de Millet, la peinture de Fra Angelico…Doué d’une sensibilité extrême, il chante l’amour profane et l’amour céleste mêlés au mystère de la vie.
Ses œuvres sont certes le plus souvent narratives, mais c’est un genre alors en vogue et il y excelle. Son poème Lilith en est un bon exemple.
Louis Tiercelin écrira à propos de Dans la bruyère : « Ce fut, lorsque le livre parut, une fête pour nous tous ; ce fut une fête pour la Bretagne […] ». Et ce n’est pas là un vain compliment : Louis Tiercelin avait accepté de faire précéder le recueil d’un « prélude » qu’il avait composé à l’occasion de la publication.
En 1893, il publie Les rêves.
Il est fêté lors du dîner organisé par l’Hermine et le Parnasse Breton.
Une consécration rapide mais qui sera, hélas, sans lendemain ! Il semble que, rapidement, l’aspect sombre de sa poésie prenne le dessus : « Les départs » expriment le pressentiment d’une vie qui sera courte, « L’impossible départ », « La vie en noir » illustrent cette tendance. Lud Jan est en effet atteint de tuberculose et le 4 octobre 1894, il meurt alors qu’il n’a que trente ans.
Ses amis réuniront diverses pièces inédites pour publier ses œuvres posthumes et B. Robidou en rédigera la préface (Œuvres posthumes de Lud Jan, Rennes, 1896)
L’impossible départ
J’ai fait ce rêve à l’âge où l’homme fait des rêves ;
Sur un vaste navire où seul j’étais vivant,
Sans l’instant où la mer abandonne les grèves
Avec elle j’allais toutes voiles au vent.
Ce n’était pas pour fuir le vieux monde. La terre,
Je devais la trouver encore sous d’autres cieux ;
Mais je souffrais du mal infini du mystère,
Avec l’horreur d’avoir des hommes sous les yeux.
Et je rêvais d’une île étrange, inhabitée.
Rien que des chants d’oiseaux mêlés au bruit des bois ;
Rien ne troublera plus l’âme désenchantée
Qui se rajeunira dans l’oubli d’autrefois.
Après avoir roulé, seul, sur les verts abîmes,
Contemplant le soleil en son infini bleu
Où les astres sans nombre au fond des nuits sublimes,
Dans l’immobilité méprisante d’un Dieu ;
Je cacherai mon front marqué d’un anathème
Sous les grands baobabs et les cactus rugueux
Tout en se mêlant, avec nonchalance suprême,
La gloire du penseur au sans-gêne des gueux.
Eh bien ! partons : voici le flot qui se déroule
Et le vent qui fouette les flots […]
François Labbé pour le Centre d’Histoire de la Bretagne