Il sort ce mois-ci, en librairie, un « Robespierre » signé Jean-Clément Martin. Cette biographie succède à des dizaines d’autres. A l’arrivée, Robespierre reste toujours aussi difficile à appréhender. L’Incorruptible fut-il un tyran, un bourreau, un monstre ou bien la victime expiatoire, le bouc émissaire d’un processus de radicalisation politique qui a tourné court ?
Jean-Clément Martin sous-titre son essai : « La fabrication d’un monstre ». Il nous livre un récit monocorde, juste le parcours plutôt fulgurant d’un homme parti de rien et porté au pinacle un temps très court, un peu plus d’un an, de juin 1793 à Juillet 1794. Depuis plus de 30 ans, Martin occupe une place éminente dans l’historiographie révolutionnaire.
Attaché par ses racines à comprendre le drame vendéen, il a, en concomitance avec Reynald Sécher (autre Vendéen) remis en cause les chiffres officiels de la répression. Dès 1986, Martin estimait les victimes à plus de 200 000, une évaluation qui doublait le chiffre de celle avancée par Sécher. Mais, pour autant, il refusait de parler de génocide. Un néologisme forgé par le juriste Raphaël Lemkin, en 1944, pour mieux qualifier l’extermination des Juifs par le Reich hitlérien. Il récusait encore le qualificatif de « populicide » imaginé cette fois par le libelliste Gracchus Babeuf après Thermidor pour mieux confondre le représentant du peuple Jean-Baptiste Carrier venu à Nantes pour liquider les Vendéens survivants de la Virée de Galerne.
Une polémique, un peu datée désormais, s’ensuivit. Elle se perdit au regard des historiens et devint un enjeu mémoriel. On parla alors, pour la Vendée, de « mémoricide ». Pourquoi pas.
La matière historique, son appréhension par ceux qui l’étudient au travers des sources et des témoignages, est rétive à toute conceptualisation. La « philosophie de l’histoire » est la pire compagne de l’historien. Seuls les faits comptent. Encore faut-il les lire nominaux, les hiérarchiser pour mieux les insérer dans un « continuum » qui n’est jamais joué d’avance. Car la part de l’aléa est considérable, elle règle mais aussi dérègle le processus historique. Le seul parcours du lieutenant d’artillerie Napoléon Bonaparte est là pour en attester au point que l’intéressé, à Sainte-Hélène, lâchera : « Quel roman que ma vie ! »
Ce qui s’applique à la perfection à Maximilien (de) Robespierre qui, parti de son Artois natal, d’Arras, se retrouva, à 36 ans, l’homme-clé, le pivot de la Révolution jacobine. Sur les premières années, sur cette « enfance d’un chef » pour reprendre (avec Martin) la formule sartrienne, que du banal, dans le fil des malheurs et des bonheurs du temps. Orphelin de mère, le père enfui, élevé par sa grand-mère dans un cadre bourgeois, Maximilien fait de bonnes études jusqu’à Louis-le-Grand, à Paris. Appliqué, rangé, il choisit le droit et peut s’inscrire, à 23 ans, au barreau de Paris.
Il devient un avocat recherché car travailleur sinon brillant. Il se pique de lettres, entre dans ces académies provinciales qui encadrent, gentiment, la sociabilité politico-littéraire. A sa vénération pour une Antiquité très formelle, héroïque (Les Gracques, Caton, Cicéron) il associe des envies réformatrices, émancipatrices qu’il puise souvent chez Jean-Jacques Rousseau. Tout naturellement, comme des centaines d’autres « robins », il entend participer au grand remuement du royaume sorti de la convocation des États généraux.
Ce sera un révolutionnaire en chambre, actif en parole, des oraisons à foison, dans les assemblées, au club des Jacobins. Une vie parisienne, rangée, mimétique même qui fait penser à celle de Kant, le « chinois » de Königsberg » comme disait Nietzche. En fait de pratique du peuple, des allers retours entre les tribunes où il parle et le foyer de la famille qui l’abrite et le protège. Une chambre, monacale.
Robespierre est presque « un homme sans qualités » qui ne donne rien, ignore les femmes au point de rester vierge, n’apporte aucune chaleur, pas la moindre empathie dans ses rapports publics. Peu à peu, il s’est découvert « porteur d’une exigence supérieure, ordonnateur de la régénération des Français » et, par l’exemple de toute l’humanité. Le royaliste Thomas Royou qui l’observe avertit : « Robespierre n’est point un fourbe, mais seulement un fanatique. »
Un dictateur improvisé, en C.D.D., moins d’un an, toujours sur le fil, remis en cause. L’historien de Waresquiel (Fouché, Perrin, 2015) ne s’étonne pas : « En voilà un qui a la tête de l’emploi. Si le pouvoir devait être froid, distant, triste, gourmé et sanglé (…) alors Robespierre lui ressemblerait. »
Mais pour Martin, tout cela est psychologisme à la petite semaine, insignifiant, non-signifiant. Son « Robespierre » est politique, téléonomique et rien d’autre. A l’actif de son essai, une excellente évocation des apprentissages du jeune Robespierre, une parfaite connaissance des jeux de réseau qui font et défont les chefs de la Révolution mais qui ne s’apprécie qu’ à condition d’être très familier de la période. A son actif encore, la déconstruction d’une historiographie, de droite comme de gauche, qui invente le Robespierre « utile » pour chacun deux camps.
Mais ce qui n’est pas acceptable chez cet auteur et dont il se rend régulièrement coupable c’est le recours constant à la sophistique et à la casuistique lorsque les faits ne lui plaisent pas, idéologiquement parlant. Car cet historien a la tête politique, « de gauche », doctrinaire. Son Robespierre doit sortir absolument blanchi, par la porte ou par la fenêtre, de tout ce qu’il a dit et inspiré. En forçant le trait (je l’avoue) on en vient à un Robespierre innocent, en tout cas les mains propres. Il n’a pas voulu la Terreur et même tout fait pour en réduire les excès. Une Terreur d’ailleurs si peu identifiable qui a laissé si peu de traces… Avec Martin, elle devient évanescente, presque un ectoplasme. Dommage qu’on ait autant guillotiné, fusillé, noyé, massacré…
Ce Robespierre-là, celui de Martin, me fait penser au plus terne des dictateurs du XXème siècle, Antonio de Oliveira Salazar. Un homme effacé, d’une foi ardente, s’astreignant à une vie de moine, sans amours, sans amitié. Il tint le Portugal sous sa férule durant 36 ans. Un temps de vie glacé, stérile qui engourdit le pays jusqu’à la consomption. Un Robespierre qui avait réussi.
Jean Heurtin
* Jean-Clément Martin, Robespierre, Perrin.
Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2016 dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine.









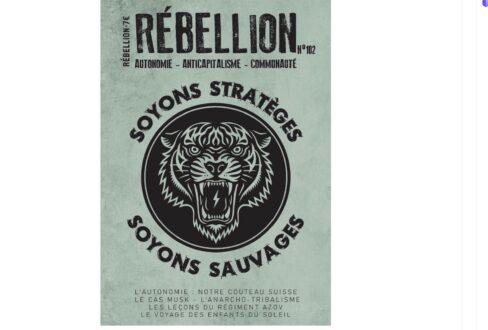


3 réponses à “Quel Robespierre pour la gauche ? A propos du livre de J.C. Martin”
Salazar a utilisé la religion catholique comme instrument oppressif, dans une société fermée et claustrophobique, où chacun devait rester à sa place et surtout ne pas chercher à sortir de sa position sociale, même par les études. Le pape Paul VI est jugé trop libéral et certains de ses textes seront censurés para la police de Salazar.
Robespierre est plutôt un fanatique comme Savonarole.
Equiparer Robespierre et Salazar est parfaitement pervers et malhonnête. » Salazar aurait utilisé la religion catholique comme instrument oppressif » là c’est du délire. Voyez un peu les « bienfaiteurs » révolutionnaires qui à la suite de Robespierre ont fait, et continue à faire, des millions de morts, sous les doux noms de Petit Père des peuples, de Leader Maximo, de Grand TImonier………en utilisant la religion du bonheur ici-bas, de « l’égalité », de la fraternité du matérialisme socialiste ou capitaliste, alors là vous aurez une idée de ce qu’est un instrument oppressif.
Si vous aimez tant le catholicisme, un conseil: ne le défendez pas.
Je considère le christianisme comme le meilleur, et de loin, des monothéismes et suis fasciné par la richesse (spirituelle et matérielle) du catholicisme.
Pourtant, à chaque fois que je vous lis, j’hésite entre m’abonner à Charlie Hebdo, me faire circoncire, francmac ou profaner une chapelle en écoutant du death metal.
Ce sont les gens comme vous qui ont vidé les églises.