Le titre de cet ouvrage n’est certes pas très affriolant. Et lorsqu’on lit, dès les premières pages, que l’auteur a été nourri aux théories de l’Ecole de Francfort, on craint d’avoir affaire à un de ces essais à la lourdeur toute germanique infusant dans une idéologie « postmarxiste », ce qui n’a rien pour inciter à aller plus avant. Mais Streeck, en définissant sa méthode au début de son ouvrage, nous rassure, car il est loin du sectarisme que l’on pouvait appréhender.
Cette méthode est en effet étayée par la conviction que l’Histoire n’est pas prévisible ; elle est en outre critique par rapport à la théorie des crises issue de l’Ecole de Francfort, précisément parce qu’elle se réfère au référentiel marxiste. Il dit clairement que la question de savoir si son analyse est marxiste ou néomarxiste est « totalement inintéressante ». Son propos est donc de décortiquer la crise dans une perspective dynamique, comme un moment du processus de dissolution des régimes de capitalisme démocratique de l’après-guerre, commençant dans les années 1960 et se poursuivant aujourd’hui. Il s’agit donc d’une analyse des évolutionsdurant cette séquence de 50 ans, s’inscrivant donc dans un temps long.
Il faut donc déguster la décoction jusqu’à son terme et l’obstination est payante, car il s’agit probablement d’un essai parmi les plus pertinents à ce jour sur l’analyse de l’évolution du système capitaliste depuis la fin de la deuxième guerre mondiale.
Du temps acheté fera grincer des dents, car il interpelle notre famille de pensée, qui refuse la pensée dominante et le « politiquement correct », sur ce qui est probablement l’un des enjeux idéologiques majeurs de ce début du XXIe siècle : celui de la conciliation entre la conviction que le libéralisme économique est « le meilleur des régimes à l’exception de tous les autres », et le constat que son évolution depuis 50 ans, notamment sa convergence avec un « libéral-libertarisme » politico-sociétal qui imprègne désormais toute notre vie, va à l’encontre de toutes les valeurs que nous défendons.
Acheter du temps à l’aide d’argent

Pendant quarante ans de l’argent a été ainsi mobilisé à une échelle considérable en quatre étapes successives pour désamorcer les conflits sociaux potentiellement déstabilisateurs :
– inflation
– endettement étatique
– développement des marchés du crédit privé
– achat des dettes étatiques et des dettes bancaires par les banques centrales.
Cet achat de temps a été bien entendu étroitement lié au processus de « financiarisation » de l’économie. L’analyse inscrite dans le temps montre que ce qui a été annoncé comme « fin de crise » n’a jamais été qu’un palliatif provisoire et que les solutions trouvées pour résoudre un problème n’ont jamais mis plus de dix ans pour se transformer en problème nouveau s’ajoutant aux problèmes précédents.
Streeck considère que les crises traversées par le capitalisme avancé depuis les années 1970 traduisent le déploiement progressif de la tension entre capitalisme et démocratie : « Les problèmes de légitimation du capitalisme démocratique vis-à-vis du capital devinrent des problèmes d’accumulation, réclamant, comme conditions de leur résolution, que l’économie capitaliste soit sans cesse et de plus en plus délivrée de l’intervention démocratique ». Le marché a progressivement remplacé la sphère politique comme garantie d’un socle puissant du capitalisme moderne (lequel est fondé sur la cupidité et la peur). La démocratie de masse et redistributive dérivée des systèmes politico-économiques keynésiens de l’après-guerre a été stérilisée et a évolué vers une « ploutonomie » globale, gommant toute dimension économique de la démocratie et toute dimension démocratique du capitalisme.
L’auteur souligne la difficulté d’émergence des forces de résistance contre cette évolution compte tenu de l’amplification continue des techniques de contrôle social qui se mettent en place sur les classes sociales qui « décrochent », et des « drogues de croissance alternatives » disponibles pour poursuivre l’accumulation du capital dans les pays riches (consumérisme, rôle de la publicité, création de besoins factices, etc.).
La crise à triple détente
Est décrit en détail le paysage de crise d’un nouveau type que nous connaissons depuis 2008, qui comporte trois volets :
– la crise bancaire ;
– la crise des finances étatiques (crise fiscale) ;
– la crise de l’économie réelle (crise de croissance).
Ces trois volets se nourrissent mutuellement et ont en outre des interactions entre pays compte tenu de la mondialisation. Il en résulte des mutations ultrarapides et imprévisibles, qui minent le champ d’action politique par une multitude d’effets secondaires qui ne font qu’aggraver la situation. Streeck expose le contexte historique qui a abouti à la situation actuelle : jusqu’au début des années 1970, la crise n’était pas à l’ordre du jour. Il existait une confiance générale dans le keynésianisme, l’économie mixte, la planification, le rôle du secteur public, la politique des revenus, l’économie régulée. Cette confiance résultait d’une croyance partagée dans le caractère essentiellement technique de l’économie et dans le Progrès continu, notamment le progrès technologique.
En définitive, ce système a fonctionné sur une base consensuelle pendant plus de vingt ans, car il arrangeait toutes les parties prenantes: capital, travail et Etats. Mais contrairement à ce que pensaient les théoriciens de l’Ecole de Francfort, sa remise en cause n’est pas venue du travail, mais du capital. En effet, le capital, qui était jusqu’alors essentiellement un appareil, est devenu un acteur à côté de l’Etat et des populations. Ainsi la crise de légitimation a eu pour cause, depuis les années 1970, la gêne causée au capital par la démocratie et les obligations qu’elle lui imposait. Il s’agissait donc d’une crise de confiance du côté du capital (croissance en berne, montée du chômage, « grève » de l’investissement, etc.). L’apaisement social des années d’après-guerre, qui prenait la forme de concessions sociales considérables du système aux salariés, permises par la théorie keynésienne d’«adoucissement du capitalisme » dans un monde aux taux d’intérêts et aux bénéfices en réduction constante, est tombé en désuétude. L’équilibre toujours précaire entre les attentes des propriétaires du capital en termes de rendement et celle des salariés en termes d’emploi et de revenu s’est de plus en plus fissuré, prenant toute son ampleur avec les grèves mondiales de 1968-1969. Le capital et les Etats ont été confortés dans l’idée que la phase de croissance sans crise et de plein-emploi était devenue trop longue, et qu’il fallait maintenir un taux de « chômage incompressible » pour faire pression sur le monde du travail qui avait pris goût à la prospérité et à l’Etat-Providence.
1984 ou Le meilleur des mondes ?
Le nouvel objectif commun à l’ordre du jour a été dès lors la libéralisation du capitalisme et l’expansion des marchés à l’intérieur comme à l’extérieur. Cet objectif a débouché sur plusieurs conséquences :
– la remise en cause de l’idée de croissance continue ;
– la défiance à l’égard des gouvernements sociaux-démocrates : le rétablissement de marges bénéficiaires convenables ne pouvait résulter que d’un affaiblissement de l’Etat interventionniste et du recours au marché comme mécanisme premier d’allocations ;
– la remise en cause de tous les mécanismes du « contrat social » d’après-guerre (garantie du plein emploi; fixation des salaires par négociation avec les syndicats et rejet de ces derniers ; désétatisation des industries-clés et du système bancaire ; « flexibilisation » des marchés du travail ; réforme des systèmes de protection sociale ; dérégulation des marchés de biens, de services et de capitaux ; mercantilisation croissante de tous les domaines de la vie sociale).
L’auteur décrit ensuite l’enchaînement qui a conduit d’abord à l’inflation puis à la stagflation, et le commencement de l’ère de l’endettement étatique, qui a permis dans un premier temps de prolonger la paix capitaliste, mais qui a ensuite enclenché une prise de conscience par les Etats du poids de la dette dans leurs budgets. Les créanciers ont alors commencé à douter de la capacité des Etats à rembourser. Pour sortir de cette situation, a été opérée une nouvelle injection de solvabilité anticipée sous forme d’une deuxième vague de libéralisation des marchés de capitaux avec pour effet une hausse rapide de l’endettement privé, que Streeck baptise « un keynésianisme privatisé ».
Ce remplacement de l’endettement étatique par l’endettement privé était justifié en théorie par l’idée d’autorégulation des marchés sans intervention de l’Etat, les acteurs étant censés disposer des informations nécessaires pour exclure les déséquilibres systémiques. Cette vision a permis de poursuivre la privatisation des services publics et le délestage de la responsabilité de l’Etat au profit d’un marché dont les acteurs agissent de façon axiomatiquement rationnelle. Cette perspective s’est révélée illusoire et, avec l’effondrement de cette pyramide de dettes, la libéralisation se trouve depuis 2008 à un stade critique. En outre, le passage d’une phase à l’autre de la crise a entraîné des dégâts sociaux et humains considérables, comme on peut le constater tous les jours. Pour l’auteur, la seule issue à cette course à l’abîme serait la « redéfinition fondamentale des rapports de la politique et de l’économie au moyen d’une transformation totale du système étatique ». Force est de constater qu’il n’entrevoit aucune piste précise, mais qui peut se targuer d’avoir des recettes crédibles à proposer, hormis celles qui relèvent de la pulsion de révolte irraisonnée, ou de la poursuite de la spirale d’autodestruction du système ?
Il n’est d’ailleurs pas sûr que l’on dispose du temps nécessaire pour échafauder des plans de secours, car Streeck constate un épuisement de tous les outils de légitimation par ce qu’il appelle la « production d’illusions de croissance » : en particulier, le « sortilège monétaire » généré par une industrie financière déchaînée est à ses yeux trop dangereux pour prendre le risque d’y recourir à nouveau. Et il met l’accent sur le fait que l’utopie du management de crise actuelle représente le parachèvement de la dépolitisation déjà très avancée de l’économie politique. Cette dépolitisation est cimentée dans des Etats-nations réorganisés « sous le contrôle d’une diplomatie financière, gouvernementale et internationale à l’écart de toute participation démocratique ».Suivez mon regard…
L’ouvrage consacre de passionnants développements à la politique américaine qui a conduit à la crise des subprimes et aux politiques « nationales » des grands pays européens depuis 2008. Il détaille également les enchaînements dramatiques du libéralisme à l’œuvre au sein de la zone euro, en particulier à travers les cas de la Grèce et de l’Italie, et il a des mots extrêmement durs à l’égard de l’oligarchie politico-financière qui intervient dans ce processus. Il note au passage que la politique TINA (There is not alternative), qui accompagne la globalisation, « a depuis longtemps fait toucher le fond à la société ».
De plus en plus, on assiste à la mise en place de politiques visant à immuniser le marché contre des corrections démocratiques par différents moyens :
– rarement, l’abolition pure et simple de la démocratie (Chili de Pinochet) ;
– plus fréquemment, l’endoctrinement à la théorie économique standard ;
– et, en facteur commun, les « réformes » visant à l’autonomisation des banques centrales, à l’immunisations des politiques fiscales contre les résultats électoraux, transfert des décisions politico-économiques à des autorités de régulation ou à des « experts », fixation des « règles d’or budgétaires » inscrites dans la Constitution, etc.
Tous ces développements – et bien d’autres que le manque de place obligent à passer sous silence – rejoignent évidemment le point de vue de tous ceux qui s’élèvent contre la « superclasse mondiale », l’éviction des Etats souverains au profit d’organisations internationales dépourvues de légitimité démocratique et contre l’utopie d’une « gouvernance planétaire » incarnée par des personnages comme Pascal Lamy, Dominique Strauss-Kahn ou Christine Lagarde. Rien que pour cela, l’ouvrage mérite des louanges.
Hayek est-il le deus ex machina ?
Le lecteur aura malgré tout quelques sursauts en découvrant que pour Streeck, le grand inspirateur de ce néo-libéralisme à l’œuvre depuis quarante ans serait Friedrich Hayek, qui en a jeté les bases théoriques dans un article de 1939 intitulé « Les conditions économiques d’un fédéralisme interétatique ». Ceux qui se réclament du « bon libéralisme » considèrent en effet Hayek comme un de leurs maîtres à penser. A ceux-là on peut répondre, d’une part, que l’article incriminé était une étude de circonstance qui se proposait de définir les conditions d’un maintien de la paix en Europe, et, d’autre part, que Hayek lui-même n’avait probablement pas une vision aussi systématique et utopique que celle dont Streeck l’affuble après coup.
Il est vrai que Friedrich Hayek n’a jamais démenti sa confiance dans les mécanismes du marché et qu’il acquiesçait à l’idée que le politique devait être subordonné au marché. Pour autant, il faut se garder de toute vision réductionniste à l’égard d’un économiste qui a consacré une partie de ses travaux à combattre le réductionnisme. II est douteux que Hayek se soit satisfait de la manière dont le système économique a évolué depuis quarante ans, et on peut penser qu’il aurait rejoint un autre grand libéral et prix Nobel de sciences économiques, Maurice Allais, dont une lectrice a fort opportunément rappelé la Lettre aux Français (*) écrite en 2009, un an avant sa mort.
Certains pensent, comme Jean-Claude Michéa, Charles Robin ou, beaucoup plus proches de nous, Michel Geoffroy ou Jean-Yves Le Gallou, qu’il est déjà trop tard, que tout espoir dans un colmatage du système libéral est vain, et que « la fin du vingtième siècle, c’est la liquidation du monde pour préserver de la richesse » (Hervé Juvin). Ceux-là pourront trouver des arguments supplémentaires en lisant Du temps acheté. Il en ira de même des souverainistes, mais aussi des analystes comme Gérard Dussouy, qui critiquent brillamment la mondialisation, mais qui gardent l’illusion qu’une Europe politique forte reste une issue possible et plausible.
Quant à ceux qui jugent a priori que « l’utopie hayekienne pure et parfaite » n’est qu’une vue de l’esprit, et qu’il est possible de revenir à un système libéral qui ne soit pas destructeur de toutes les valeurs dans lesquelles ils croient, ils tireront profit de leur lecture en essayant de réfuter la démonstration de Wolfgang Streeck, au risque de tomber dans le déni de réalité. Car il faut bien reconnaître que les faits exposés sont têtus !
Bernard Mazin
15/01/2015
Wolfgang Streeck, Du temps acheté / La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique, Ed. Gallimard NRF Essais, septembre 2014, 378 pages.
Note :
(*) Voir : Lettre aux français : « Contre les tabous indiscutés ».






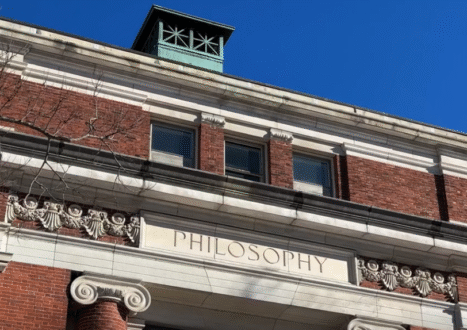





Une réponse à “« Du temps acheté / La crise sans cesse ajournée du capitalisme démocratique » de Wolfgang Streeck”
Contrairement à ce qu’écrit l’auteur de cet article, Jean-Claude Michéa et Charles Robin n’ont jamais espéré colmater le système libéral pour lequel ils n’ont aucune sympathie.
Quant à Hayek, il est juste passé à côté de l’essentiel; il n’a pas compris que le libéralisme n’est pas compatible avec les traditions et les cultures communautaires comme l’a précisément montré de façon décisive Jean-Claude Michéa. La pensée libérale-conservatrice est irrecevable du fait qu’elle recèle une contradiction insurmontable. Entre être conservateur ou être libéral, il faut choisir, parce que le libéralisme est le plus puissant facteur de destruction des cultures, des traditions et même des peuples et des sociétés (du point de vue libéral, l’humanité n’est constituée que d’individus égoïstes motivés par leur seul intérêt). Pour de tels individus, les contraintes liées aux appartenances diverses (famille, patrie…) n’ont strictement aucun sens. L’individu libéral n’appartient à aucune communauté et a des semelles de vent; c’est un nomade guidé par sa seule raison.
La distinction qui est suggérée par Bernard Mazin entre un »bon libéralisme » (celui du passé qui cohabitait avec les traditions) et un »mauvais libéralisme » (celui du présent qui ne s’embarrasse plus de toutes les vieilleries communautaires et traditionelles) n’est pas fondée parce que, comme l’a montré Michéa, l’évolution qu’a connue le libéralisme depuis la dernière guerre mondiale était inscrite dans ses gènes depuis son origine (d’ailleurs, il y eut des »néolibéraux » dès le milieu du 19ème siècle). L’individualisme radical qui constitue le coeur du libéralisme ne pouvait conduire qu’à l’émiettement individualiste de l’humanité et donc à la pulvérisation des nations, des cultures et des traditions. Cette évolution a été freinée par la persistance de la culture ancienne et des valeurs qu’elle véhiculait (honneur, solidarité, héroïsme, sens du devoir….). Tout ce bagage culturel mis à mal au début du 20ème siècle a été totalement ruiné par le triomphe de la puissance libérale par excellence, celle des Etats-Unis lesquels ont déversé leur culture libérale (et progressiste) à très haute dose sur le vieux continent depuis 1945.
Le monde occidental a connu un »moment libéral conservateur » qui a pris fin définitivement au milieu du siècle dernier. Nous ne connaîtrons très probablement plus jamais un tel moment parce que les conditions exceptionnelles de son avènement ont disparu. La révolution conservatrice ne peut qu’être anti-libérale parce que c’est le libéralisme qui anime le processus en cours de destruction des cultures, des traditions et de toutes les formes de communautés (et mêmes des sociétés; Margaret Thatcher ne disait-elle pas que les sociétés n’étaient que des vues de l’esprit ?) au profit de l’extension infinie du seul marché. C’est l’idéologie libérale qui sous-tend le démantèlement des frontières en exigeant l’application du principe énoncé par le libéral Quesnay au 18ème siècle: »Laissez faire et laissez passer », principe que le MEDEF (et tous les patronats libéraux) défend avec constance et acharnement. Quoiqu’en disent les »libéraux-conservateurs », il est impossible d’être libéral et de récuser l’immigration (Madelin qui est un libéral conséquent s’en est rendu compte depuis très longtemps et s’est aligné sur Cohn-Bendit; ils défendent tous les deux le droit à l’immigration sans limites); toute critique de l’immigration s’inscrit donc nécessairement dans une critique de l’individualisme libéral. Le fait que tous les libéraux de droite (à l’exception des »libéraux-conservateurs » qui n’en constituent qu’une frange très mince quoique très active), de gauche et d’extrême-gauche (Michéa) soient unanimes dans leur dénonciation de l’anti-immigrationnisme prouve que ce dernier heurte de plein fouet l’idéologie libérale.